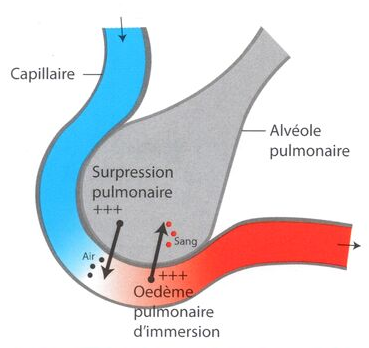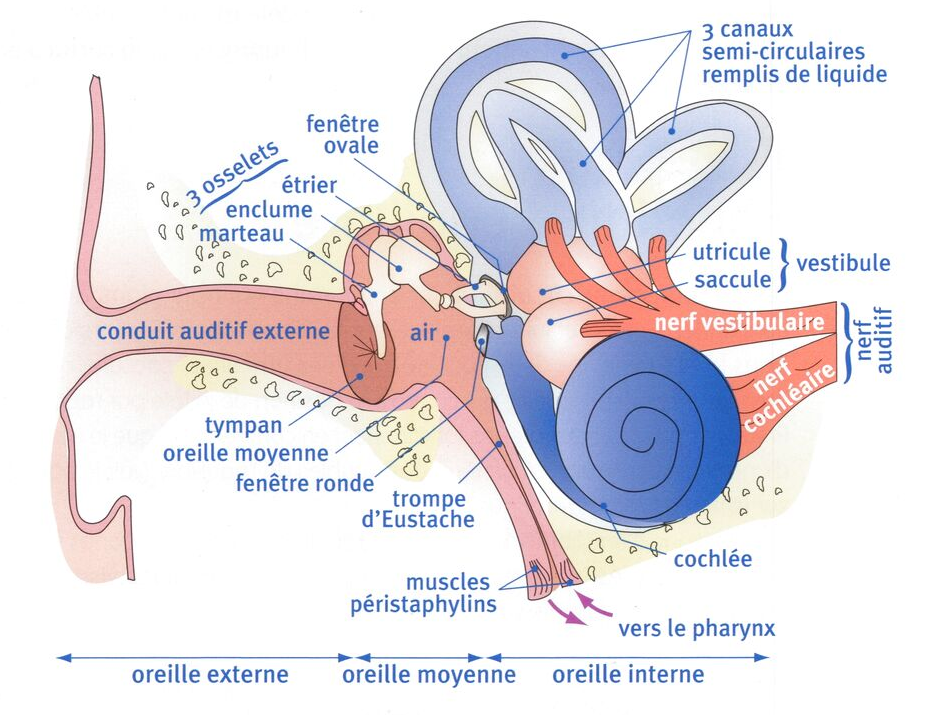Les accidents
Les moments d'échanges avant et après les plongées sont essentiels :
pour évaluer l'état de santé et de forme du pratiquant, rappeler les
consignes de sécurité essentielles, construire une relation de confiance,
et après s'assurer que tout va bien.
Conduites à tenir
| Les secours ne sont
pas appelés |
Les secours sont
appelés |
|
|
Une
déclaration d’accident doit être faite dans les 48
heures
|
Dans tous les cas, le président du club (si c’est une activité
CODEP, le président du CODEP) doit être informé.
Perte de connaissance ou de contrôle moteur
L’apnéiste perd la connaissance ou le contrôle de ses mouvements : sortie de l'eau, fin de la
séance et surveillance.
| Syncope modérée :
l’apnéiste reprend conscience après sa syncope ; les points
de contrôle sont positifs |
Syncope sévère :
l’apnéiste ne reprend pas conscience mais ventile -ou- l'un
des points de contrôle est négatif |
Syncope très sévère :
l’apnéiste ne reprend pas conscience et ne ventile pas |
|
Mise en position de confort + sous O2 15l/min pendant
10 minutes + surveillance pendant une heure
|
Mise en PLS + sous O2 15l/min + surveillance
ventilation et pouls + appel du 15 ou 18
|
Victime placée sur le dos, voies aériennes libérées,
deux insufflations.
S'il y a un pouls carotidien, poursuivre la
ventilation seule et surveiller le pouls.
Si le pouls carotidien est absent, débuter la
réanimation cardio-pulmonaire (R.C.P.) : massage
cardiaque externe, insufflations au B.A.V.U. avec oxygène
et ballon réservoir. 90 massages par minute, 30 massages
pour 2 insufflations.
Appel du 15 ou 18
|
|
À la troisième syncope, un nouveau certificat médical
d’absence de contre-indication, établi par un médecin du
sport / fédéral ou hyperbare est requis.
|
Un nouveau certificat médical d’absence de
contre-indication, établi par un médecin du sport /
fédéral ou hyperbare est requis.
|
Les points de contrôle pendant la surveillance :
- Sensibilité : vérifier sensibilité bras / jambe / visage [
oui | non ]
- Yeux : faire suivre avec les yeux un doigt qui se déplace
sur une ligne horizontale [ oui | non ]
- Neuromotricité : évaluer la force des membres supérieurs et
inférieurs contre résistance [ oui | non ]
- Cognition : faire répéter, à trois minutes d'intervalle,
trois mots simples (pomme, maison, voiture) [ oui | non ]
- Orientation : poser les questions : Qui es-tu ? Où es-tu ?
Quel jour sommes-nous ? Que faisais-tu ? [ oui | non ]
- Proprioception : faire poser un index sur le nez, l'autre
bras tendu à l'horizontal [ oui | non ]
- Équilibre : demander à l'apnéiste de se tenir droit, pieds
joints, yeux fermés, bras tendus [ oui | non ]
D'après une proposition d'Éric de Grossouvre
(2025) et le Guide Pédagogique de formation RIFA Apnée
version 12/2021 accessible à l'adresse
https://apnee.ffessm.fr/uploads/media/default/0001/08/66789c2db4fd55e705f63963b3771b5a7d7b445e.pdf.
Toux et crachat rosé/rouge
L’apnéiste crache du sang, ou un mélange rosé : sortie de
l'eau, fin de la séance et surveillance.
Les points de contrôle pendant la surveillance :
- Poitrine : L'apnéiste ressent une douleur ou une gêne dans
la poitrine [ oui | non ]
- Essoufflement : L'apnéiste est essoufflé (plus de 20
ventilations par minute) [ oui | non ]
- Crépitement : En fin d'expiration, on entend un crépitement
[ oui | non ]
- Conscience : L'apnéiste manifeste des troubles de la
conscience [ oui | non ]
| Toutes les réponses
sont négatives |
Une réponse est
positive |
|
|
Mise sous O2 + appel du 15 ou 18
|
|
S'il n’y a pas de baisse de performance lors d'une
séance de sport terrestre, l’apnéiste peut reprendre une
activité aquatique dans un espace protégé (piscine,
milieu naturel proche du bord…) à moins de 5 mètres de
profondeur.
|
S'il n’y a pas de baisse de performance lors d'une
séance de sport terrestre, après avis d’un médecin
compétent dans la ou les pratiques sportives
subaquatiques concernées, l’apnéiste peut
reprendre une activité aquatique dans un espace protégé
(piscine, milieu naturel proche du bord…) à moins de 5
mètres de profondeur.
|
|
En cas de manifestation anormale d’effort,
consulter son médecin de plongée.
L’accès à une profondeur au-delà de 5 m et jusqu’à 15
doit rester très progressif et sans efforts (pas de
Valsalva brutal à la descente, pas de demi-tour brutal,
…)
Pour la reprise de l’apnée en profondeur (> 15
mètres) ou la participation à une compétition d’apnée :
un nouveau certificat médical d’absence de
contre-indication, établi par un médecin du sport /
fédéral ou hyperbare est requis.
|
D'après le document Accident respiratoire
d’apnée en eau libre lors de séances de travail ou recherche de
profondeur, en apnée, CMPN – octobre 2023, disponible à
https://medical.ffessm.fr/uploads/media/default/0001/10/ccd3b3bf01ea5877afcf2db3233002169998f545.pdf.
Douleurs à l'oreille et/ou aux sinus
L'apnéiste se plaint de douleurs à l’oreille et/ou aux sinus :
sortie de l'eau, fin de la séance et surveillance.
Les points de contrôle pendant la surveillance
- Saignements : L'apnéiste saigne de l’oreille [ oui | non
]
- Audition : L’apnéiste se plaint de troubles de l’audition
(perte, acouphène) [ oui | non ]
- Douleur : La douleur est intense
et/ou persiste [ oui | non ]
- Vertiges et nausées : L'apnéiste se plaint de vertiges
et/ou de nausées [ oui | non ]
| Toutes les réponses
sont négatives |
Une réponse est
positive |
|
|
Appel du 15 ou 18
Un nouveau certificat médical d’absence de
contre-indication, établi par un médecin du sport /
fédéral ou hyperbare est requis.
|
Prévention
La perte de connaissance
Définitions
On parle d'hypoxie pour désigner une baisse de l'apport
d'oxygène aux tissus ne permettant pas une activité normale. Une
hypoxie cérébrale importante peut entraîner une perte de
connaissance. Celle-ci n'est toutefois pas dangereuse en
elle-même : c'est la reprise ventilatoire, si elle se fait alors
que les voies respiratoires sont immergées, qui peut être
dramatique.
L'apnéiste n'est pas lui-même capable de s'apercevoir qu'il
va perdre connaissance. Mais son coéquipier dispose de
plusieurs signes annonciateurs :
- expiration d'air sous l'eau, qui se manifeste par la
présence de bulles [...] ;
- en apnée dynamique ou en poids constant, accélération vers
la fin qui laisse à penser que l'apnéiste force probablement
son apnée ;
- en apnée dynamique, changements de trajectoires, début de
zig-zags, etc.
Bernier, F. et Lemaître, F. Physiopathologie
de la plongée en apnée. Dans Lemaître, F. (2015). L’apnée : de
la théorie à la pratique. Presses universitaires de Rouen et du
Havre
En prévention, on retiendra que l'hyperventilation, qui abaisse le seuil
de CO2 et fausse les signaux de l'organisme, est à proscrire.
On ne fera jamais d'apnée seul ; on évoluera toujours en binôme, et le binôme
doit être prêt à intervenir à tout instant. Tout comportement anormal pendant
une apnée doit être interprété
comme un signe indiquant une perte de lucidité et
nécessitant une intervention.
L'Oedème pulmonaire d'immersion
L'œdème pulmonaire (accumulation de liquide dans les
poumons) dit "œdème pulmonaire d'immersion (OPI)" ou "œdème
aigu pulmonaire (OAP)" constitue une pathologie relativement
nouvelle puisque décrite pour la première fois dans les années
1980. Par le passé, l'OPI a probablement été confondu avec la
surpression pulmonaire. Souvent bénin, parfois récidivant, il
peut être mortel.
La surpression pulmonaire est due au passage d'air dans le
sang. L'OPI est dû au passage de sang (liquides) dans les
alvéoles pulmonaires. [Les OPI représenteraient 10 à 15 % des
accidents graves contre 1 à 2 % pour les surpressions
pulmonaires: Dr J.-L. Méliet coordinateur, Recommandations de
bonne pratique - Prise en charge en santé au travail des
salariés intervenant en conditions hyperbares, MedSuhHyp et
SFMT, 2015, p. 30.]
Foret, A. (2020). Plongée Plaisir niveau
4.
Causes
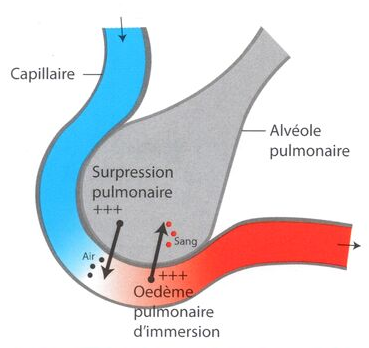
La plongée entraîne divers phénomènes vasoconstricteurs
provoquant une redistribution des masses sanguines vers le
thorax: blood-shift et froid en particulier. Cela peut conduire
à une plus ou moins grande augmentation de la pression
capillaire pulmonaire, au risque de provoquer le passage de
liquide (sang) dans les alvéoles, en cas de "défaillance de la
barrière alvéolo-capillaire". Avoir une pression
intra-thoracique moyenne inférieure à celle de l'air à la
bouche pourrait favoriser cette défaillance: plongeur en
bouteille qui se met sur le dos ou recycleur avec sac
respiratoire sur le dos, plongeur allongé regardant le sol. Le
stress, l'effort physique peuvent augmenter de façon importante
la pression capillaire pulmonaire et favoriser également cette
défaillance.
Une tension artérielle élevée, une anomalie cardiaque même
légère, l'âge, l'eau froide, l'effort ou encore le stress
constituent des facteurs favorisants.
Foret, A. (2020). Plongée Plaisir niveau
4.
Symptômes
L'OPI survient dans l'eau, généralement au fond avec
aggravation à la remontée. Des signes tels que de la toux en
immersion et une sensation d'étouffement doivent immédiatement
alerter le plongeur. A la sortie de l'eau, des crachats
sanguinolents peuvent être constatés, de même qu'une détresse
respiratoire voire un malaise. Les signes cliniques sont
similaires à ceux d'une surpression pulmonaire mais sans signes
neurologiques.
Foret, A. (2020). Plongée Plaisir niveau
4.
Prévention
A ce stade des connaissances des facteurs de risque, il est
difficile de proposer des recommandations aux plongeurs. La
meilleure des préventions semble être d'ordre médical, lors de
la visite préventive, avec la détection des profils à
risque.
Foret, A. (2020). Plongée Plaisir niveau
4.
Les oreilles
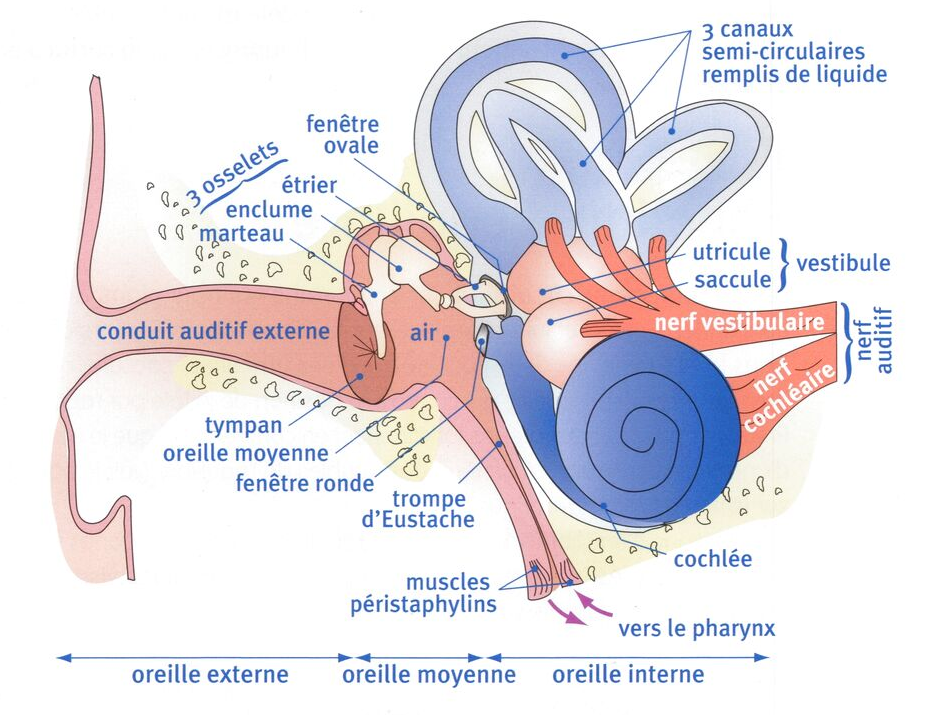
Siège de l'audition et de l'équilibre, fragiles, extrêmement
sollicitées en plongée, les oreilles méritent toute notre
attention. Mieux en comprendre le fonctionnement permet
d'adapter son comportement en tant que guide de palanquée, dans
le souci permanent de la prévention des risques.
Une oreille se compose de trois grandes parties:
• L'oreille externe avec le pavillon et le conduit auditif
qui mène à la paroi extérieure du tympan. Ce conduit est en
communication avec le milieu ambiant: air en surface, eau en
immersion.
• L'oreille moyenne, ou caisse tympanique, est délimitée par
la paroi interne du tympan et par la fenêtre ovale. Elle
contient trois osselets (marteau, enclume, étrier) maintenus
par des ligaments. Elle communique avec le pharynx
(arrière-nez) par l'intermédiaire de la trompe d'Eustache,
conduit généralement fermé qui s'ouvre spontanément toutes les
2 ou 3 minutes et lors de la déglutition, en faisant intervenir
les muscles péristaphylins.
Le rôle essentiel de ce canal de communication est d'assurer
la ventilation et l'équilibre des pressions dans l'oreille
moyenne. L'étrier, solidaire de la fenêtre ovale, met en
communication l'oreille moyenne et l'oreille interne.
• L'oreille interne est un labyrinthe empli de liquide. Elle
contient : - la cochlée (avec la fenêtre ovale et la fenêtre
ronde), organe de l'audition d'où part le nerf cochléaire ; -
le vestibule et les canaux semi-circulaires, organes jouant un
rôle dans l'équilibre, d'où part le nerf vestibulaire.
La réunion du nerf cochléaire et du nerf vestibulaire
constitue le nerf auditif.
A 80%, les accidents ou incidents de plongée concernent les
oreilles.
Foret, A. (2020). Plongée Plaisir niveau
4.
Les otites
L'otite barotraumatique
A la descente, si l'équilibre des pressions ne s'effectue
pas dans l'oreille moyenne, la dépression créée déforme le
tympan qui se tend à l'extrême et se congestionne. Cette
congestion peut gagner la trompe d'Eustache et réduire sa
perméabilité, rendant encore plus difficiles les manœuvres
d'équipression. Ce cercle vicieux ne fait qu'aggraver
l'otite.
Une otite barotraumatique peut aboutir à une perforation du
tympan. Le plongeur ressent généralement une forte douleur,
accompagnée parfois de saignements et d'acouphènes
(bourdonnements, sifflements...). Certains cas présentent aussi
une surdité temporaire, voire des vertiges. La cicatrisation
demande plusieurs semaines.
Le "coup de piston" de l'étrier dans la fenêtre ovale
provoque une brusque augmentation de pression dans le milieu
liquidien
Il peut résulter : d'un équilibrage brutal à la descente,
par exemple du fait d'un Valsalva tardif et donc violent ;
d'une erreur de procédure à la remontée en effectuant un
Valsalva plutôt qu'une manœuvre de Toynbee ou une simple
déglutition.
Le mécanisme est simple à comprendre.
1) à la descente une dépression apparaît dans l'oreille
moyenne faisant, en particulier, s'incurver le tympan; 2) plus
la manœuvre d'équilibrage est tardive, plus elle risque d'être
violente et non contrôlée, provoquant une arrivée d'air massive
et brutale; 3) le retour brutal du tympan à sa position
d'équilibre provoque une réaction en chaîne sur les osselets
solidaires entre eux (marteau-enclume-étrier) pouvant conduire
à la rupture de la fenêtre ovale avec atteinte de la cochlée
voire même de la fenêtre ronde.
L'oreille interne peut ainsi être endommagée avec une perte
d'audition et/ou des troubles de l'équilibre, temporaires ou
définitifs.
La prévention est évidente : équilibrer régulièrement au
cours de la descente par une manœuvre douce et anticipée ; ne
jamais faire de Valsalva à la remontée non seulement pour
éviter ce type de barotraumatisme
Foret, A. (2020). Plongée Plaisir niveau
4.
L'otite infectieuse
Les eaux chaudes sont favorables au développement de la
flore microbienne. Celle-ci peut être responsable d'une
inflammation du conduit auditif externe. Il est conseillé de
rincer ses oreilles avec de l'eau douce et tiède après chaque
plongée, et de bien les sécher en évitant d'utiliser du coton.
Avant la plongée, cela peut être complété par l'application
d'huile d'amande douce dans le conduit auditif, afin de le
protéger du milieu extérieur.
En cas d'otite légèrement douloureuse, il est formellement
déconseillé d'utiliser des médicaments contenant un
anesthésiant si l'on continue à plonger: en ne ressentant plus
de douleur, on peut en arriver à perforer un tympan par une
manœuvre d'équilibrage brusque et/ou tardive. De même, si une
otite persiste, il faut consulter sans tarder un médecin. Une
infection peut aggraver l'otite et conduire là aussi à une
perforation du tympan.
Foret, A. (2020). Plongée Plaisir niveau
4.
Le vertige alterno-barique
Ce phénomène, souvent bénin, se produit généralement lors de
la remontée. Assez fréquent (10 % des plongeurs), il est dû à
un manque de perméabilité de l'une des deux trompes d'Eustache,
ce qui retarde l'équilibre des pressions dans l'une des deux
oreilles moyennes. Les informations transmises aux organes de
l'équilibre (vestibule) n'étant pas symétriques, il en résulte
un vertige bref et fugace avec désorientation. La conduite à
tenir consiste à déglutir, sans jamais faire de Valsalva.
Foret, A. (2020). Plongée Plaisir niveau
4.
L'hypothermie
C'est une expérience courante en entrant dans l'eau -
piscine, lac ou mer d'avoir une sensation de froid. La raison
en est que la chaleur corporelle est dispersée 20 fois plus
rapidement dans l'eau que dans l'air.
Malgré cela, il ne faut que quelques minutes à l'organisme
pour s'adapter. Une restriction des vaisseaux sanguins
périphériques réduit le flux sanguin et ralentit la dispersion
de la chaleur corporelle ; cette condition favorise le maintien
d'une température corporelle constante d'environ 36°, ce qui
est nécessaire aux fonctions vitales.
Cependant si le corps reste assez longtemps dans l'eau alors
la dispersion de la chaleur sera telle que l'organisme réagira
en contractant des muscles (frissons) pour tenter de produire
de la chaleur ; cependant ce mécanisme nécessite de l'énergie
qui sera épuisée en peu de temps. Ainsi, si le corps diffuse de
la chaleur pendant une longue période, la température
corporelle continuera à baisser et les frissons deviendront
plus intenses et prolongés ; dans cette condition, les mains et
les pieds deviennent engourdis, exposant à d'autres
accidents.
Si la température corporelle descend en dessous de 35°, une
hypothermie se produit, à 32° la capacité de raisonnement est
altérée, et en dessous de 32° il y a une menace immédiate pour
la vie.
Umberto Pelizzari et Stefano Tovaglieri,
Manual of freediving, éd. Idelson-Gnocchi Ltd.,
2004.
[L'hypothermie] est définie par une température centrale
inférieure à 35 °C. En dessous de cette température, les
muscles s'affaiblissent et les mouvements volontaires et les
frissons se réduisent. Avec la perte de ces mécanismes
générateurs de chaleur, la température centrale peut commencer
à baisser assez rapidement.
Lorsque la température centrale chute à 34 °C, une confusion
mentale apparaît, avec peu après une perte de conscience.
Lorsque la température chute en dessous de 28 °C, des
modifications cardiovasculaires graves peuvent survenir,
notamment une chute de la fréquence cardiaque et des arythmies
entraînant une fibrillation ventriculaire qui est peut-être
fatale. Cependant, il est possible de se remettre complètement
d'une hypothermie même extrême, à condition que le sujet soit
réchauffé lentement, de préférence "de l'intérieur". En effet,
la diminution de la température des tissus corporels, en
particulier du cerveau, réduit considérablement leurs besoins
métaboliques et leur permet de supporter une forte restriction
de l'apport sanguin. Dans de tels cas, il est important de ne
pas interrompre prématurément les efforts de réanimation du
sujet.
Il est déconseillé de réchauffer la surface d'un individu
hypotherme trop rapidement, c'est-à-dire par des couvertures
chaudes ou des frottements vigoureux, car l'augmentation du
flux sanguin vers la périphérie peut compromettre le flux
sanguin vers les organes vitaux et entraîner d'autres
problèmes. Parmi les mesures simples pouvant être utilisées
pour réchauffer une personne hypotherme, citons le fait de la
recouvrir de couches de couvertures sèches et, si elle est
vigile, de lui donner des boissons chaudes sans alcool.
Pocock, G., Richards, C. D., & Richards, D.
A. (2018). Physiologie humaine et physiopathologie.
Oxford University Press. Elsevier Masson.
La déshydratation
En l’absence de noyade, si la victime est consciente et en
l’absence de vomissements. La réhydratation orale est conduite
selon la sensation de soif du patient avec de l’eau plate (sur
la base d’un litre en une heure).
Guide Pédagogique de formation RIFA Apnée
version 12/2021 accessible à l'adresse
https://apnee.ffessm.fr/uploads/media/default/0001/08/66789c2db4fd55e705f63963b3771b5a7d7b445e.pdf.
L'alimentation et l'hydratation
L'hypoglycémie
La déshydratation
En immersion, un volume sanguin notable est déplacé vers des
vaisseaux qui peuvent l'accueillir dans l'abdomen et le thorax
: veines abdominales, circulation pulmonaire, cavités
cardiaques. La redistribution du volume sanguin (largement vers
le thorax) peut atteindre 0,7l.
Le remplissage cardiaque entraîne, surtout chez les sujets
jeunes, une diminution de fréquence cardiaque : bradycardie
réflexe.
La redistribution immédiate de volume sanguin lors de
l'immersion résulte d'une diminution de capacité des vaisseaux.
L'entrée lente mais continue d'eau interstitielle das les
vaisseaux tend, elle, à créer une augmentation du volume de
plasma.
En réponse à ces deux actions, les mécanismes régulateurs du
volume plasmatique augmentent la production d'urine. Le début
urinaire passe ainsi de 1ml/min à terre à 6ml/min dans l'eau
après 2h d'immersion immobile. On parle de diurèse
d'immersion.
En plongée, avec activité physique, ce débit est en moyenne
de 4ml/min. La perte de masse d'eau de l'organisme est ainsi de
l'ordre de 250ml pour une heure d'immersion.
Toute immersion produisant une déshydratation, il est
important en étant normalement hydraté et de se réhydrater
après la plongée. L'eau est la seule boisson conseillée. Pour
laisser à notre organisme le temps de l'assimiler, il est
conseillé de boire par petites prises régulières de 0,3 à 0,5
litre d'eau par heure d'immersion.
L'hypothermie
Les malaises respiratoires
La Perte de contrôle moteur
La "samba" serait due à une hypoxie sévère, qui se
prolongerait quelques secondes après la reprise ventilatoire.
Elle constituerait l'étape ultime avant la syncope.
Mécanisme
La "samba" est une perte de contrôle moteur (le sujet ne
sait plus ce qu'il fait) sans perte de connaissance.
Lorsqu'elle se produit, c'est en surface, sans signes
avant-coureurs, dans les 20 à 30 secondes qui suivent la sortie
d'apnée, lors de la reprise ventilatoire. Elle se caractérise
par des gesticulations incontrôlées et désordonnées, avec un
mouvement saccadé de la tête, rappelant celui de la célèbre
danse.
Conduite à tenir
Le retour à la normale est quasi immédiat, à la condition
que l'apnéiste soit assisté afin de prévenir le risque de
noyade : éviter qu'il ne coule ; maintenir les voies aériennes
hors de l'eau ; retirer le masque pour favoriser une bonne
ventilation ; stimuler la victime par le contact physique et la
parole. Conseils à suivre à la suite d'une "samba"/syncope :
mettre fin à la séance ; repos ; hydratation ; si nécessaire,
préparer une mise sous oxygène.
Prévention
Pas d'apnée SEUL sans surveillance. Avant une apnée,
toujours vérifier que la SÉCURITÉ est en place, prête à
fonctionner. ANNONCEZ ce que vous comptez faire et faites ce
que vous avez annoncé. "Je dis ce que je fais, je fais ce que
je dis." Ne pas pousser ses apnées à la LIMITE. Se connaître et
savoir ÉCOUTER son corps, travailler aux sensations plutôt qu'à
la montre. Éviter l'HYPERVENTILATION en se méfiant de ces trois
facteurs : amplitude, fréquence et temps de ventilation.
(SAHEL)
La syncope hypoxique
La syncope est la conséquence d'un manque d'oxygène : en
danger, le système nerveux central se met en veille.
Mécanisme
La syncope en apnée est une perte de connaissance brutale,
temporaire et réversible due à une diminution excessive des
réserves d'oxygène. Elle est également nommée syncope
hypoxique ou syncope anoxique. Elle peut conduire
à la noyade si l'apnéiste est encore dans l'eau lors de la
reprise du réflexe ventilatoire.
La syncope apparaît généralement en fin d'apnée, à
l'approche de la surface, voire même juste après qu'elle ait
été atteinte.
Symptômes
Des signes peuvent précéder la syncope :
| Sur soi |
Sur autrui |
|
Sensation de bien-être inhabituel ; lourdeur et
chaleur dans les muscles des cuisses ; picotements aux
extrémités ; vertiges ; troubles visuels ; tremblements
; désorientation ; etc.
|
Au fond : accélération du rythme de nage en fin
d'apnée ; tête tendue vers le mur ; lâcher de bulles ;
absence de mouvements ; etc.
En surface : regard vide ; coloration du visage
anormale ; pas de reprise de ventilation.
|
Mais la syncope peut aussi n'être annoncée par aucun
signe.
Conduite à tenir
La personne qui assure la sécurité en surface doit descendre
le plus rapidement possible pour porter assistance à la victime
et la remonter. Dès l'arrivée en surface, il faut lui maintenir
les voies aériennes hors de l'eau et avertir les secours par le
signe de détresse. À ce stade, qui dure rarement plus de 30
secondes, il est conseillé de favoriser le retour à la
conscience en le stimulant par la voix, en le secouant, voire
même en lui administrant une ou deux "gifles" légères.
Prévention
Pas d'apnée seul sans surveillance. Avant une apnée,
toujours vérifier que la sécurité est en place, prête à
fonctionner. Annoncer ce que vous comptez faire et faire ce que
vous avez annoncé. "Je dis ce que je fais, je fais ce que je
dis." Ne pas pousser ses apnées à la limite. Se connaître et
savoir écouter son corps, travailler aux sensations plutôt qu'à
la montre. Éviter l'hyperventilation en se méfiant de ces trois
facteurs : amplitude, fréquence et temps de ventilation.
|
|
O2 |
CO2 |
N2 |
| Air ambiant (100%) |
21% |
0.03% |
79% |
| Air alvéolaire |
14% |
6% |
78% |
| Seuil de rupture de l'apnée |
|
6.8% |
|
| Troubles du jugement critique |
5.3% |
|
|
| Perte de connaissance |
4% |
|
|
Autres malaises
| Malaise |
Cause |
Symptômes |
Prévention |
| Essoufflement (hypercapnie) |
Après un épisode de palmage intense ou au cours
d'apnées répétitives rapprochées, sans récupération
suffisante, PaCO2 peut atteindre 50 à 70 mm Hg, zone de
narcose au gaz carbonique
|
Anxiété, essoufflement, augmentation du rythme
respiratoire, qui devient anarchique, confusion
gestuelle, maux de tête, nausée.
|
Prendre le temps de bien récupérer
|
| Syncope sino-carotidienne |
Changement de position de la tête et
hyper-extension.
|
Perte de connaissance
|
Ne pas lever la tête.
|
| Syncope vaso-vagale |
Suite à une douleur vive, une émotion violente,
chute de la tension artérielle et bradycardie qui
entraînent une chute du débit sanguin cérébral
|
Sensation de tête vide, sueurs, nausées, vertiges,
palpitations, vue brouillée, acouphènes, jambes en
coton
|
|
| Syncope d'origine cardiaque |
Les syncopes d'origine cardiaque peuvent résulter
d'une extrême bradycardie, de troubles de conductions
ou de troubles du rythme
|
Perte de connaissance voire mort.
|
Réaliser un ECG de repos pouvant mettre en évidence
une atteinte myocardique préexistante.
|
Les barotraumatismes
|
|
Causes |
Symptômes |
Conduite à tenir |
Prévention |
| Les sinus |
Les difficultés/impossibilités d'équilibrage créent
une différence de pression entre les sinus et les
fosses nasales.
|
Douleur aiguë d'intensité croissante ; saignements
de nez possibles
|
À la descente, stopper et le signaler à l'apnéiste
de sécurité ; à la remontée, ralentir et signaler. Si
saignement de nez, arrêt d'activité + consultation
médicale.
|
Pas de mise à l'eau en cas de rhume, de congestion
ou de crise allergique. Se moucher régulièrement
(évacuer les mucosités). Pas de décongestionnant nasal
avant la plongée (effet rebond)
|
| Les dents |
Compression ou dilatation de petites bulles d'air
logées dans une cavité de la dent (carie, plombage,
pansement, prothèse)
|
Douleur pouvant être très vive (jusqu'à la syncope
!)
|
Arrêt d'activité + consultation dentiste
|
Consulter régulièrement un dentiste. Hygiène
dentaire quotidienne
|
| Le masque |
A la descente, lorsque le masque a atteint sa limite
de déformation, il se produit un effet ventouse
entraînant des lésions nasales et/ou oculaires
|
Apparition de petites hémorragies nasale et/ou
oculaire (paupière, conjonctive). Saignement de nez
|
Arrêt d'activité + consultation médicale
|
Pas d'apnée en profondeur avec des lunettes.
Privilégier un masque à faible volume pour la
profondeur. Compenser par le nez dans le masque
régulièrement à la descente. Attention en gueuse à la
vitesse de descente.
|
| L'oreille moyenne |
Déséquilibre de pression entre l'oreille moyenne et
le milieu ambiant (le plus souvent à la descente)
|
Douleur d'intensité croissante pouvant aller jusqu'à
une rupture du tympan (saignement possible,
désorientation..)
|
A la descente, interrompre et signaler à l'apnéiste
de sécurité. A la remontée, ralentir et faire la
manœuvre de Toynbee (Valsalva inversé) et signaler à
l'apnéiste de sécurité.
Arrêt d'activité + consultation médicale si la
douleur persiste
|
Pas de mise à l'eau en cas de rhume ou de
congestion, pas de produit décongestionnant. Se moucher
régulièrement et s'hydrater. Maîtrise des techniques de
compensation. Jamais de compensation à la remontée
|
| L'oreille interne |
Surpression brutale au niveau de l'oreille moyenne
(Valsalva forcée à la descente, Valsalva à la remontée,
saut dans l'eau, effet de ventouse de la
cagoule...)
|
Les symptômes ne sont pas toujours bien marqués
(baisse auditive, acouphènes, vertiges, nausées,
impression de liquide dans l'oreille...). Certains
symptômes peuvent être confondus avec ceux d'un ADD
(taravana), les circonstances de l'accident peuvent
orienter le diagnostic.
|
A la descente, interrompre et signaler à l'apnéiste
de sécurité. En surface, arrêt d'activité, rester avec
la victime. Au sec, poser des questions pour évaluer le
type de lésion. Contacter les secours pour un avis
médical.
|
Pas de mise à l'eau en cas de rhume ou de
congestion, pas de produit décongestionnant. Se moucher
régulièrement et s'hydrater. Maîtrise des techniques de
compensation. Jamais de compensation à la remontée
|
| Le vertige alterno-barique |
Différence de pression entre les deux oreilles
internes, perturbant les organes liés à l'équilibre
(vestibules) liée à un manque de perméabilité d'une
trompe d'eustache.
|
Le plus souvent bref et fugace et disparaît dés le
retour à l'équilibre des pressions entre les oreilles
moyennes, survient le plus souvent à la remontée. si le
vertige venait à persister, il faudrait suspecter une
atteinte de l'oreille interne.
|
A la descente, s'arrêter et remonter, signaler à
l'apnéiste de sécurité. A la remontée, déglutir (pas de
Valsalva), et signaler à l'apnéiste de sécurité.
|
Éviter les figures acrobatiques (virage en
profondeur sans faire de tonneaux).
|
| L'oedème pulmonaired d'immersion |
Hémorragie intra-alvéolaire résultant d'une
altération ou d'une rupture de de la paroi
alvéolo-capillaire (ou barrière alvéolo-capillaire).
Facteurs possibles : mise en pression trop rapide
(descente poumon vide) ; mouvements thoraciques au fond
(virage, se haler...) ; fluidité élevée du sang (prise
d'aspirine préalable) ; froid, stress,
déshydratation.
|
Toux, toux accompagnée de rejet de sang
(hémoptysie). Difficultés respiratoires (dyspnée).
Douleur ou oppression thoracique. Faiblesse généralisée
ou confusion
|
Sortir de l'eau. Si besoin, mise sous oxygène.
consulter le + rapidement.
|
Travailler l'assouplissement de la cage thoracique,
le relâchement. Attention aux efforts thoraciques en
profondeurs (virage, brasse, halage...).
|
| La surpression pulmonaire |
Respirer de l'air sur un détendeur en profondeur et
remonte en apnée sans expirer
|
Variables suivant l'atteinte : état de choc (pouls
rapide, pâleur, teint violacé, extrémité refroidies),
atteinte pulmonaire (douleur thoracique, toux, crachats
sanglants, voie rauque) voire signes d'atteinte
neurologique (convulsions, troubles de la parole, maux
de tête, vomissement, paralysie, engourdissements,
inconscience).
|
Alerter et pratiquer les premiers secours, si
accidenté conscient : le mettre en position semi assise
avec jambes relevées (O2 à 9l/min), surveillance
attentive des fonctions vitales.
|
Ne JAMAIS accepter d'air d'un plongeur.
|
| Le taravana |
Libération de bulles gazeuses dans le sang : après
des plongées répétitives (même à des profondeurs de 20
mètres), ou pour une plongée en apnée à très grande
profondeur.
|
Vertiges, troubles visuels, nausées, angoisse, perte
de sensations ou de connaissance
|
Respecter une vitesse de remontée modérée
|
Limiter le nombre de descente en profondeur ; ne
jamais faire des plongées profondes en apnée à la suite
d'une plongée avec bouteille au cours d'une même
journée
|
La noyade
La noyade est la conséquence de la pénétration de liquide
dans les voies aériennes empêchant les échanges gazeux. Elle
peut être due à un problème physique (manque d'entraînement,
malaise, etc.), à une défaillance ou à une mauvaise
connaissance du matériel, à une réaction inadaptée, à une
situation accidentelle (bloqué au fond dans une épave,
etc.).
| Stades |
Conscience |
Respiration |
Circulation |
| AQUASTRESS : C’est la « tasse ». L’eau n’a
pénétré que dans les voies aériennes supérieures. Le
sujet est angoissé, épuisé et a froid. |
+ |
+ |
+ |
| Petite Hypoxique : Inhalation d’une faible quantité
de liquide dans les poumons. Des troubles de la
respiration apparaissent |
+ |
+/- |
+ |
| Grande Hypoxique : La quantité d’eau dans les poumons
est plus importante (œdème du poumon). Les troubles de la
respiration sont importants). |
+/- |
+/- |
+ |
| Grande anoxique : Les troubles de la respiration sont
très importants et l’arrêt cardiaque est imminent |
- |
- |
- |
Le RIFA
RIFA : Réaction Intervention Face à un Accident
Avant toute chose, sur un site, repérer
- l'oxygène
- le défibrillateur
- le téléphone
Dans tous les cas, on appelle les secours :
- 15 : SAMU
- 18 : Pompiers
- 112 : Numéro d'appel unique sur le territoire
européen
La victime est consciente
1. Mettre en sécurité
La victime doit se mettre dans la position qu'elle souhaite
:
- allongée pour éviter une chute
- assise en cas de gène respiratoire
Il faut sécher et couvrir la victime.
2. Questionner
- Est-ce la première fois que cela vous arrive ?
- Prenez-vous un traitement ?
- Avez-vous une maladie, avez-vous été hospitalisé
récemment ?
- Quel est votre âge ?
Toutes ces questions doivent servir à remplir une
fiche
d'évacuation, telle que définie dans l'annexe III - 19
de l'article A. 322-78 du code du sport.
3. Proposer eau et aspirine
4. Appeler les secours
Quand on appelle, on indique
- ses nom et prénom
- le sexe et l'âge de la victime
- la nature, l'heure et le lieu précis de l'accident
On ne raccroche pas avant d'en avoir reçu l'indication.
La victime, inconsciente, ventile
1. Vérifier l'état de conscience
En prenant la main de la victime, et en lui demandant de
serrer si elle entend.
2. Dégager la victime
Défaire col/cravate/ceinture. Pour un plongeur, enlever la
combinaison, le lest, le masque.
3. Vérifier la ventilation
On se penche sur le visage, et on regarde le mouvement du
thorax, en comptant jusqu'à 10.
4. Mettre en sécurité
On met la victime en Position Latérale de Sécurité (PLS)
afin qu'elle ne s'étouffe pas.
Il faut sécher et couvrir la victime.
5. Mettre la victime sous oxygène
Le protocole pour les plongeurs est de 15 litres/minute. On
utilise un masque à haute concentration.
6. Appeler les secours
7. Rester attentif à l'état de la victime
On reprend les constantes régulièrement.
La victime ne ventile plus
Dès l'arrêt respiratoire confirmé, il faut débuter la
Réanimation Cardiopulmonaire (RCP).
1. Réaliser 30 compressions thoraciques
La victime est à plat sur un sol dur, sur le dos, poitrine
nue.
Les compressions se font sur le sternum, sous le sein
gauche.
Les compressions doivent être au rythme de 100-120
compressions/minute.
2. Réaliser 2 insufflations
Il faut
- basculer la tête de la victime en arrière
- pincer le nez de la victime
- appliquer les lèvres autour de la bouche de la
victime
Si la poitrine ne se soulève pas, il faut vérifier l'absence
de corps étranger et le retirer avec les doigts si besoin.
Sur un site de plongée, l'oxygène est obligatoire à partir
de 6 mètres.
En cas d'arrêt respiratoire, on insuffle de l'oxygène avec
un BAVU (Ballon à Valve Unidirectionnel).
3. Reprendre le cycle 30/2
Jusqu'à ce qu'un médecin arrive et prenne le relais, le
cycle doit continuer.
4. Mettre en marche le défibrillateur
La victime doit être sèche.