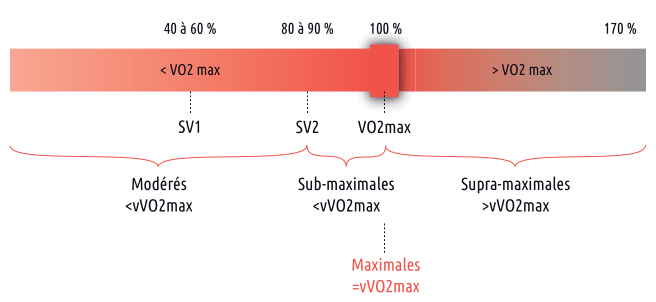Au début des années 2000, Seiler a fait ce qui est peut-être
la découverte la plus importante de l'histoire de science du
sport d'endurance : la règle des 80/20. Grâce à une analyse
rigoureuse des méthodes d'entraînement utilisées par les
athlètes d'endurance d'élite dans une variété de disciplines
d'endurance, il a découvert que les cyclistes, coureurs,
triathlètes et autres de classe mondiale effectuent environ 80%
de leur entraînement à faible intensité et les 20% restants à
des intensités modérées et élevées. Il a été démontré que même
les athlètes amateurs qui s'entraînent 45 minutes par jour
s'améliorent davantage lorsqu'ils suivent la règle des 80/20
que lorsqu'ils s'entraînent avec une plus grande intensité.
Les physiologistes de l'exercice placent la frontière entre
une intensité faible et modérée au seuil ventilatoire (VT), qui
est le niveau d'effort auquel la fréquence respiratoire
augmente. Chez un triathlète entraîné typique, ce seuil se
situe aux alentours de 78 % de la fréquence cardiaque maximale.
La prochaine fois que vous vous entraînerez, sélectionnez un
rythme qui vous place à environ 75 % de votre fréquence
cardiaque maximale, c'est-à-dire juste en dessous du seuil
ventilatoire. Selon toute probabilité, cela vous semblera un
peu lent par rapport au rythme que vous choisissez normalement
pour les entraînements que vous comptez faire à faible
intensité.
La résistance à la fatigue est encore renforcée par des
exercices de faible intensité grâce à des mécanismes cérébraux.
Pendant l'exercice, le cerveau travaille aussi dur que les
muscles, car c'est le cerveau qui fait fonctionner les muscles,
après tout. Par conséquent, le cerveau se fatigue tout comme
les muscles chaque fois qu'un effort d'exercice se poursuit
jusqu'au point d'épuisement. Mais la fatigue musculaire et la
fatigue cérébrale contribuent à l'épuisement à différents
degrés et à différentes intensités. Si vous nagez, faites du
vélo ou courez jusqu'à l'épuisement à une intensité très
élevée, la fatigue musculaire est plus importante que la
fatigue cérébrale. Mais si vous vous entraînez jusqu'à
épuisement à une intensité plus faible, un processus qui prend
beaucoup plus de temps, c'est le cerveau qui est le plus
fatigué à la fin. Ceci est important, car les améliorations de
la résistance à la fatigue proviennent de l'exposition à la
fatigue. Tout comme vous devez fatiguer vos muscles pour les
rendre plus résistants à l'épuisement lors de futurs
entraînements, vous devez fatiguer votre cerveau pour améliorer
sa résistance à la fatigue.
Le cerveau joue également un rôle crucial dans la régulation
et l'amélioration de la technique dans l'eau, à vélo et à pied.
Chaque fois que vous exécutez une foulée de course, un coup de
nage libre ou un rotation des pédales sur votre vélo, votre
cerveau et vos muscles communiquent avec votre cerveau en
utilisant la rétroaction de vos muscles pour rechercher de
petits raccourcis qui vous permettront d'effectuer la prochaine
foulée, course ou rotation avec moins d'énergie. Ce processus
se produit inconsciemment et automatiquement, et il ne cesse
jamais. L'intensité n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est
la répétition. Parce qu'il faut beaucoup plus de temps pour se
fatiguer à faible intensité qu'à haute intensité, les
entraînements à faible intensité offrent une bien plus grande
opportunité de pratiquer et d'affiner la technique.
Le stress de l'exercice de haute intensité est une arme à
double tranchant. Alors qu'une petite quantité suffit, le corps
ne peut tout simplement pas en supporter beaucoup. Les
perturbations physiologiques causées par un entraînement de
haute intensité mettent beaucoup de temps à se remettre de
celles causées par un exercice de faible intensité. Dans une
étude de 2012 publiée dans la revue Hormones, des chercheurs de
l'Université de Caroline du Nord et de Cal State Fullerton ont
découvert que douze heures après un entraînement de haute
intensité, la fonction thyroïdienne était toujours perturbée
chez des sujets masculins très entraînés, alors que douze
heures après un entraînement facile, la fonction thyroïdienne
était revenue à la normale. En règle générale, plus l'intensité
de l'exercice est élevée, plus il est stressant pour le corps
et moins le corps peut le tolérer. Mais le stress n'augmente
pas linéairement avec l'intensité. Il est prouvé qu'un saut
brusque de stress se produit au seuil ventilatoire, qui, vous
vous en souviendrez, marque la frontière entre une intensité
faible et une intensité modérée. Cela semble se produire parce
que le cerveau doit activer un grand nombre de fibres
musculaires à contraction rapide lorsque ce seuil est franchi.
En conséquence, le système nerveux met plus de temps à
récupérer après des entraînements qui incluent un travail égal
ou supérieur au VT.
Matt Fitzgerald, David Warden, 80/20
Triathlon, De Capo Press, Hachette, 2018.
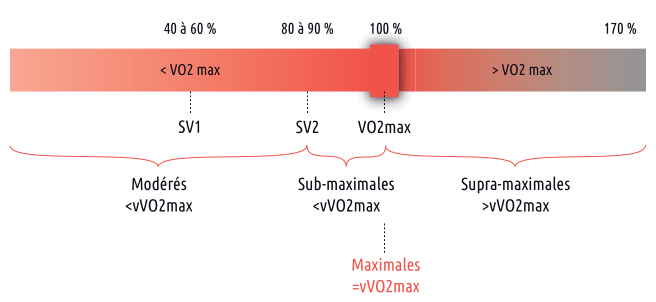
En dessous du seuil 1 : Pour le débutant, cette intensité
est adaptée pour la reprise. L'athlète peut en profiter pour
créer des capillaires sanguins, soulager le muscle diaphragme
des exercices de puissance en le travaillant sur
l'amplitude.
Entre le seuil 1 et 2 : Action préventive des blessures,
augmentation progressive du volume pour renforcer l'appareil
ostéo-musculo-tendineux ; augmentation du potentiel oxydatif
par l'augmentation de la masse enzymatique mitochondriale, donc
augmentation de la consommation des lipides et déplacement du
cross-over point vers des intensités plus élevées (épargne du
glycogéne) ; augmentation de la densité de capillaires (nombre
de capillaires par unité de surface ou par nombre de fibres =
meilleur transport de O2) et des substrats (6 a 24 semaines
d'entrainement en endurance augmentent de 20 à 29% la
capillarisation musculaire) ; augmentation de la clairance du
lactate plutôt qu'une diminution de sa production.
Entre le seuil 2 et VO2max : Efficace chez l'athlete. Adapté
pour la reprise (blessures).
À VO2max : Pour une optimisation : contrôler la récupération
(supérieur à 50%) ; allonger la durée des temps limites (1,5 x
Tlim) ; limiter les séances avec ratio 1 (1:1) chez les
athletes confirmés ; tendre rapidement vers des ratios 2
(1:1/2) (40/20; 30/15; 20/10...) ; tendre chez l'entraîné vers
du ratio 3 (45/15; 30/10...).
Au-dessus de VO2max : Utiliser des pourcentages en fonction
de la spécialité de l'entrainé (bien que le consensus actuel
soit sur le 110 & 120%).
Didier Reiss, La Bible de la préparation
physique, éd. Amphora, 2013.