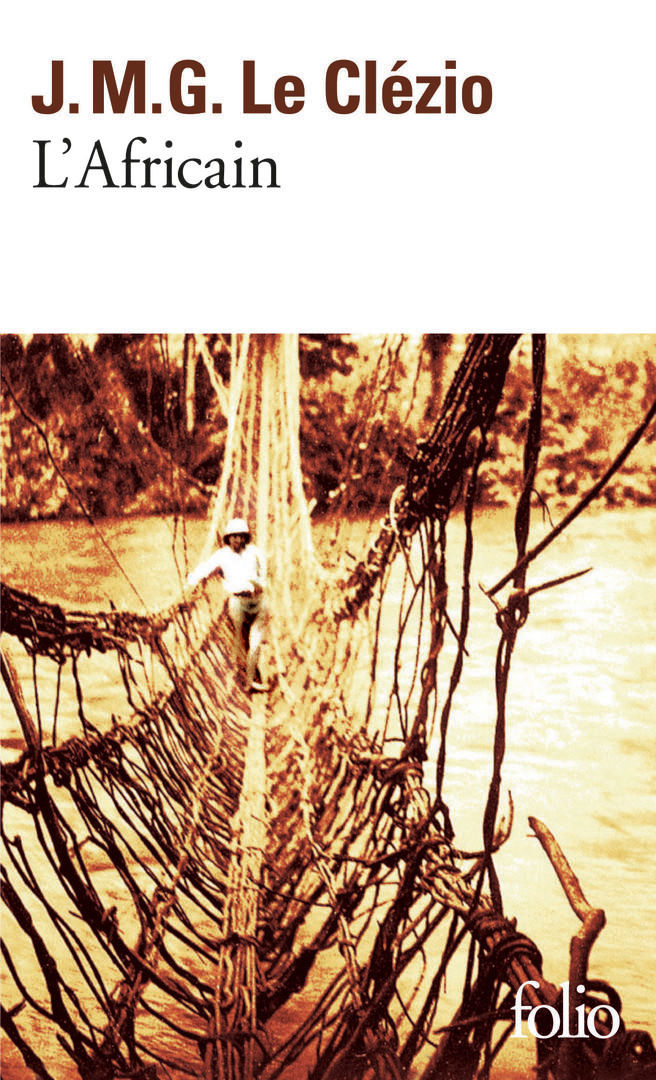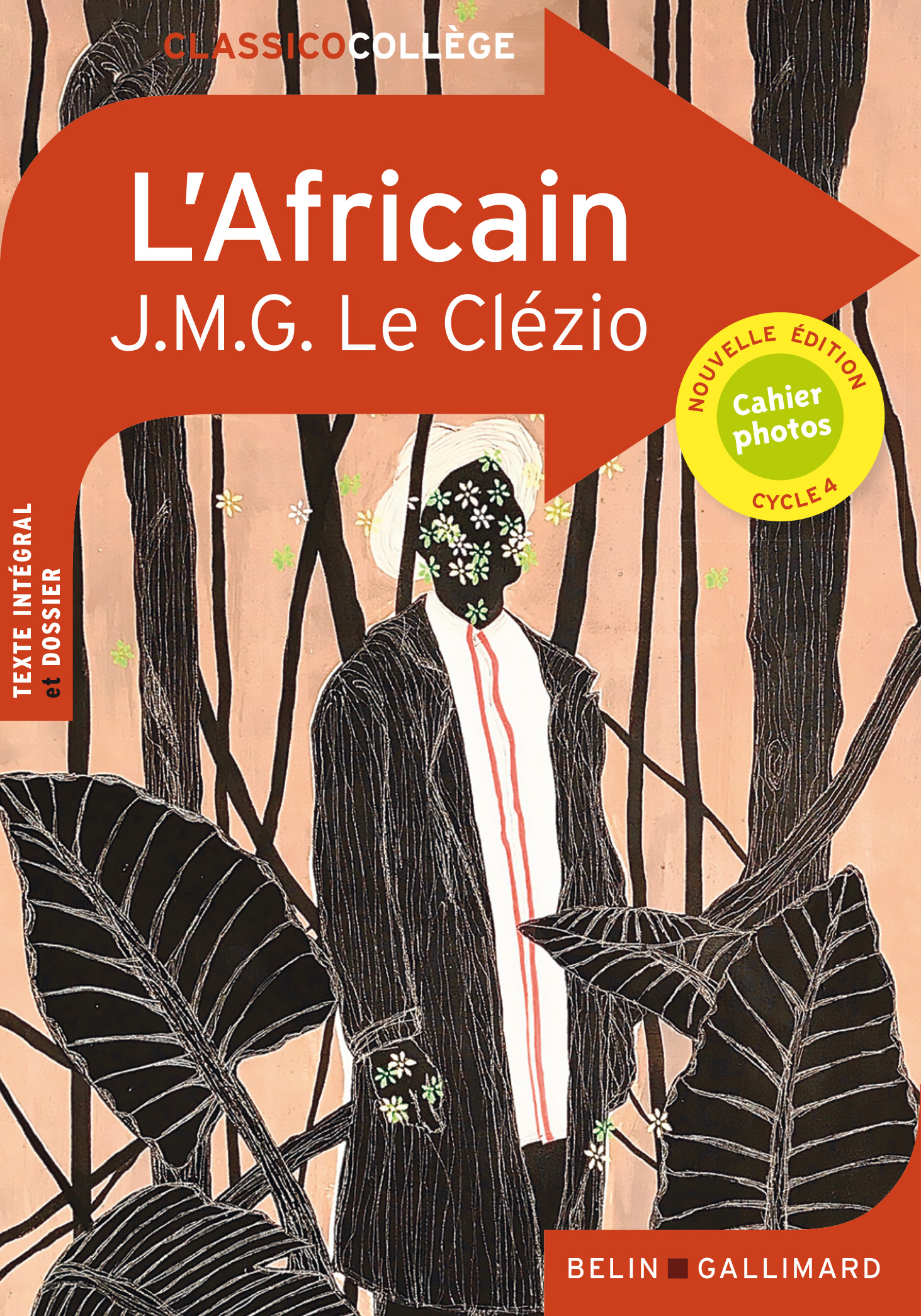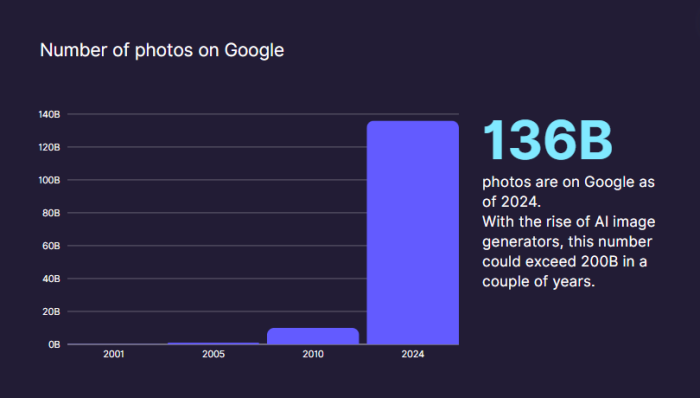1. À propos de son père, Le Clézio écrit : "Il prend des
photos. Avec son Leica à soufflet, il collectionne des clichés en
noir et blanc qui représentent mieux que des mots son éloignement,
son enthousiasme devant la beauté de ce nouveau monde." Selon
vous, les photographies permettent-elles d'exprimer, "mieux que
des mots", nos émotions ?
2. Susan Sontag écrit : "Grâce aux photographies, chaque
famille brosse son propre portrait et tient sa propre chronique :
portefeuille d'images qui témoignent de sa cohésion" (Susan
Sontag, Sur la photographie, 1973-77, éd. Christian
Bourgeois, coll. "Titre 88", trad. Philippe Blanchard, 2008). Cette
description correspond-elle, selon vous, à l'usage qu'en fait Le
Clézio dans L'Africain ?