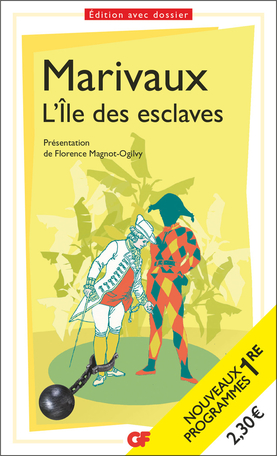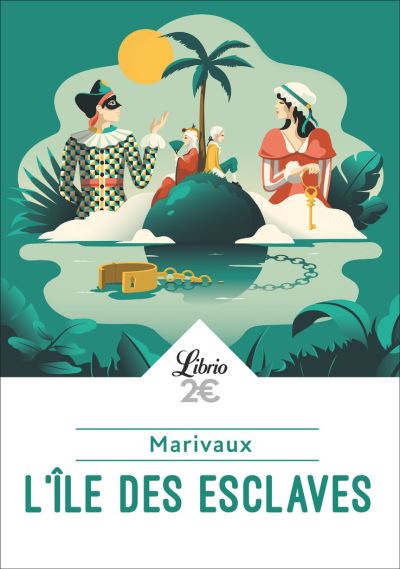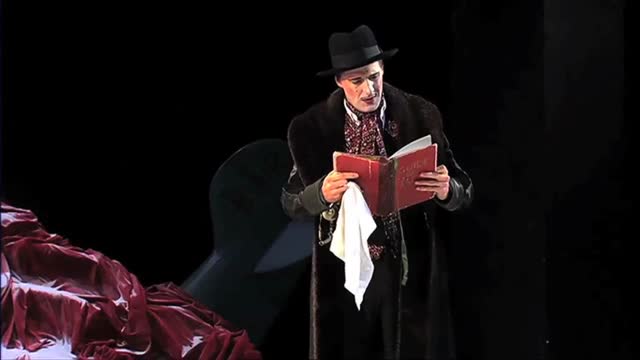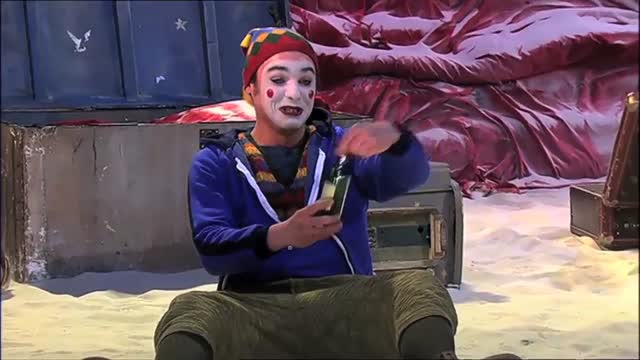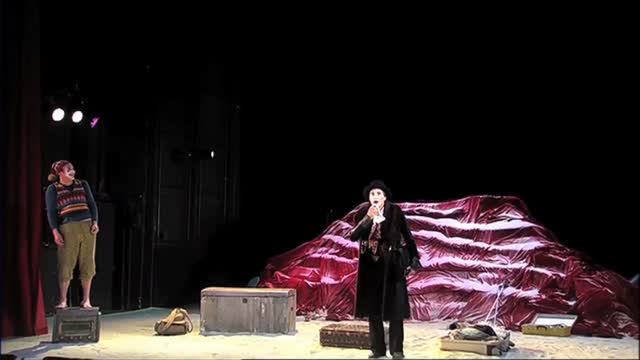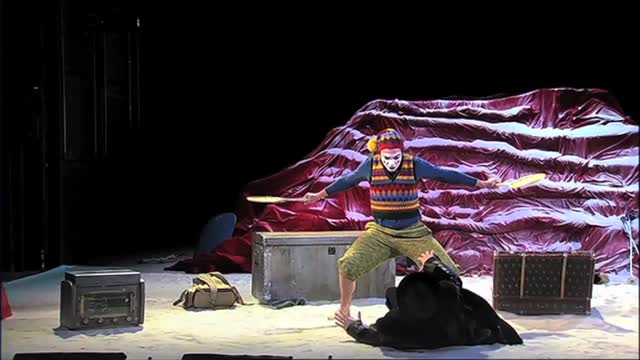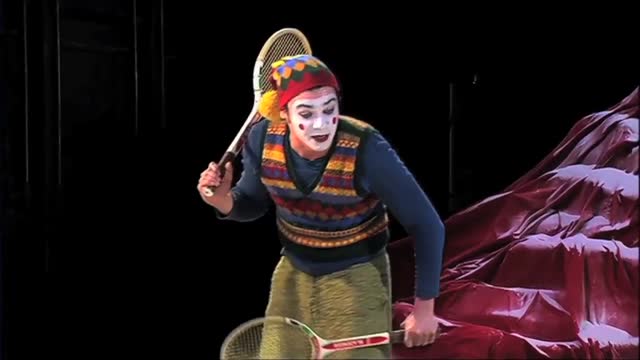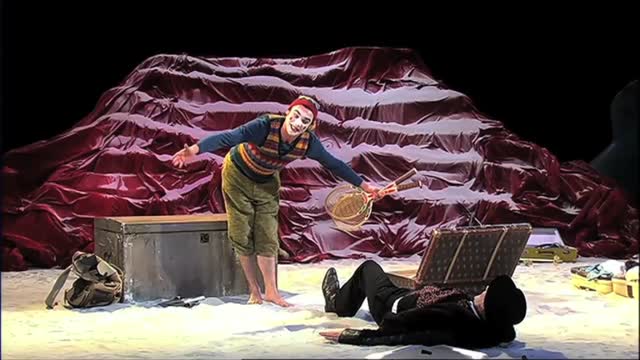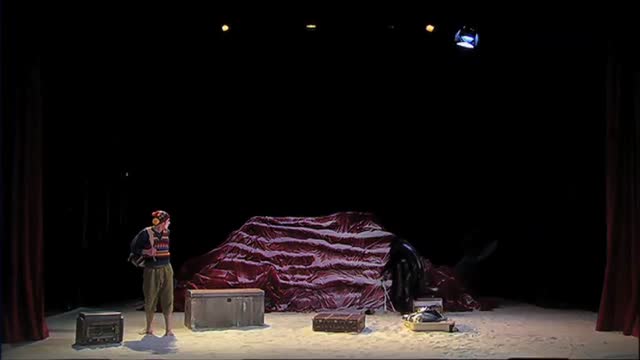"Il est nécessaire que vous m'en donniez un
portrait, qui se doit faire devant la personne
qu'on peint, afin qu'elle se connaisse, qu'elle
rougisse de ses ridicules, si elle en a, et qu'elle
se corrige." (Scène 3)
"Il faut avoir le cœur bon, de la vertu et
de la raison ; voilà ce qu'il faut, voilà ce qui
est estimable, ce qui distingue, ce qui fait qu'un
homme est plus qu'un autre." (Scène 10)
"Moi, l'esclave de ce misérable !"
(Scène 2)
"Peut-être que je serai un petit brin
insolent, à cause que je suis le maître : voilà
tout." (Scène 5)
"Quand tu auras souffert, tu seras plus
raisonnable ; tu sauras mieux ce qu'il est permis
de faire souffrir aux autres. Tout en irait mieux
dans le monde, si ceux qui te ressemblent
recevaient la même leçon que toi." (Scène
1)
"Que voulez-vous que je vous dise ? quand on
a de la colère, il n'y a rien de tel pour la
passer, que de la contenter un peu,
voyez-vous." (Scène 3)
"Si j'avais été votre pareil, je n'aurais
peut-être pas mieux valu que vous." (Scène
9)
"Tu es devenu libre et heureux, cela doit-il
te rendre méchant ? Je n'ai pas la force de t'en
dire davantage : je ne t'ai jamais fait de mal ;
n'ajoute rien à celui que je souffre." (Scène
7)
"Tu es né, tu as été élevé avec moi dans la
maison de mon père ; le tien y est encore ; il
t’avait recommandé ton devoir en partant ; moi-même
je t’avais choisi par un sentiment d’amitié pour
m’accompagner dans mon voyage ; je croyais que tu
m’aimais, et cela m’attachait à toi." (Scène
9)