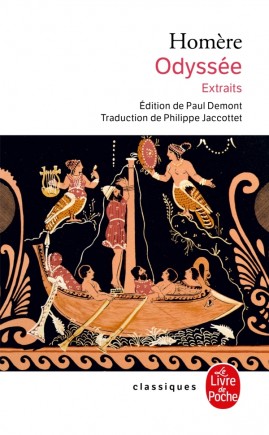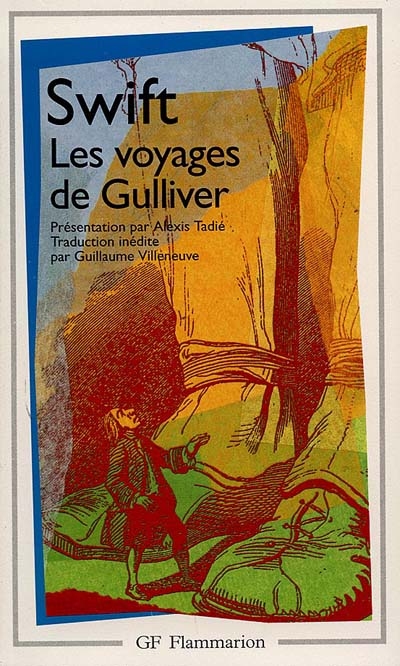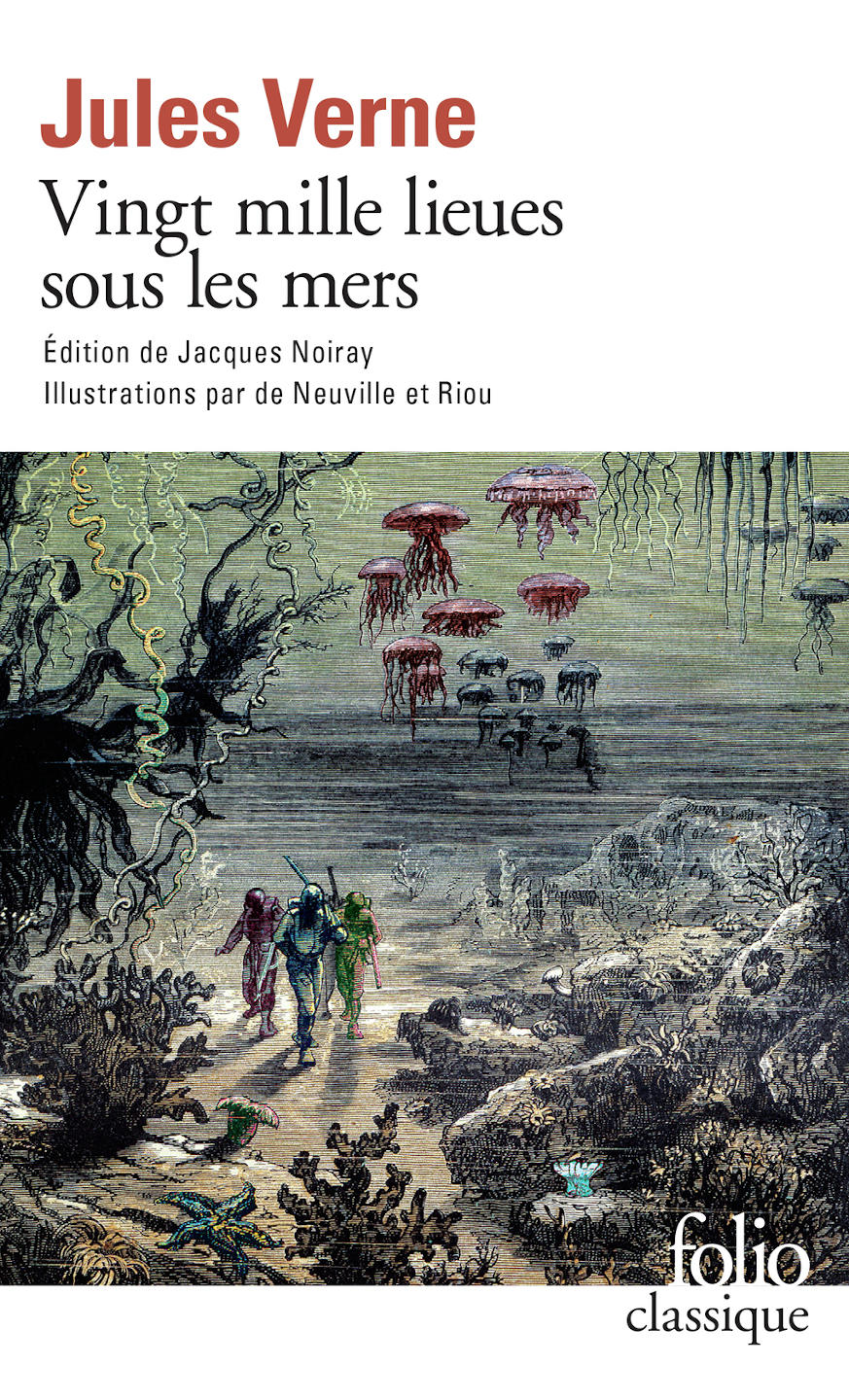Séance 04
L'exotisme
Oral
Quelle est la définition d'exotisme ?
Observation
Comment ces tableaux représentent-ils l'exotisme ?
Prolongement
Selon vous, qu'est-ce qui nous attire autant dans l'exotisme ?
Document A

Delacroix, Femmes d'Alger dans leur appartement, 1834.
Document B

Gauguin, Fatata te Miti, Au bord de la mer, 1892.