Séance 01
Matin brun
Observation
1. Quelle est, selon vous, la morale de ce court métrage ?
2. Quels détails vous ont fait réfléchir ?
3. Que représentent, selon vous, les animaux ?

Prolongement
Si les animaux colorés (pas les bruns) de ce court métrage pouvaient parler, que diraient-ils à leurs maîtres ?
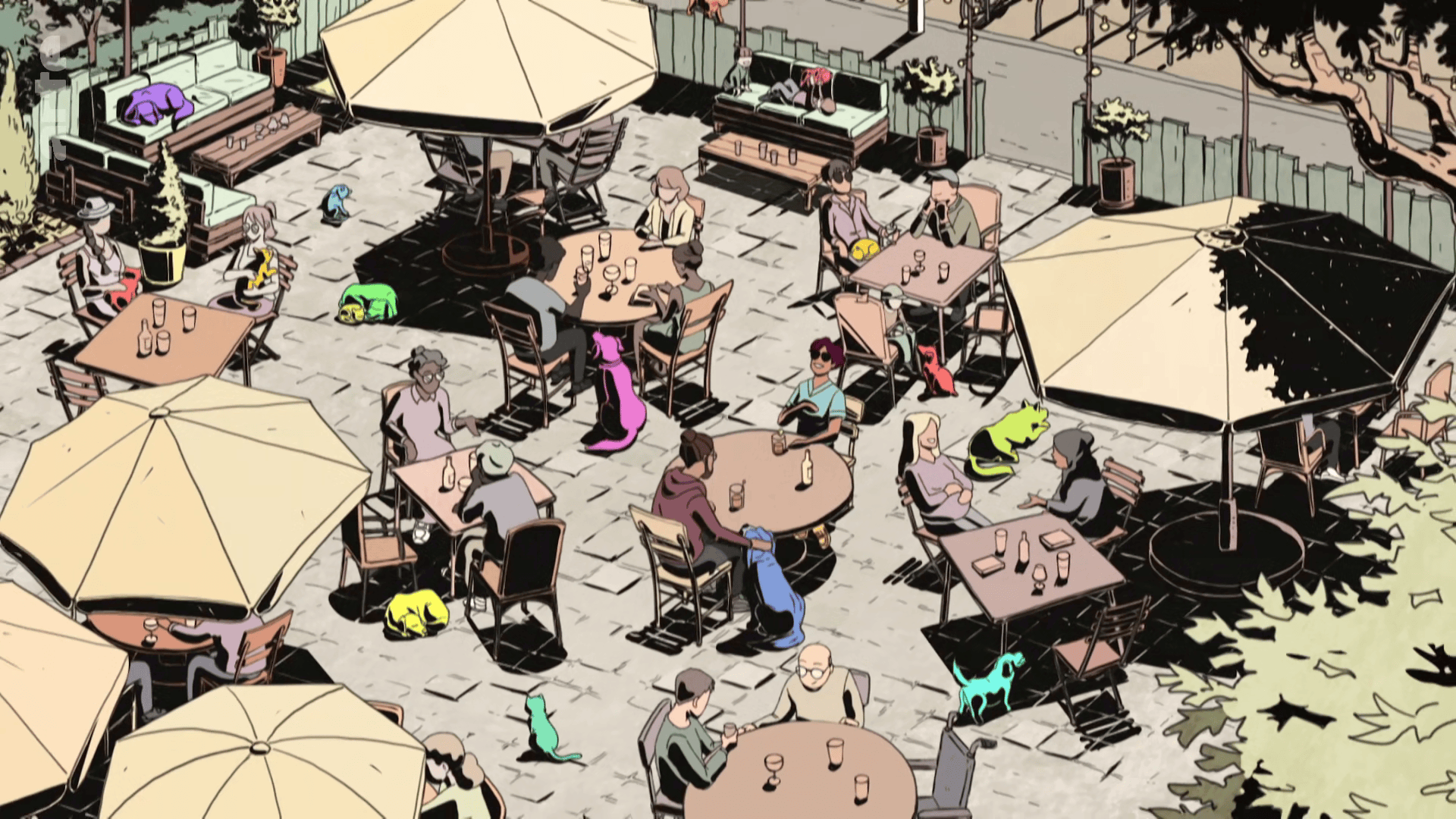
|
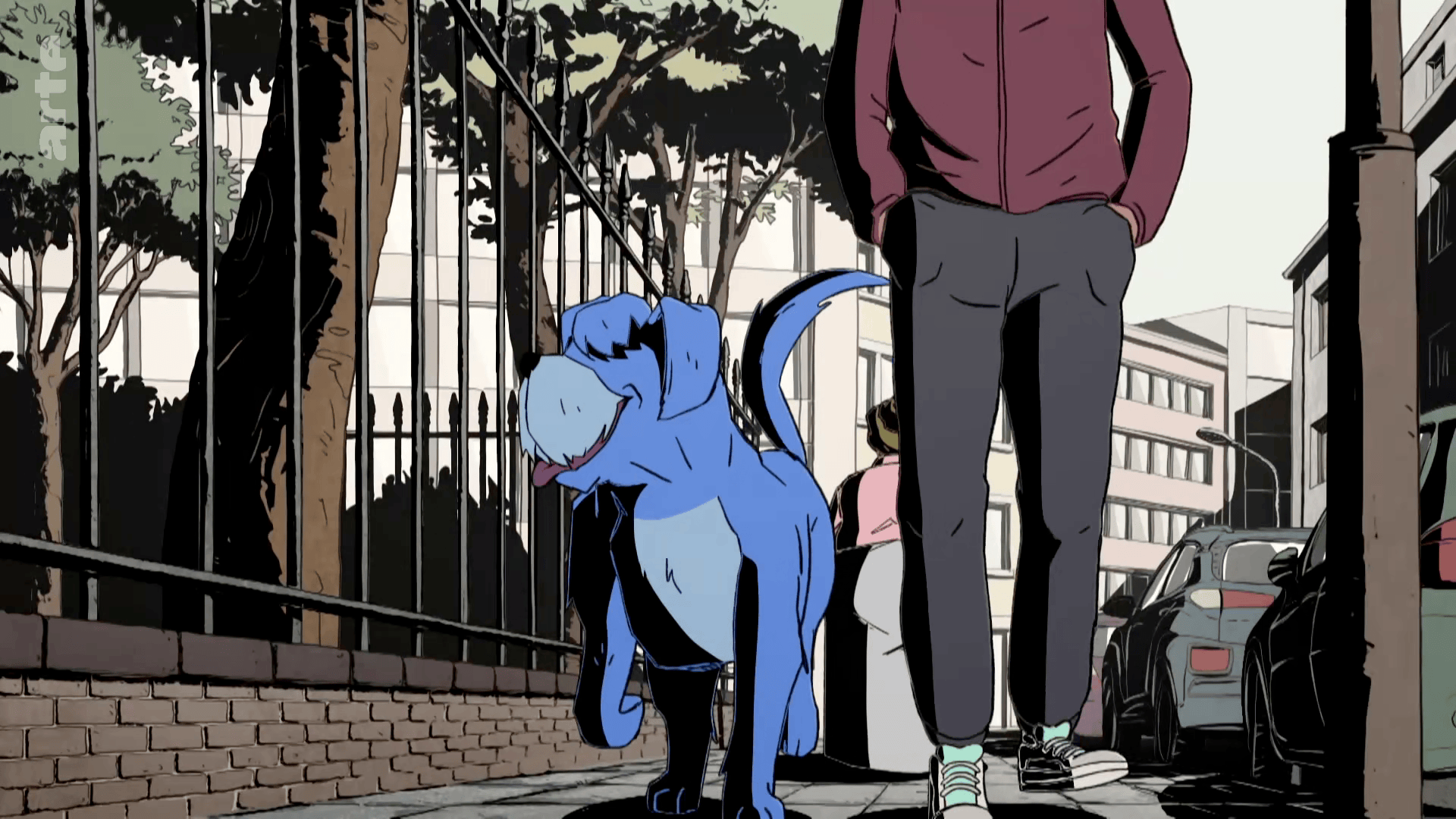
|
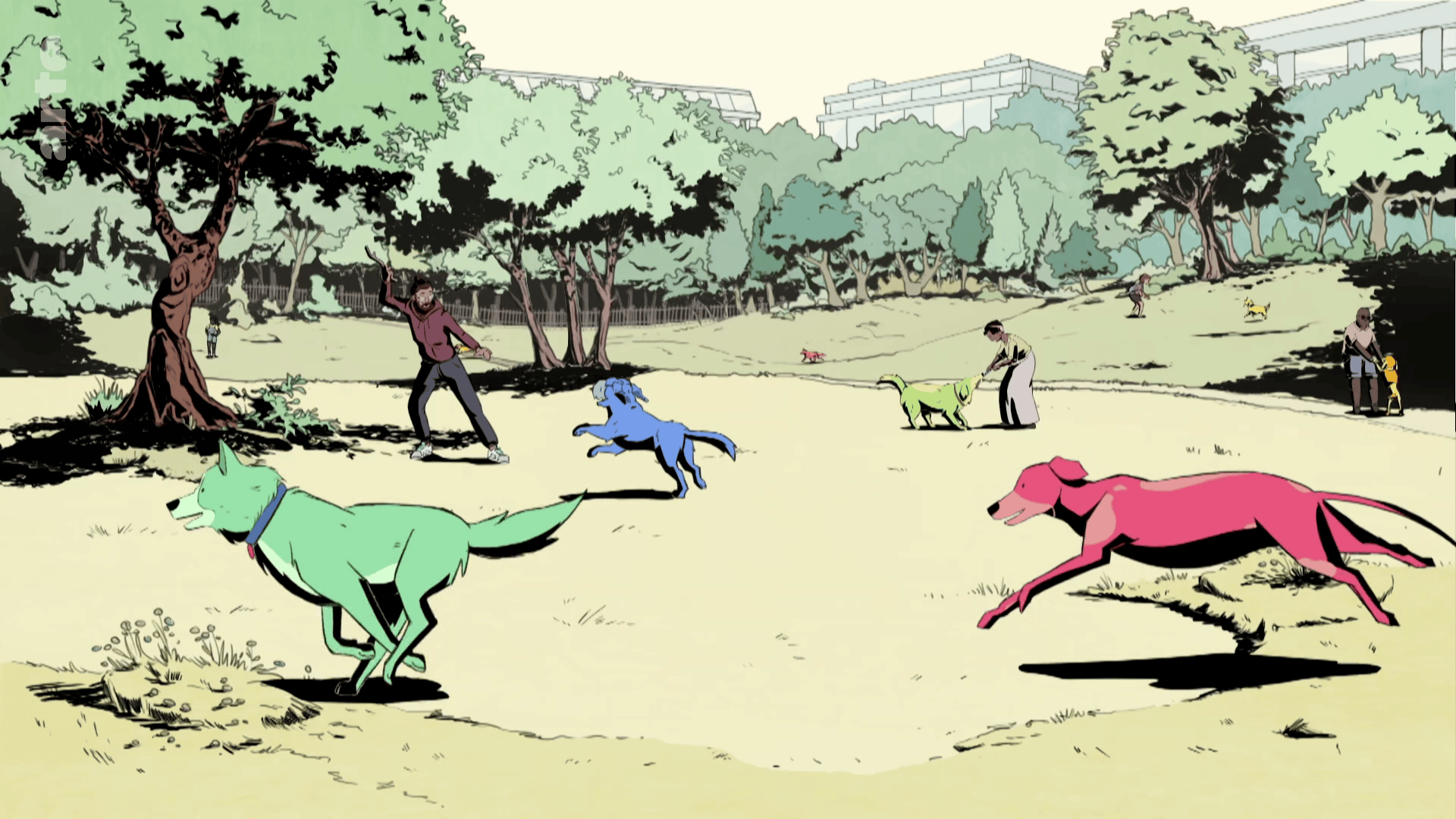
|
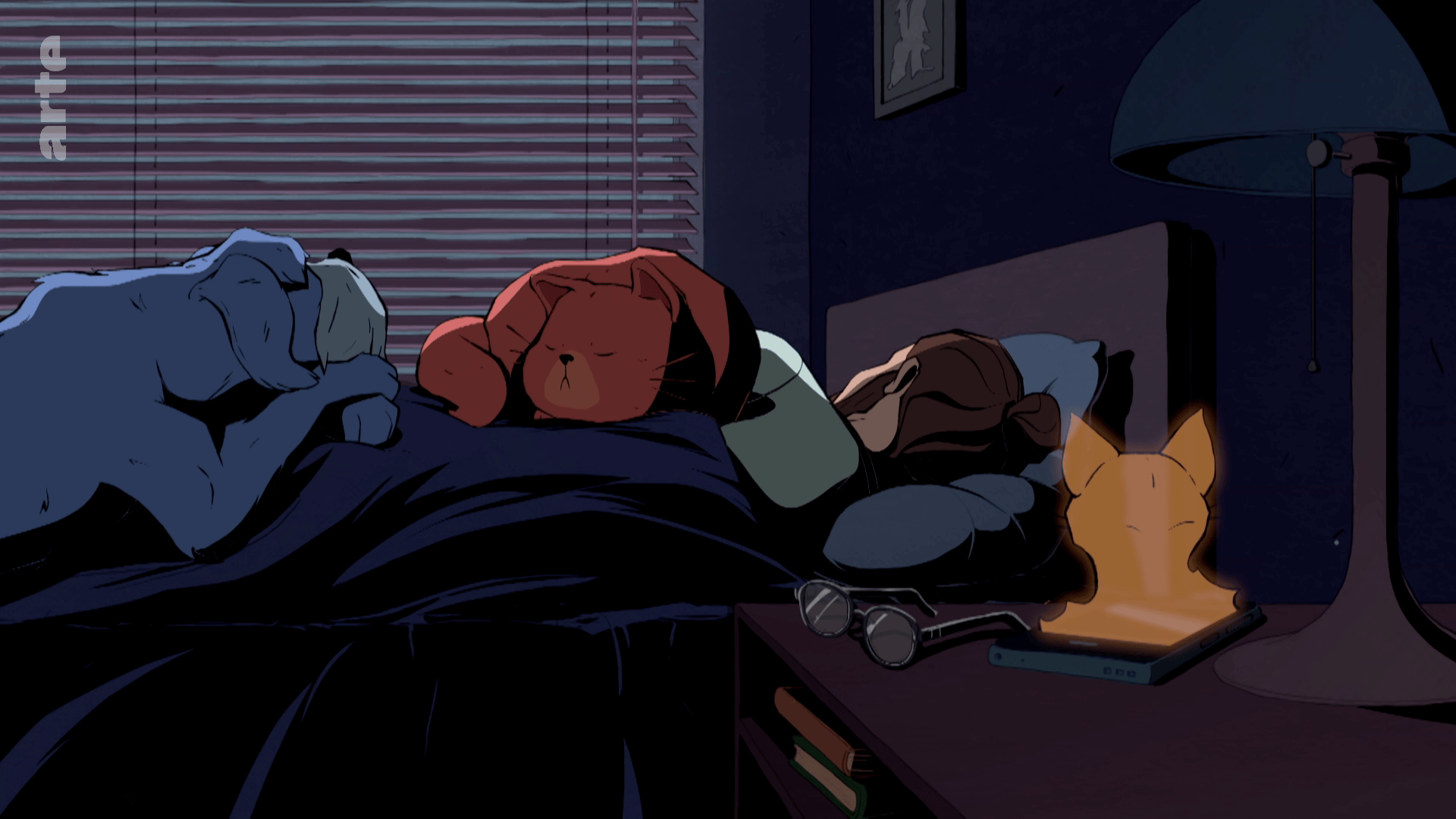
|
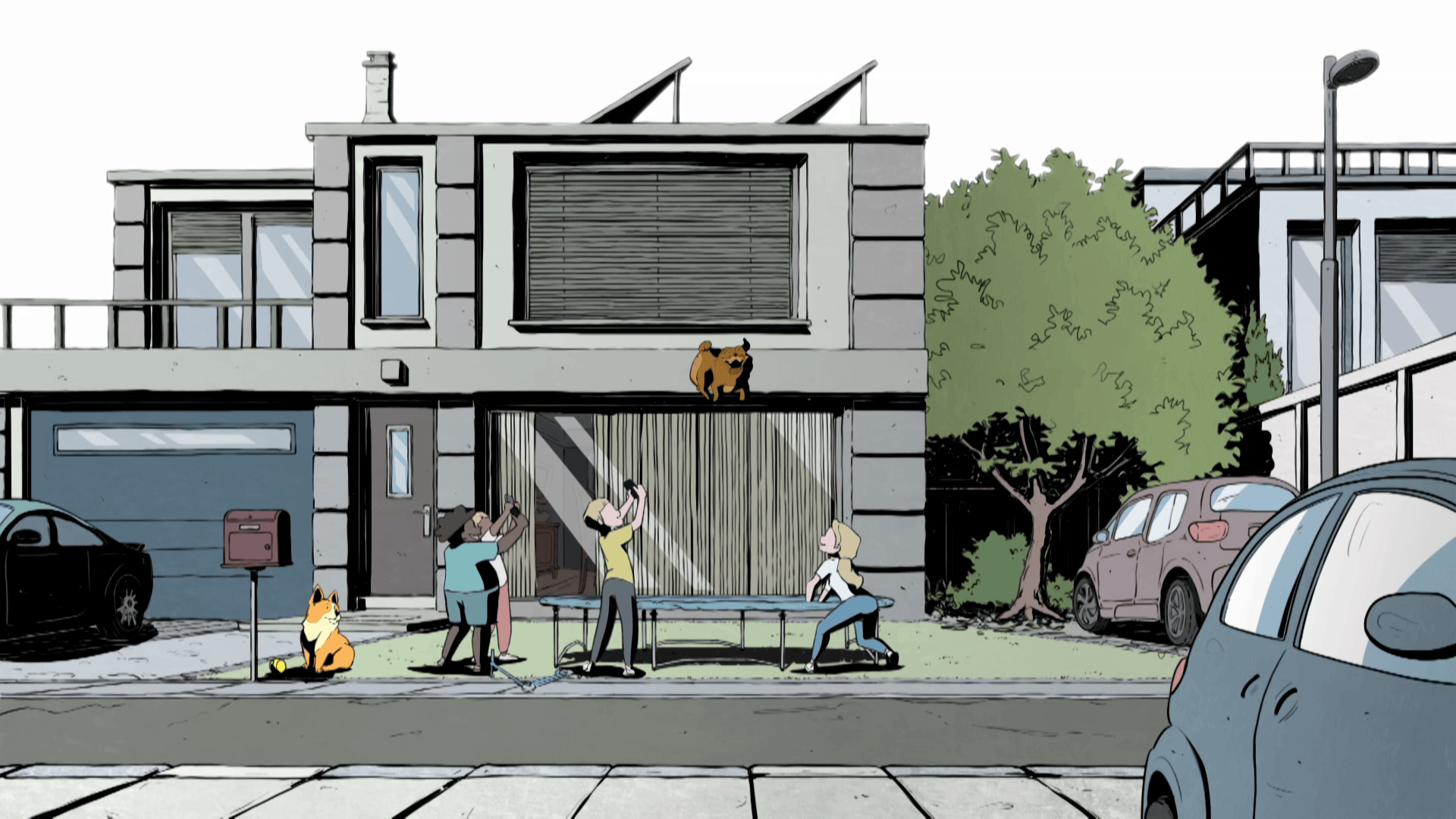
|

|
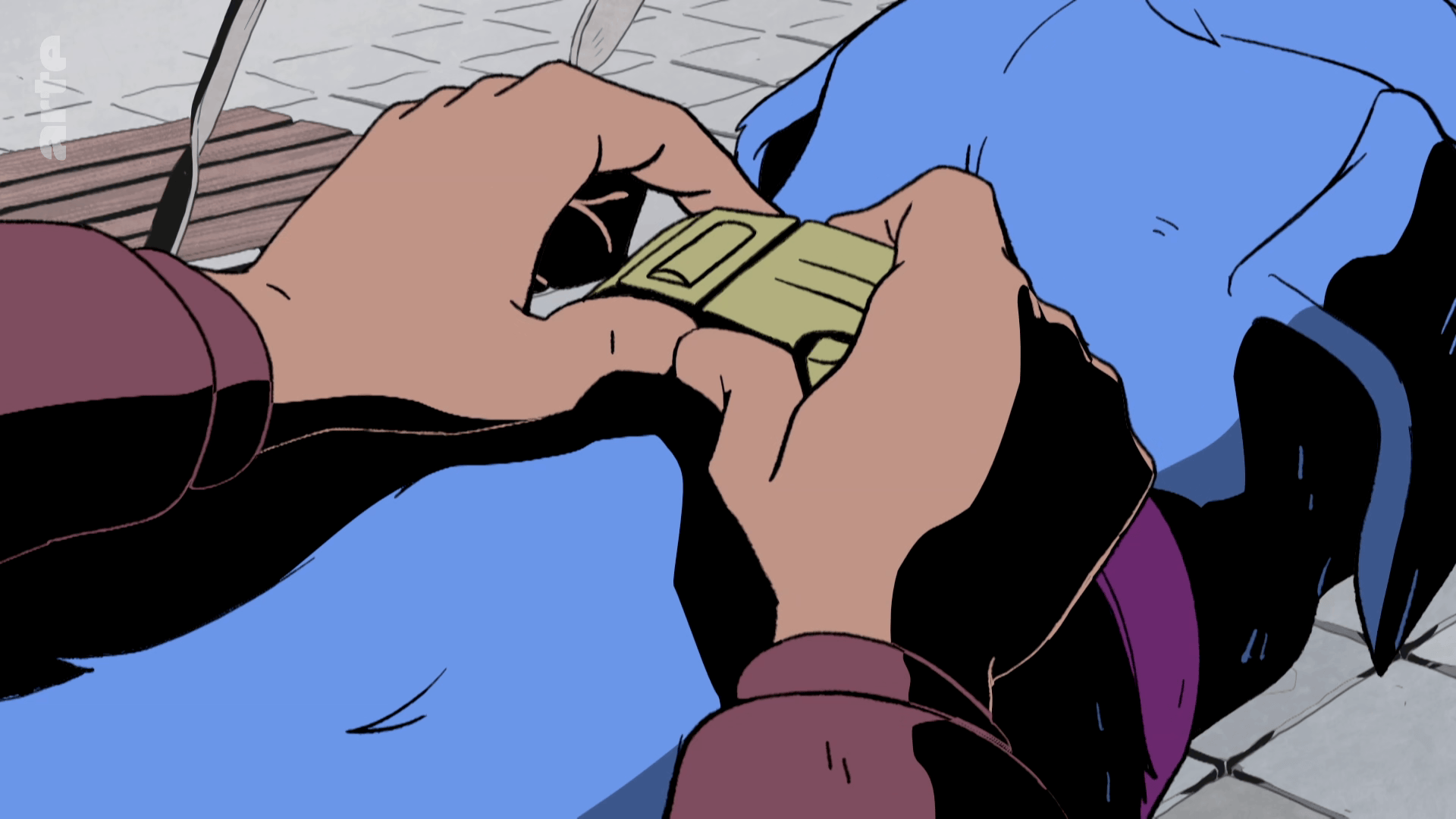
|
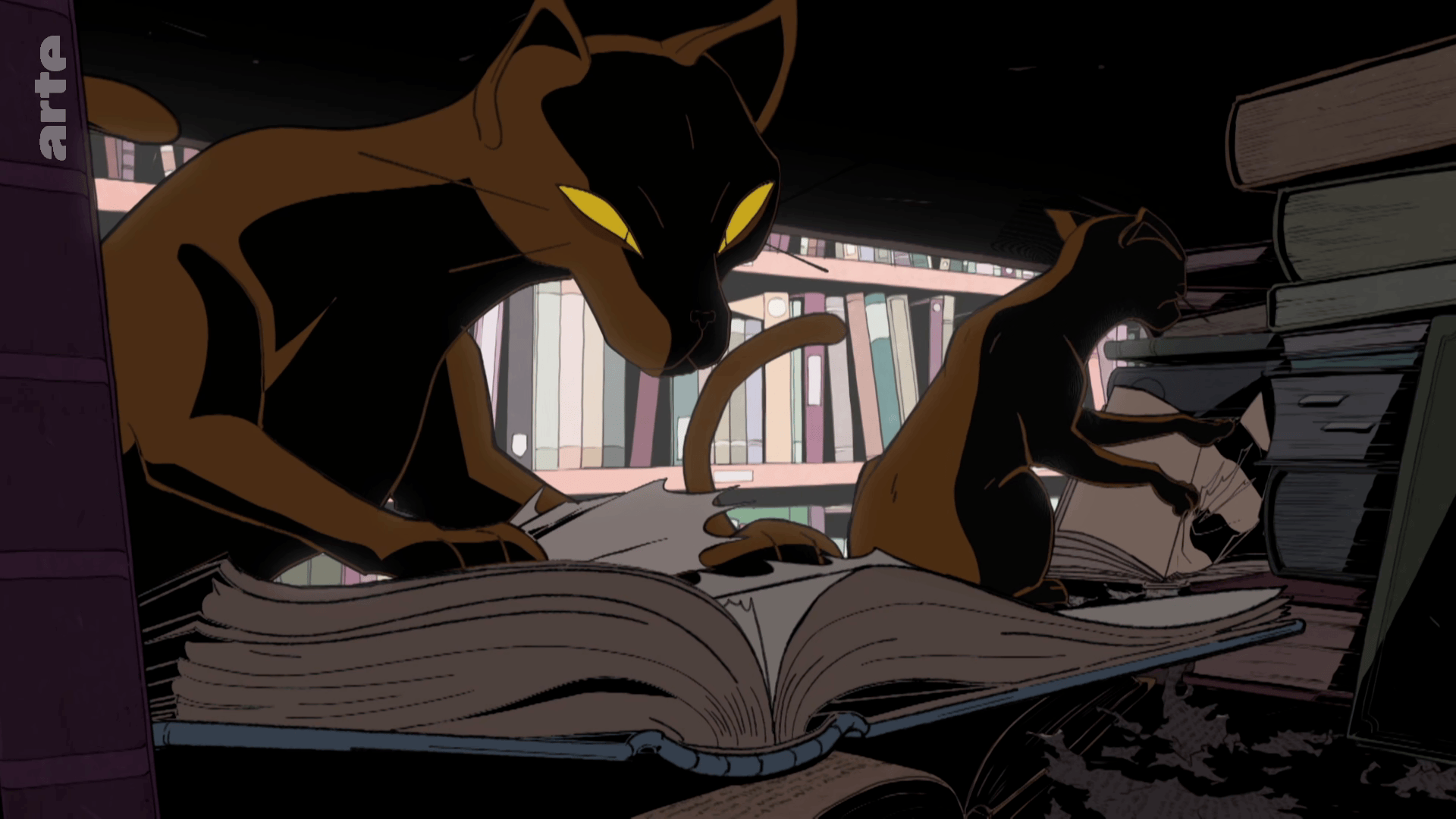
|
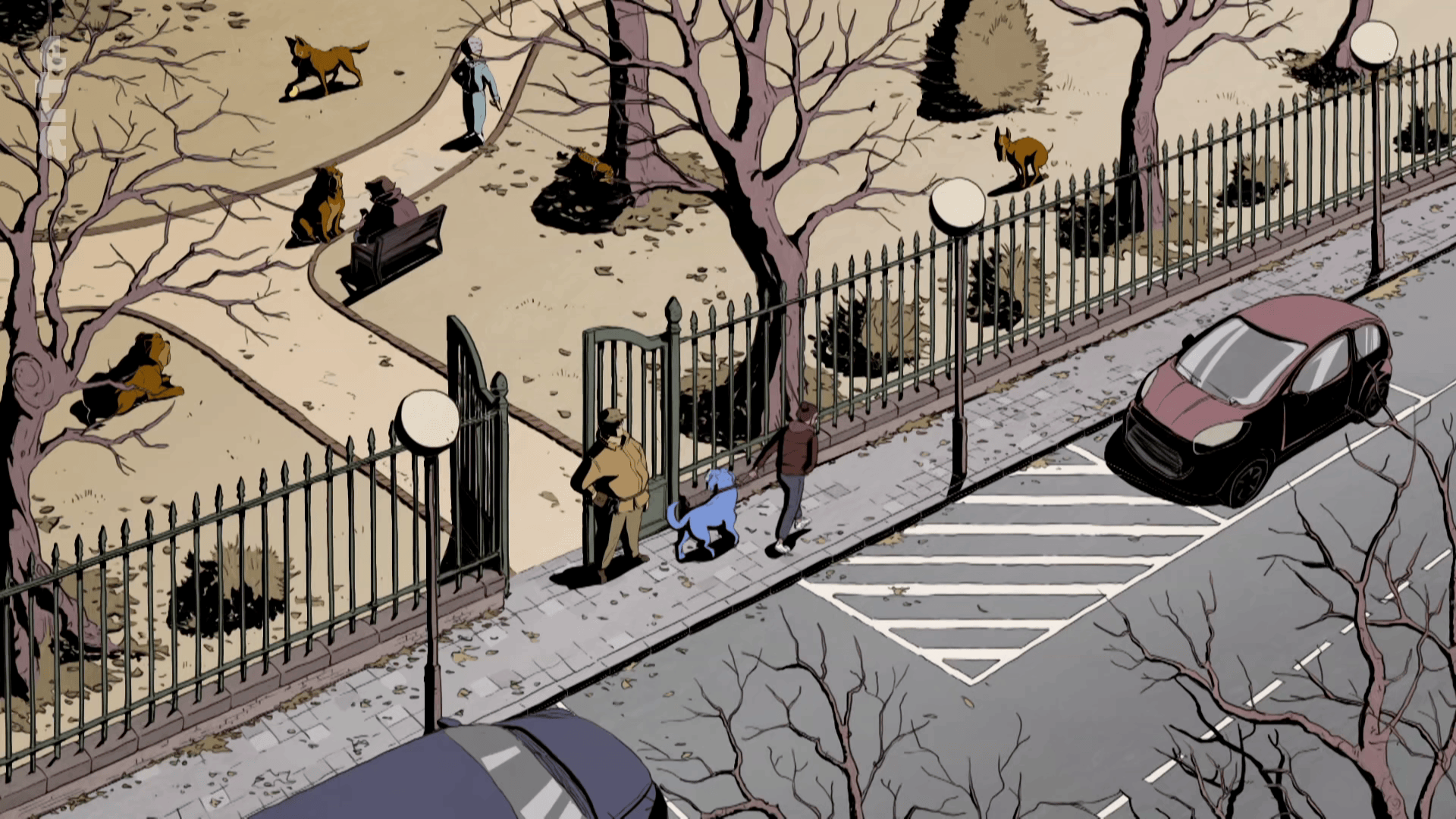
|

|
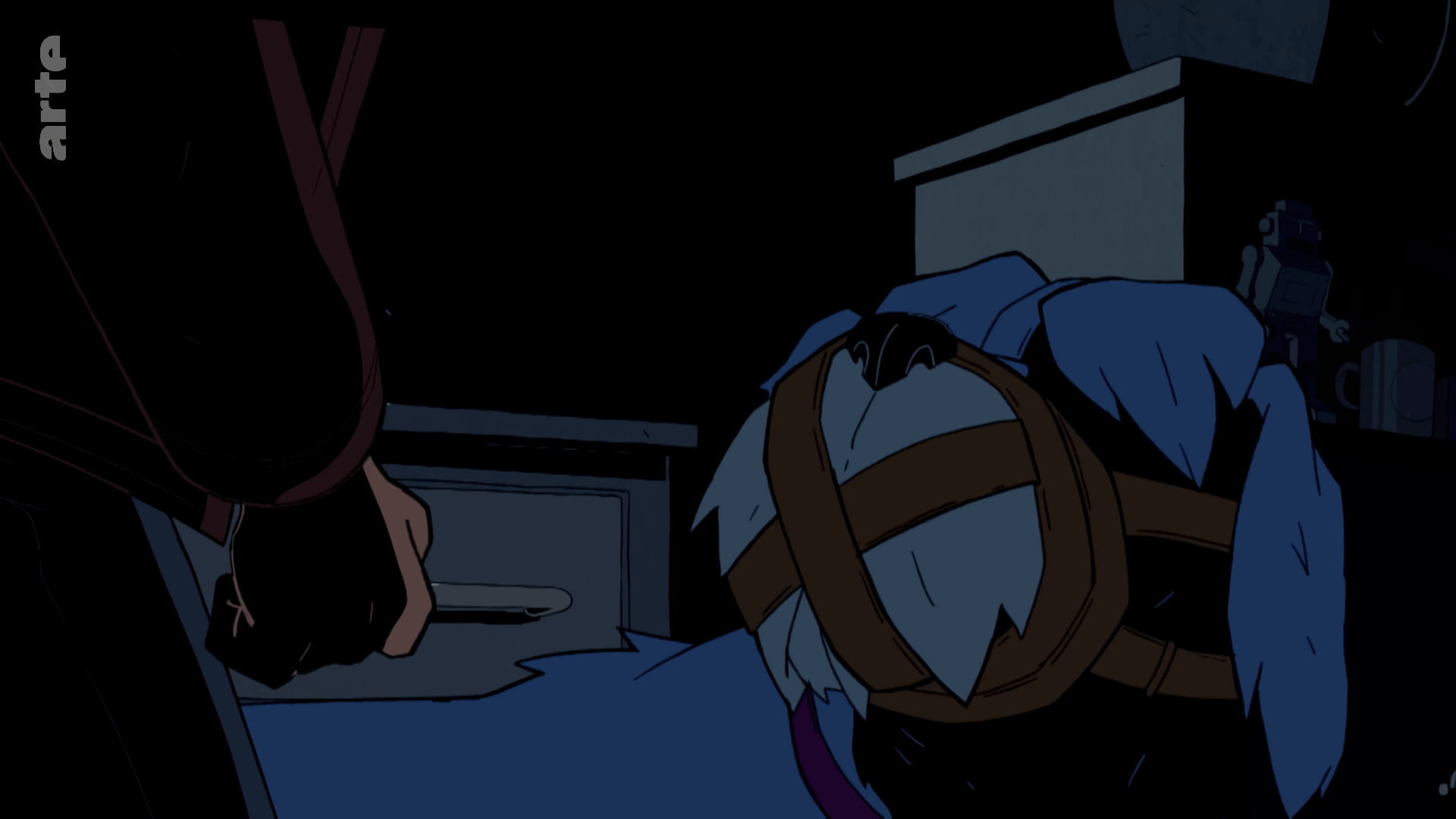
|
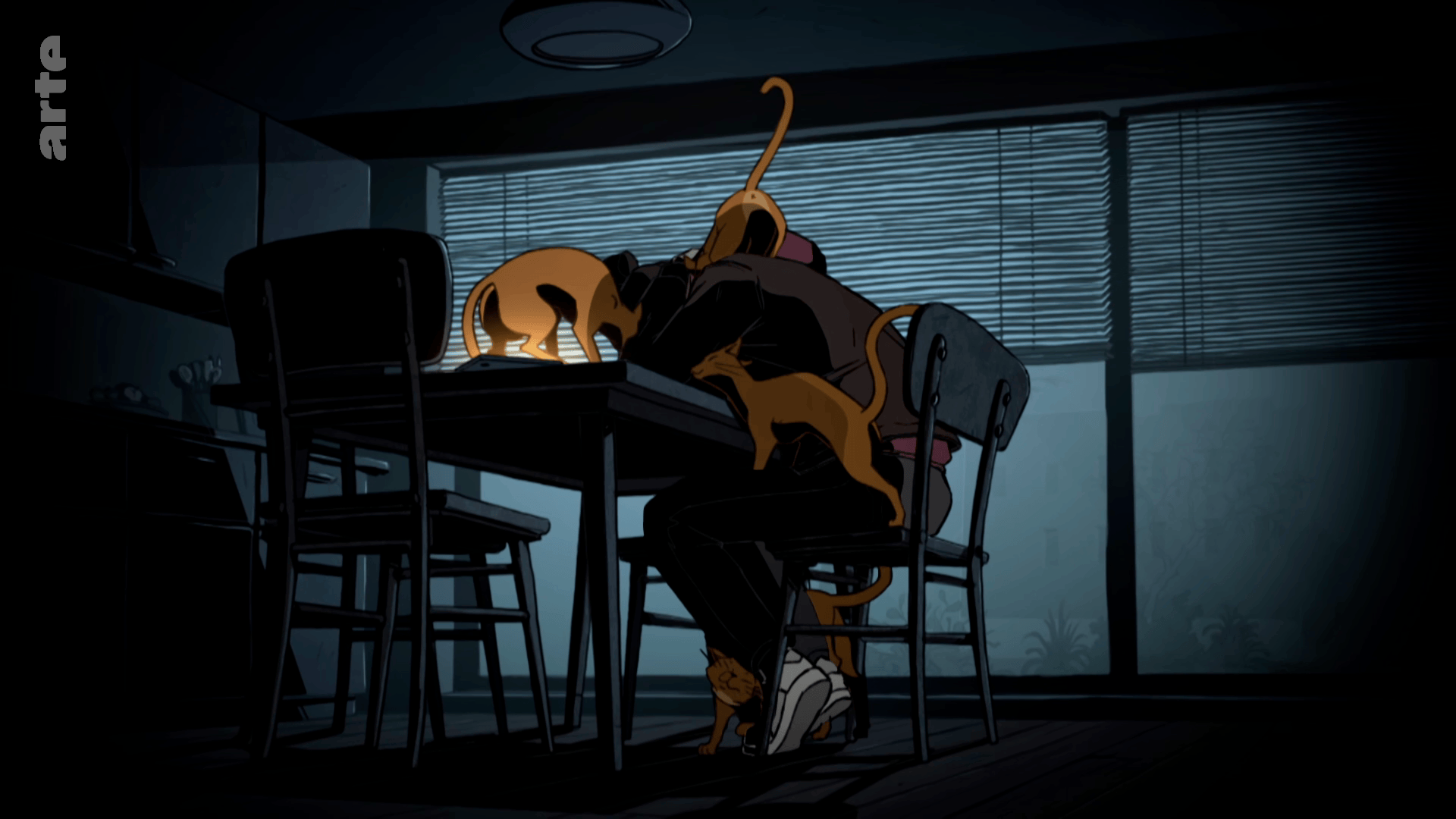
|
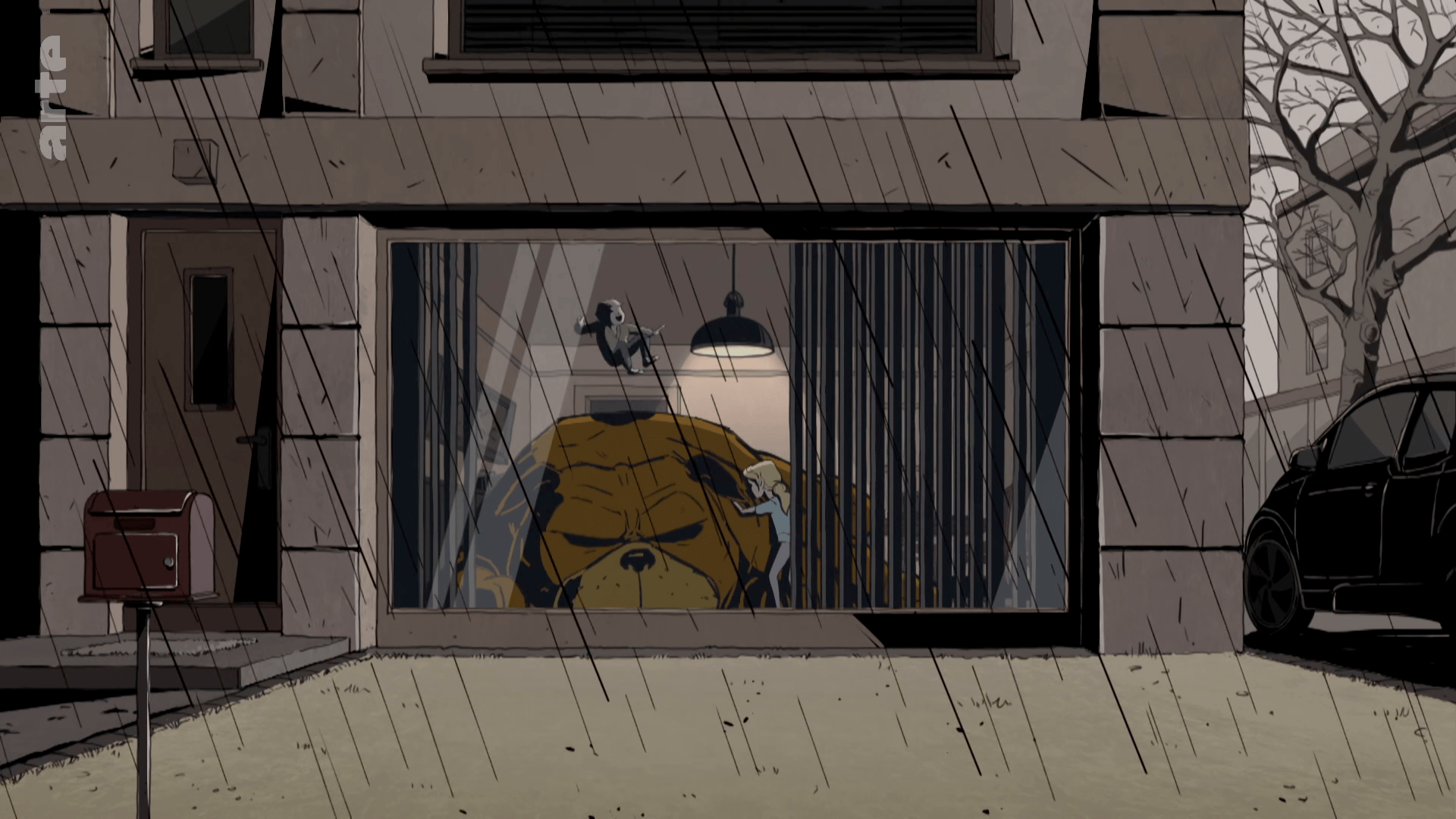
|
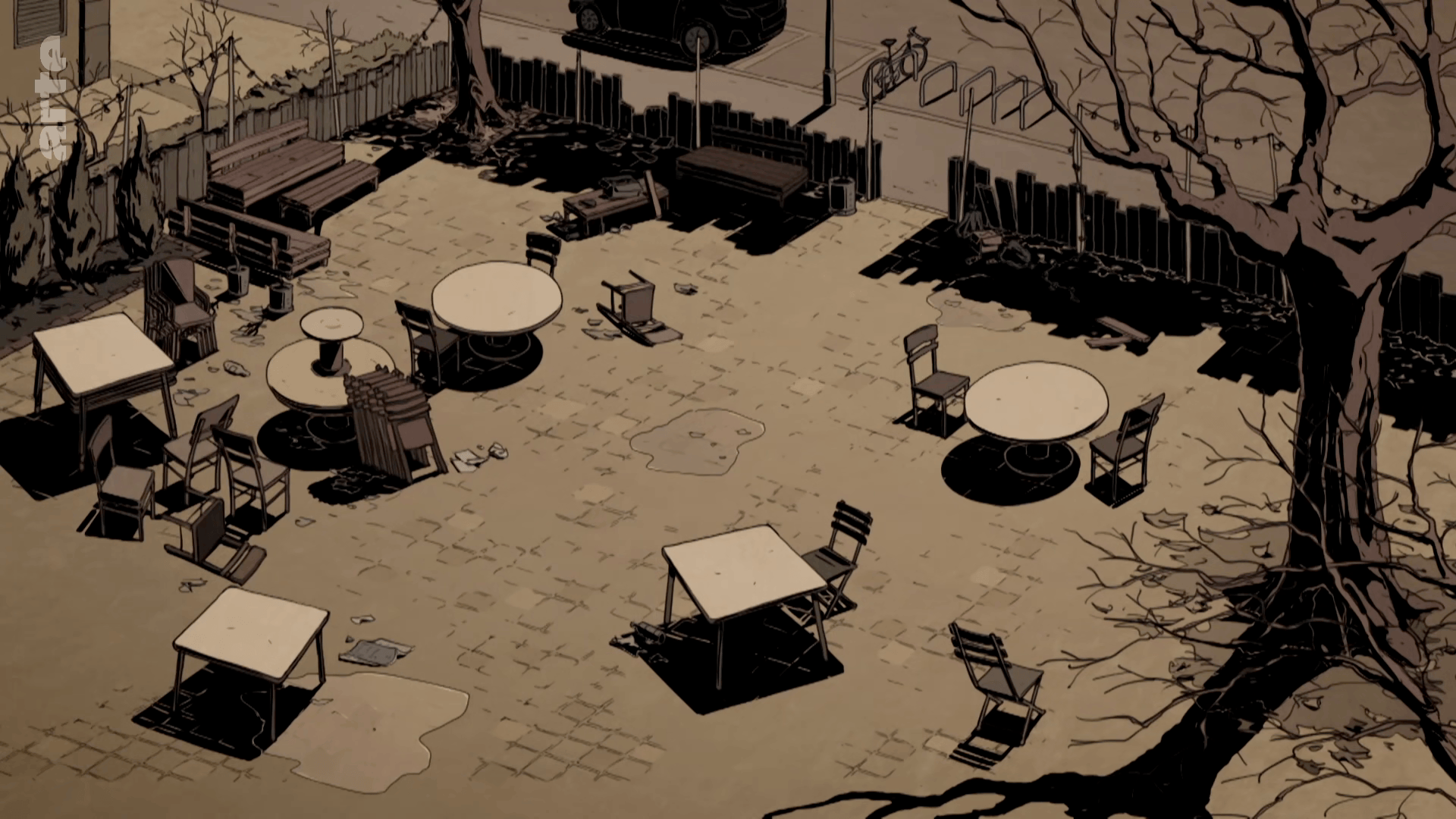
|
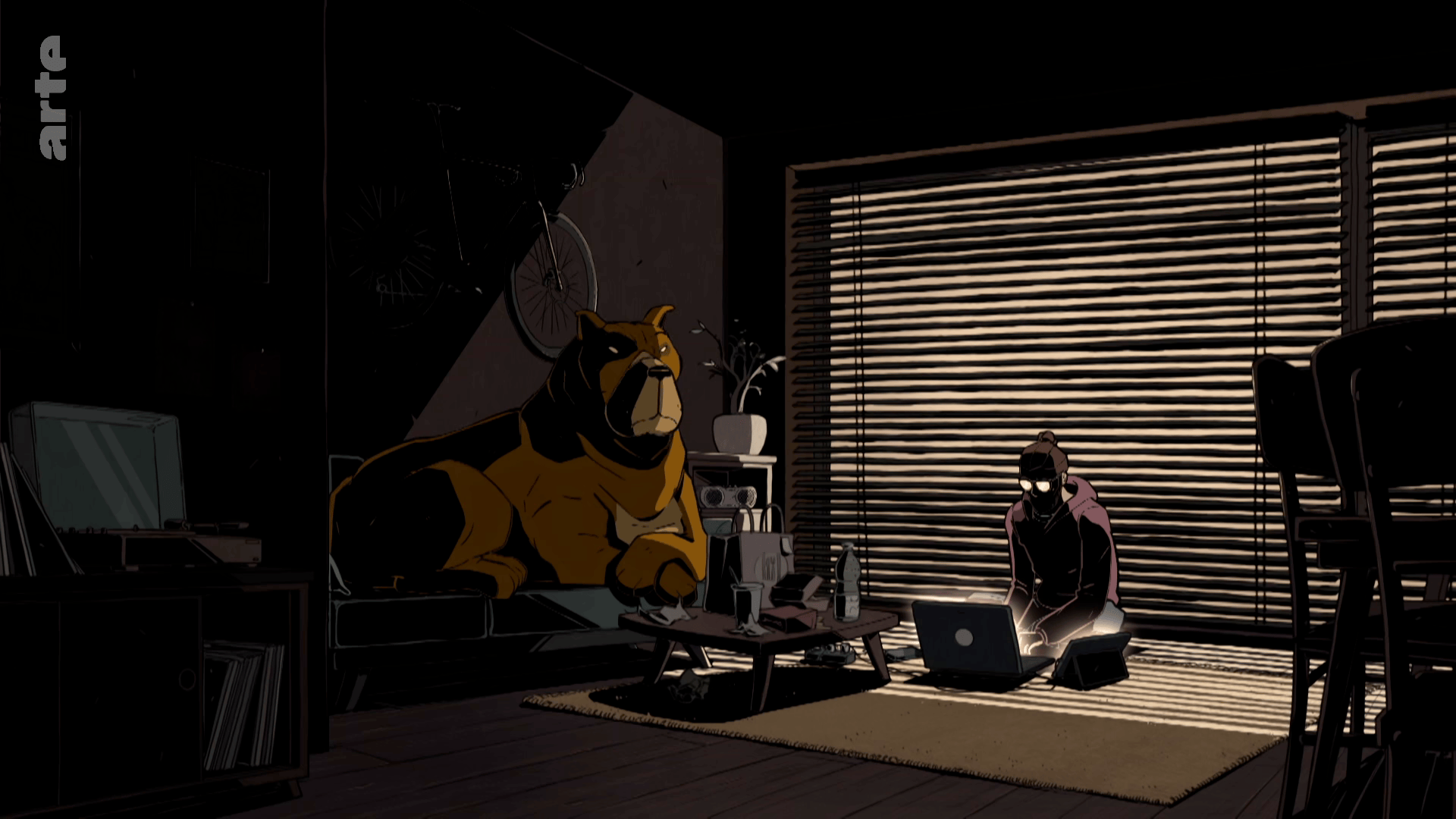
|

|
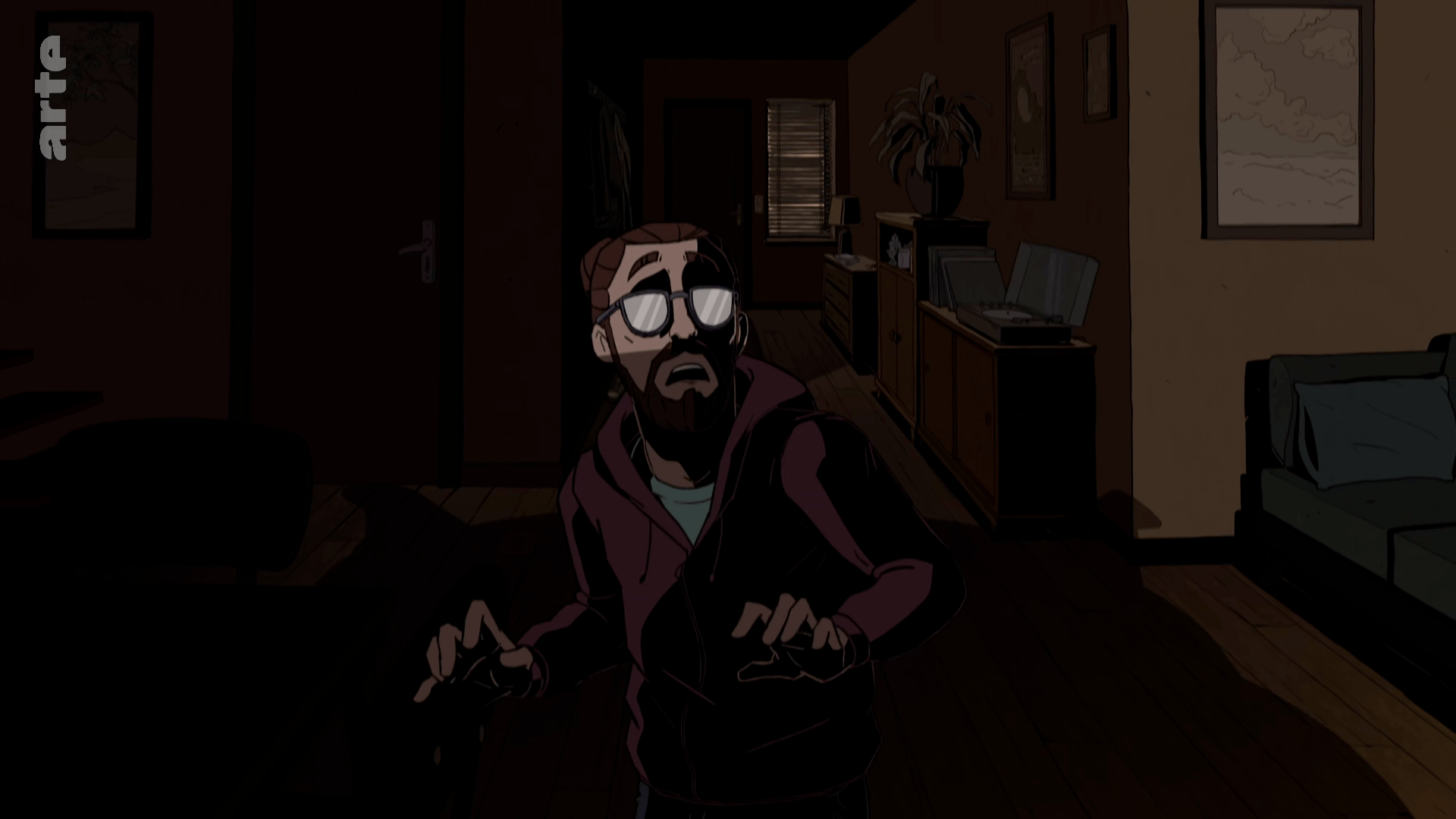
|

|
Carlo Vogele, Matin Brun, 2025.

