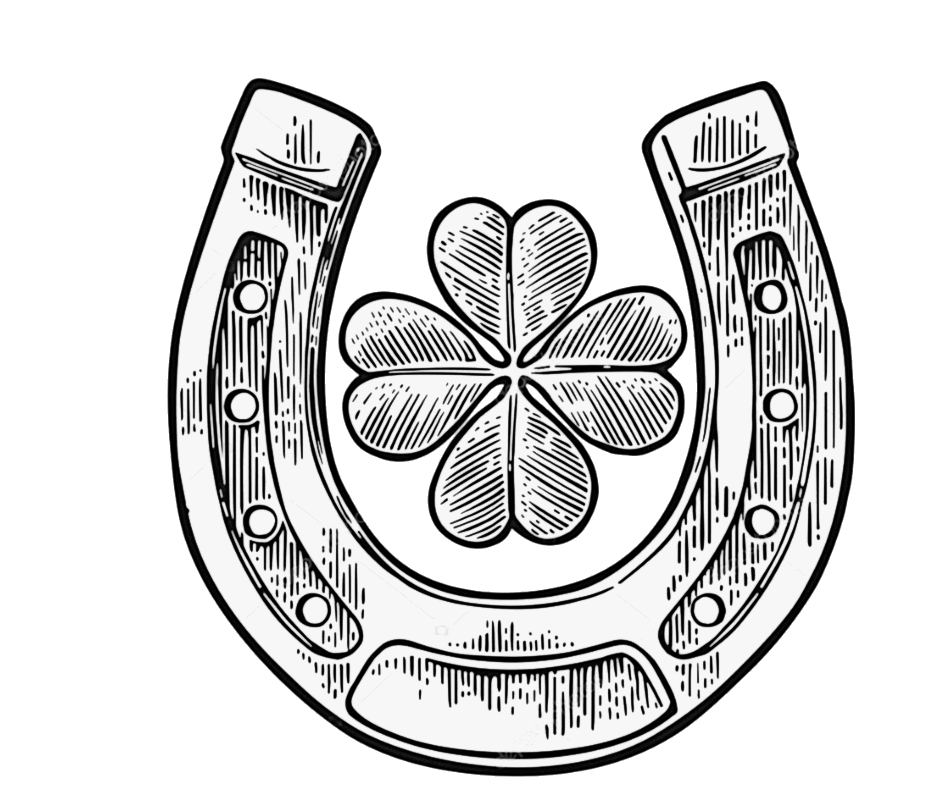Et pour cette semaine...
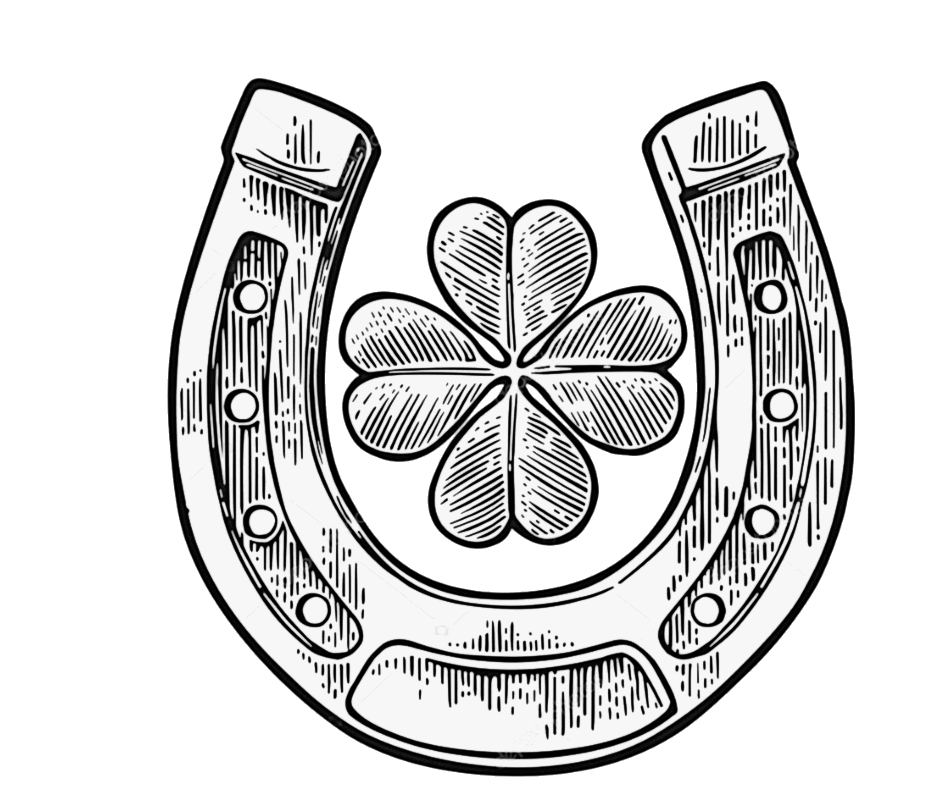
Renaud, la parole est à vous.
« Oserais-je exposer ici la plus grande, la plus importante, la plus utile règle de toute l’éducation ? Ce n’est pas de gagner du temps, c’est d’en perdre. » Consacrer du temps pour la présentation de la consigne, c’est s’assurer que les élèves l’ont mieux comprise, une fois en autonomie. L’énoncé de la consigne gagne à respecter trois repères : des termes univoques, des verbes d’action et des critères de réussite. Le but ensuite est de ne jamais laisser des élèves débuter un travail en groupe sans être certain qu’ils maitrisent la consigne. Ce processus de dévolution est facilité par les étapes suivantes : après avoir obtenu l’écoute, énoncer la consigne et la justifier (pour expliciter les apprentissages en jeu et l’objectif de confrontation des idées propre au travail en groupe) ; la présenter oralement et de manière écrite (au tableau, sur le support de travail…), pour que chacun puisse y revenir plusieurs fois ; préciser les durées de travail ; répondre aux questions des élèves ; la faire reformuler par un ou deux élèves volontaires pour s’assurer d’une compréhension partagée ; la compléter si besoin.
Connac, S. (2017). La coopération entre élèves. Réseau Canopé.
L’un des points de convergence des recherches [...] porte sur les difficultés éprouvées par certains élèves pour identifier les enjeux cognitifs des tâches scolaires ; les moins performants d’entre eux réduisent souvent leur visée à une réalisation de la tâche dans laquelle elle s’épuise. Le plus souvent enfermés dans une logique du faire et guidés par la recherche de la réussite immédiate, ils traitent les tâches scolaires sans chercher à en saisir la signification, c’est-à-dire ce qu’elles leur permettent d’apprendre. C’est pourquoi ces élèves ont de la peine à transférer leurs connaissances d’un domaine à un autre, ou, à l’inverse, surgénéralisent les procédures qu’ils maîtrisent et les appliquent, sans analyse préalable, à toutes les situations. Pour comprendre en effet qu’un problème à résoudre ressemble à d’autres problèmes déjà traités auparavant, il faut que l’élève soit capable et s’autorise à faire circuler les savoirs et les activités d’un moment et d’un objet scolaire à un autre. Pour cela, il faut au préalable qu’il ait constitué le monde des objets scolaires comme un monde d’objets à interroger sur lesquels il peut (et doit) exercer des activités de pensée et un travail spécifique. Nous nommons « attitude de secondarisation » , cette attitude que certains élèves ont des difficultés à adopter.
Bautier, E., & Goigoux, R. (2004). Difficultés d’apprentissage, processus de secondarisation et pratiques enseignantes : une hypothèse relationnelle. Revue Française de Pédagogie, 148(1), 89‑100. https://doi.org/10.3406/rfp.2004.3252
Camille, la parole est à vous.