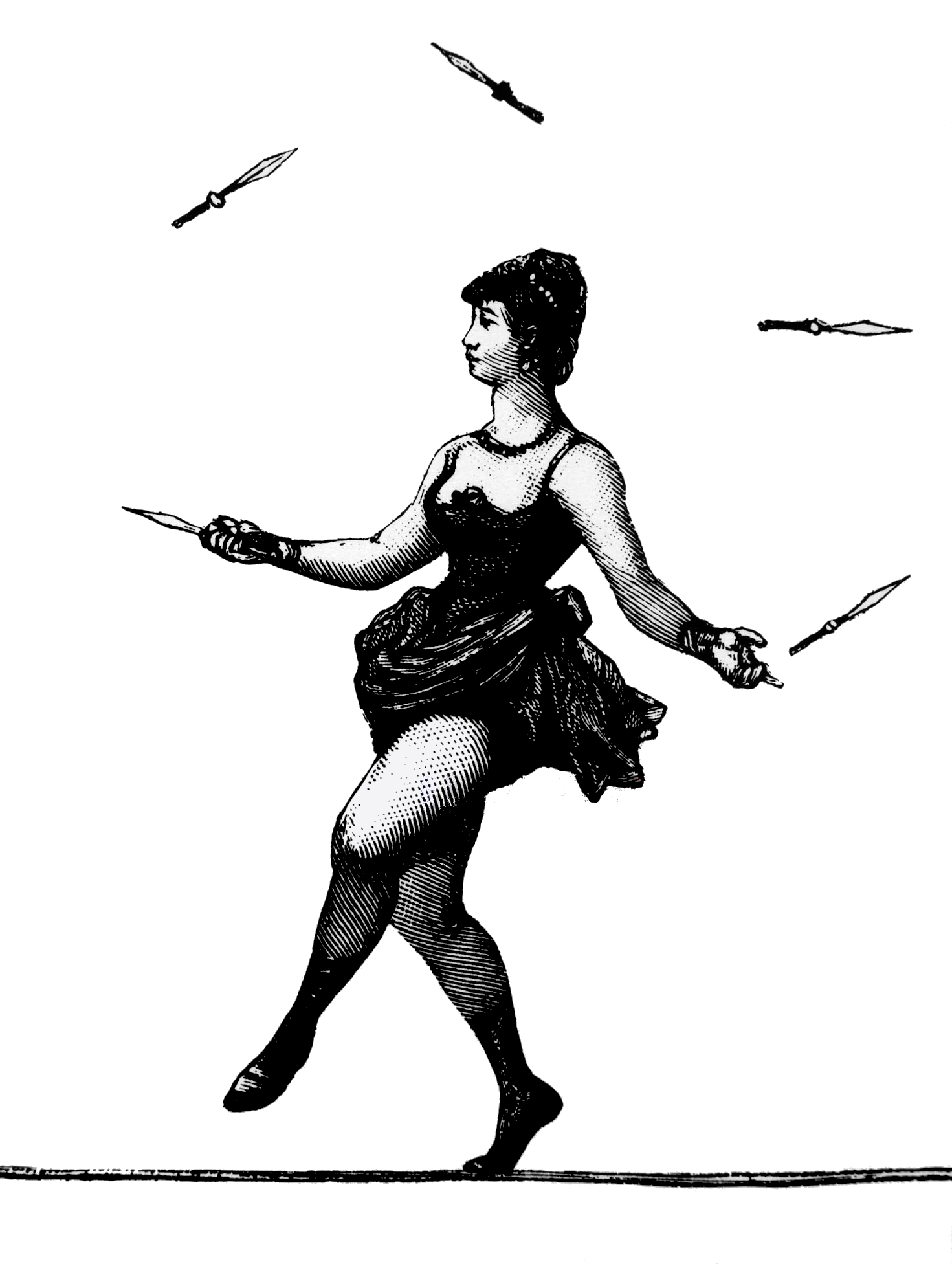Les annotations portent significativement plus sur "la forme" que sur
"le fond". Plus de 60 % des items en effet portent sur la narration —
la langue, te code, le style, la syntaxe... Moins de 40 % des items
ont trait à la fiction — l'histoire, la logique des actions, le
contenu... Le privilège important accordé à la manière d'écrire au
détriment de ce qui est écrit, l'attention focalisée sur le comment
plutôt que sur le quoi, témoignent tout d'abord d'une bonne
intégration des données de l'institution. Pour celle-ci en effet, la
rédaction, ex composition française, est le couronnement des
activités de français. Toutes les matières, grammaire, orthographe,
vocabulaire, lecture même (et surtout), trouvent en la rédaction leur
aboutissement "naturel" : la rédaction est l'exercice où tous les
apprentissages s'investissent. C'est là, sans doute, l'explication
principale: annotant plutôt la manière, les correcteurs retrouvent
spontanément ce qu'ils ont pour métier d'enseigner. De façon
spéculaire, la rédaction justifie que l'on fasse de la grammaire, de
l'orthographe, du vocabulaire.
Halté, J. (1984). L’annotation des copies, variété ou base du
dialogue pédagogique. Pratiques, 44(1), 61‑69.
https://doi.org/10.3406/prati.1984.2463