Faisons connaissance

Ecole normale supérieure. Promotion de 1878. Disponible à : https://archive.org/details/ENS01_PHOD_2_1878_5
9h-10h25 : Les pratiques et les programmes
10h35-12h : Les textes du lecteur
13h30-14h55 : Le passage à l'écriture
15h05-16h30 : Toutes les formes de l'écrit

Ecole normale supérieure. Promotion de 1878. Disponible à : https://archive.org/details/ENS01_PHOD_2_1878_5
Observez les pages de manuels suivantes :
Deschellette, É., Jougla, S., Simonot, M., Bertagna, C., & Carrier-Nayrolles, F. (2022). Fleurs d'Encre. Français 5e, cycle 4 (Nouvelle éd. 2022). Hachette éducation. pp. 122-135.
Quelles réflexions vous inspirent ces pages de manuel ? Justifiez vos remarques par des analyses précises.
"À plat ventre sur la plus grosse branche de tilleul, Colin, immobile comme un chasseur à l'affût, observe le manège du chat Tibère. Tapi sous un banc de l'allée où les miettes de pain font le régal des moineaux, Tibère attend patiemment que ceux- ci s'approchent suffisamment de lui pour bondir sur la proie qu'il convoite".

|
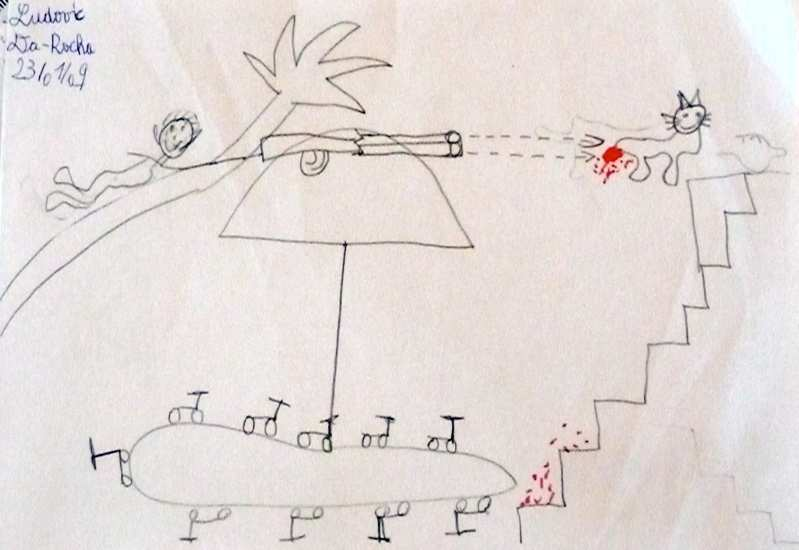
|

|
Paour, J.-L. Cèbe, S. (2011). Améliorer la compréhension de l'écrit : apports d'une conception constructivisite de l'apprentissage et du développement. Travaux & documents, 2011, 38, pp. 121-134.
— Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé au prince, hein ? J'attends !
Ces parents qui jamais, jamais, quand ils lui lisaient un livre ne se souciaient de savoir s'il avait bien compris que la Belle dormait au bois parce qu'elle s'était piquée à la quenouille, et Blanche-Neige parce qu'elle avait croqué la pomme. (Les premières fois, d'ailleurs, il n'avait pas compris, pas vraiment. Il y avait tant de merveilles, dans ces histoires, tant de jolis mots, et tellement d'émotion ! [...])
— Je répète ma question : qu'est-ce qui est arrivé à ce prince quand son père l'a chassé du château ?
Nous insistons, nous insistons. Bon Dieu, il n'est pas pensable que ce gosse n'ait pas compris le contenu de ces quinze lignes ! Ce n'est tout même pas la mer à boire, quinze lignes !
Nous étions son conteur, nous sommes devenu son comptable.
Pennac, D. (1995). Comme un roman. Gallimard.
Le concept de rapport à en didactiques désigne la relation (cognitive mais aussi socio-psycho-affective) qu'entretient l'apprenant aux contenus et qui conditionne en partie l'apprentissage de ces derniers : un rapport aux contenus qui ne correspond pas à celui que l'école envisage peut rendre difficile l'accès aux contenus enseignés. Ce rapport à peut devenir lui-même un contenu d'enseignement, au même titre qu'un comportement ou qu'une attitude : dans la mesure où un apprenant peut n'avoir pas spontanément un rapport aux contenus d'enseignement qui en favorise l'apprentissage scolaire, on peut penser que c'est le rôle de l'école de l'aider à en construire un qui soit plus adéquat. Pour prendre un exemple, ce peut être un contenu d'enseignement du français au lycée que d'amener l'élève à un rapport distancié à la lecture d'un texte littéraire - rapport distancié qui, notamment, minore l'identification aux personnages au profit d'une attention à leur construction formelle.
Y. Reuter, C. Cohen-Azria, B. Daunay, I. Delcambre & D. Lahanier-Reuter (2013). Dictionnaire des concepts fondamentaux des didactiques. Louvain-la-Neuve: De Boeck Supérieur.
L'autobiographie de lecteur peut donc se définir comme une mise en discours de la manière dont les individus ont appris à lire, de leur rapport à la lecture et à la littérature – et/ou plus en général à la littératie – et de leur représentation des textes qu'ils lisent. Elle touche la partie de l'identité du sujet qui s'est formée au travers des pratiques de la lecture, et peut révéler à la fois une partie de sa subjectivité – entendue au sens d'opinions, d'intérêts personnels, d'expériences et d'émotions – et son positionnement socioculturel par rapport aux valeurs, jugements et représentations partagés sur la lecture et les textes.
Bemporad, C. (2019, 1 janvier). L'autobiographie de lecteur en didactique de la littérature : un outil pour la recherche et l'enseignement. Licence OpenEdition Books. https://books.openedition.org/pun/6982?lang=fr
2008 2016* 2025 Récit, fiction
Textes de l'Antiquité
Récits d'aventure
Partir à l'aventure !
Récit, fiction
Contes et récits merveilleux
Le monstre, aux limites de l'humain
Créer, recréer le monde : récits des origines
Poésie
Initiation à la poésie
Récits de création ; création poétique
Chanter et enchanter le monde : mots et merveilles
Théâtre
Initiation au théâtre
Résister au plus fort : ruses, mensonges et masques
Se masquer, jouer, déjouer : ruses en action
* Apparition des "enjeux littéraires et de formation personnelle"
Le contenu fictionnel des œuvres est toujours investi, transformé, singularisé par l'« activité fictionnalisante » des lecteurs : images produites en « complément » de l'œuvre (concrétisation imageante), liens de causalité établis entre les événements ou les actions des personnages (cohérence mimétique), scénarios fantasmatiques activés par le texte (activité fantasmatique), jugements portés sur l'action et la motivation des personnages (réaction axiologique). Ce dialogue interfictionnel entre la fiction textualisée par l'œuvre et la textualisation des apports fictionnels de la subjectivité du lecteur produit le « texte singulier du lecteur », « ce trajet de lecture tissé de la combinaison fluctuante de la chaîne d'une vie avec la trame des énoncés qui seul mériterait d'être appelé texte ». L'élaboration et l'exploitation de ce « texte du lecteur » sont au centre d'une intervention didactique qui entend développer la compétence esthétique des élèves, c'est-à-dire l'aptitude à réagir face à une œuvre et à en apprécier les effets.
Langlade, G. (2007) La lecture subjective in La littérature québécoise de 1970 à nos jours Numéro 145, p.71-73. https://www.erudit.org/fr/revues/qf/2007-n145- qf1178006/47315ac.pdf
Le Goff, F. (2008). Les malles du lecteur ou les écritures de la réception. Canal-U. https://doi.org/10.60527/cq10-yk74. (du début à 15'10)
Reprenons le premier extrait proposé, tiré de Perceval, ou le Conte du Graal.
Le lendemain soir, les personnages écrivent leur journal personnel. Choisissez l'un des deux personnages, imaginez et écrivez cette page.
Quels sont les intérêts, et les limites de chacune de ces deux approches ?
|
LECTURE - l'arpentage ; - l'autobiographie de lecteur ; |
ÉCRITURE |
ORAL - la lecture chorale ; |