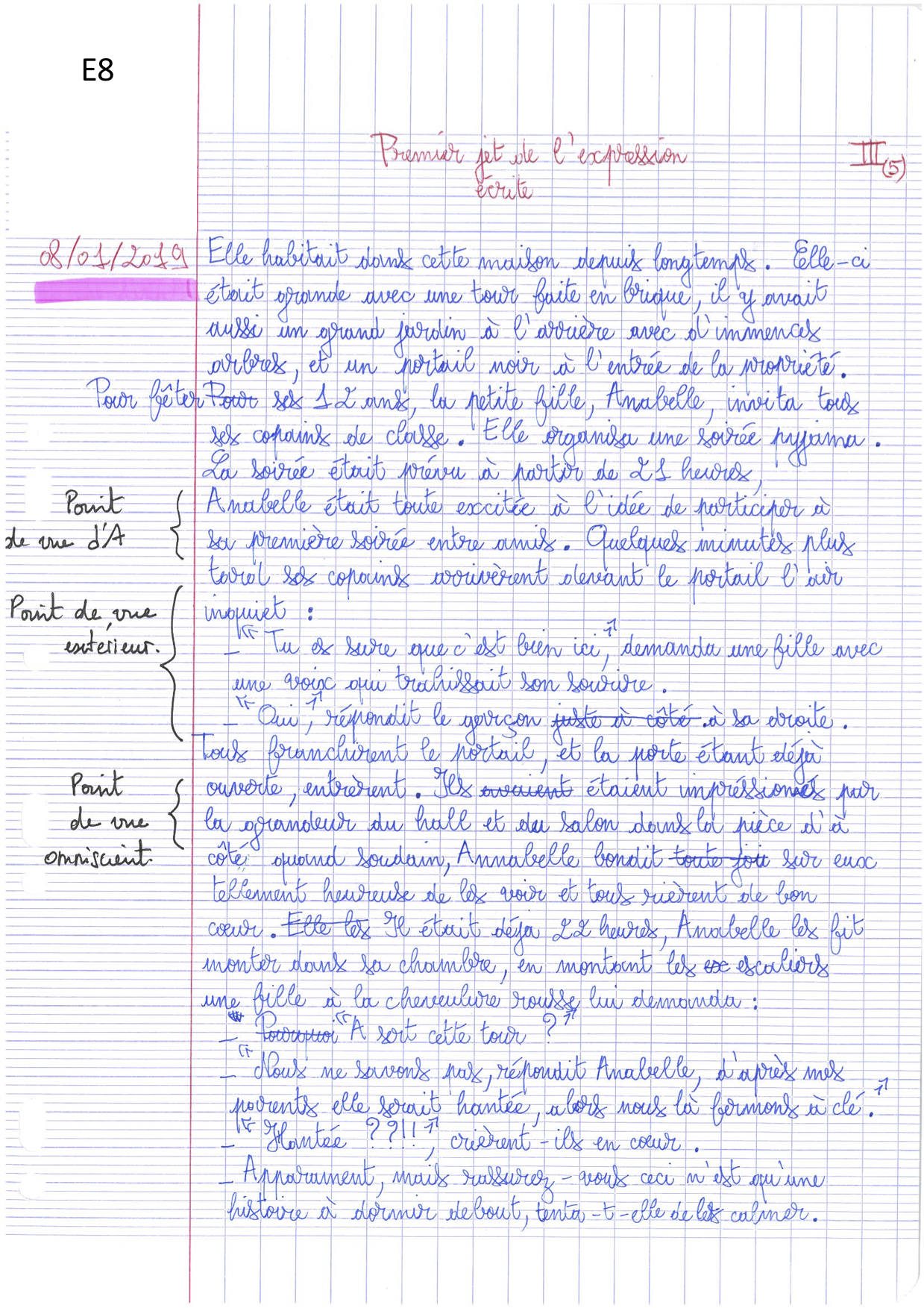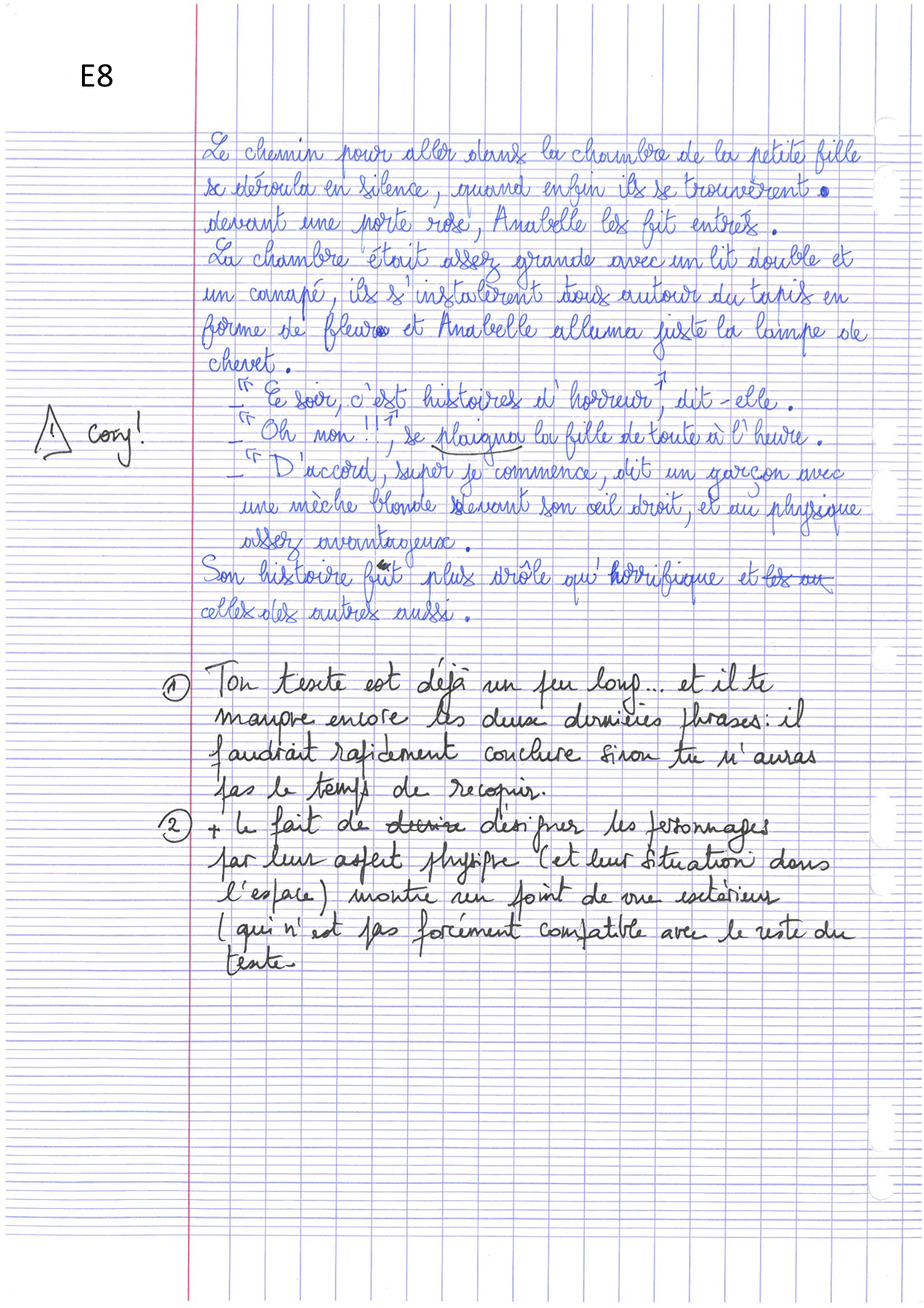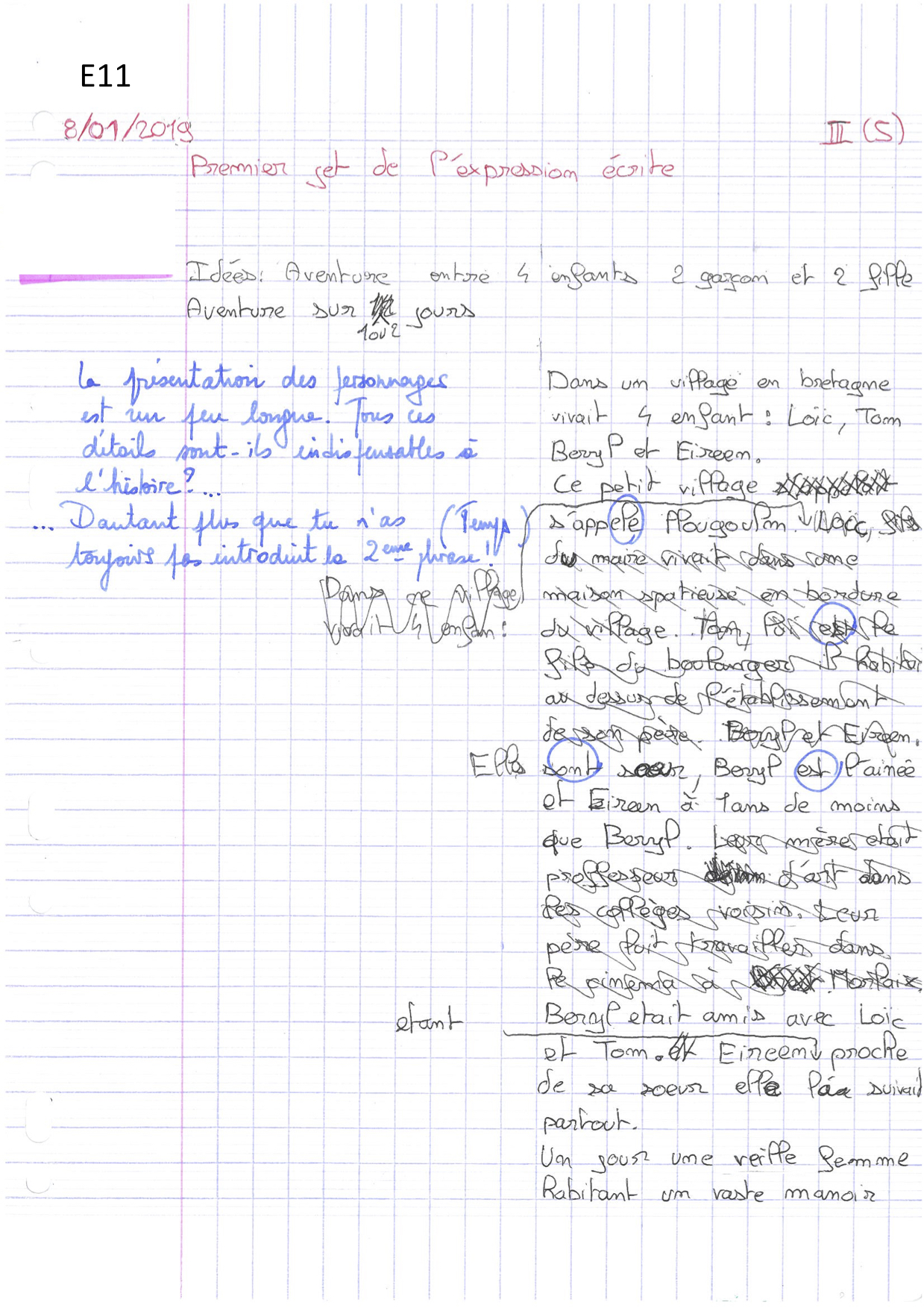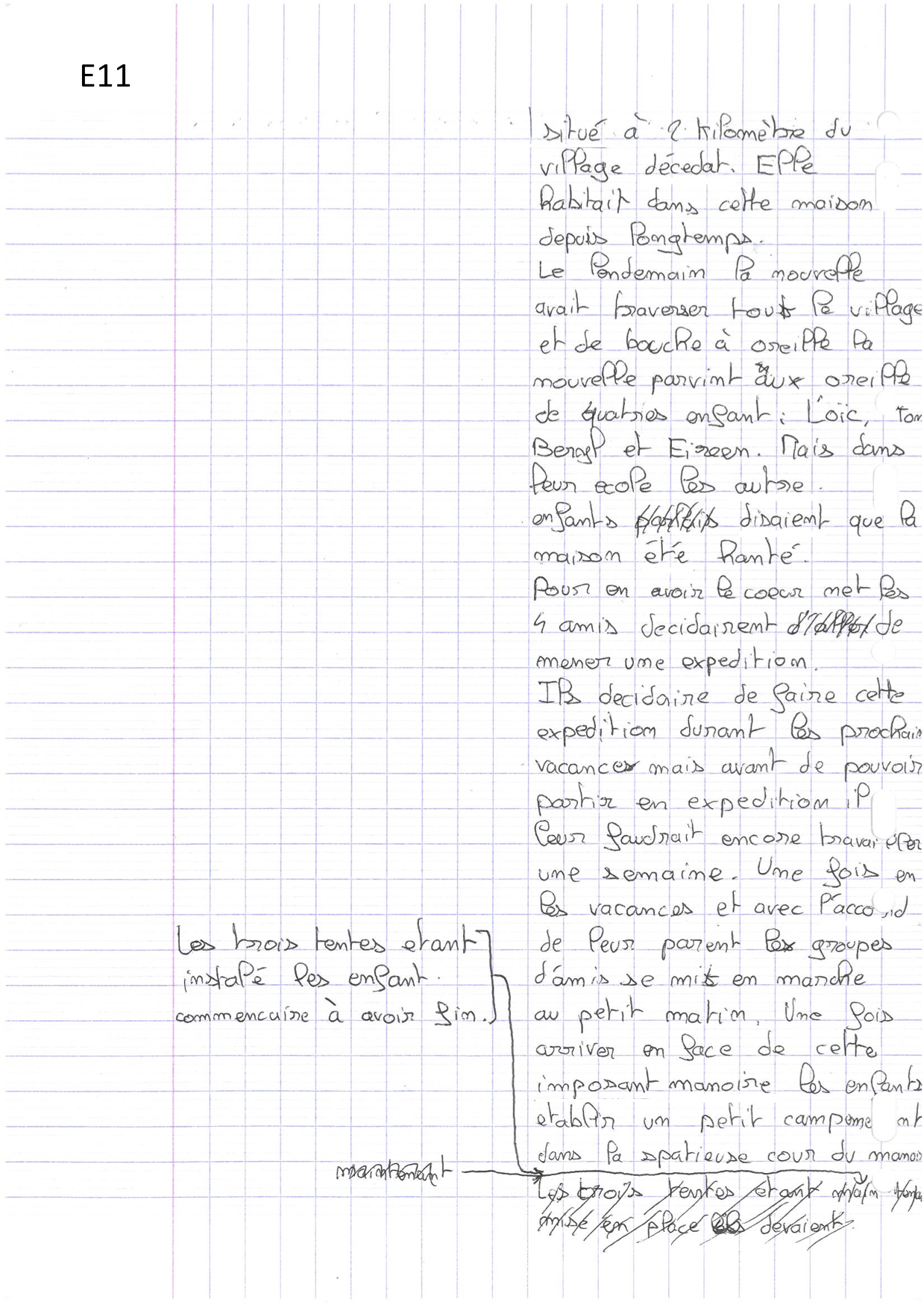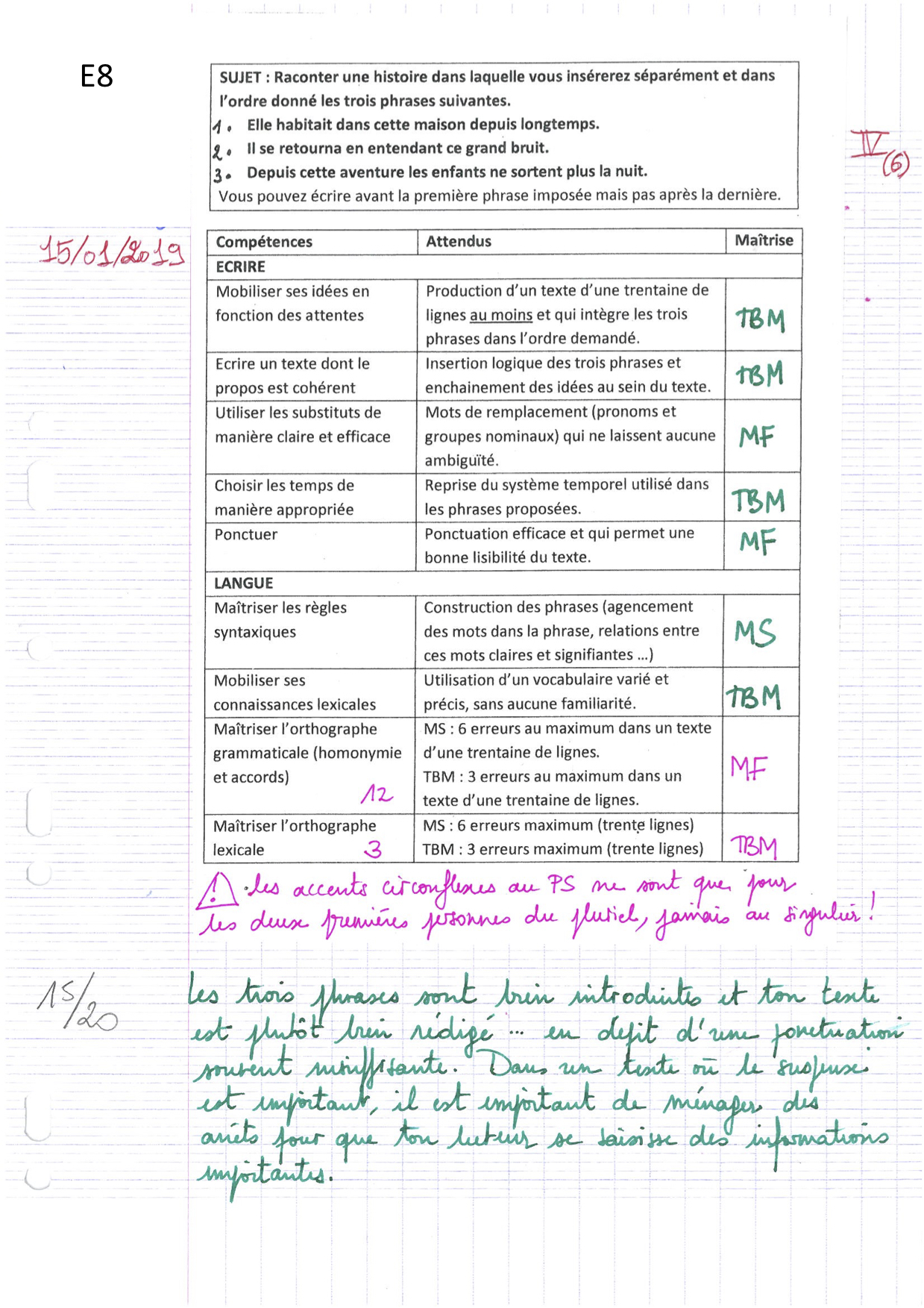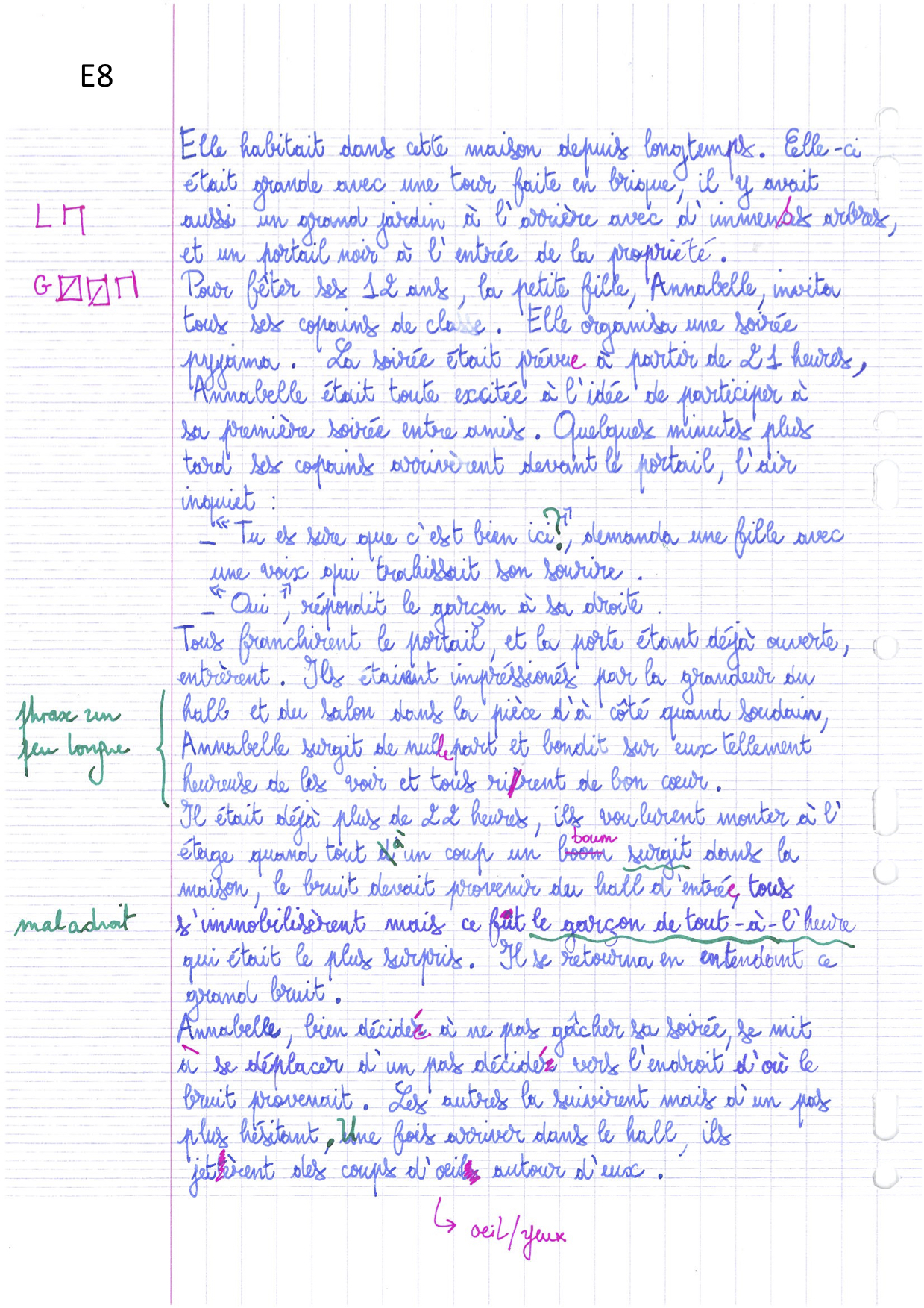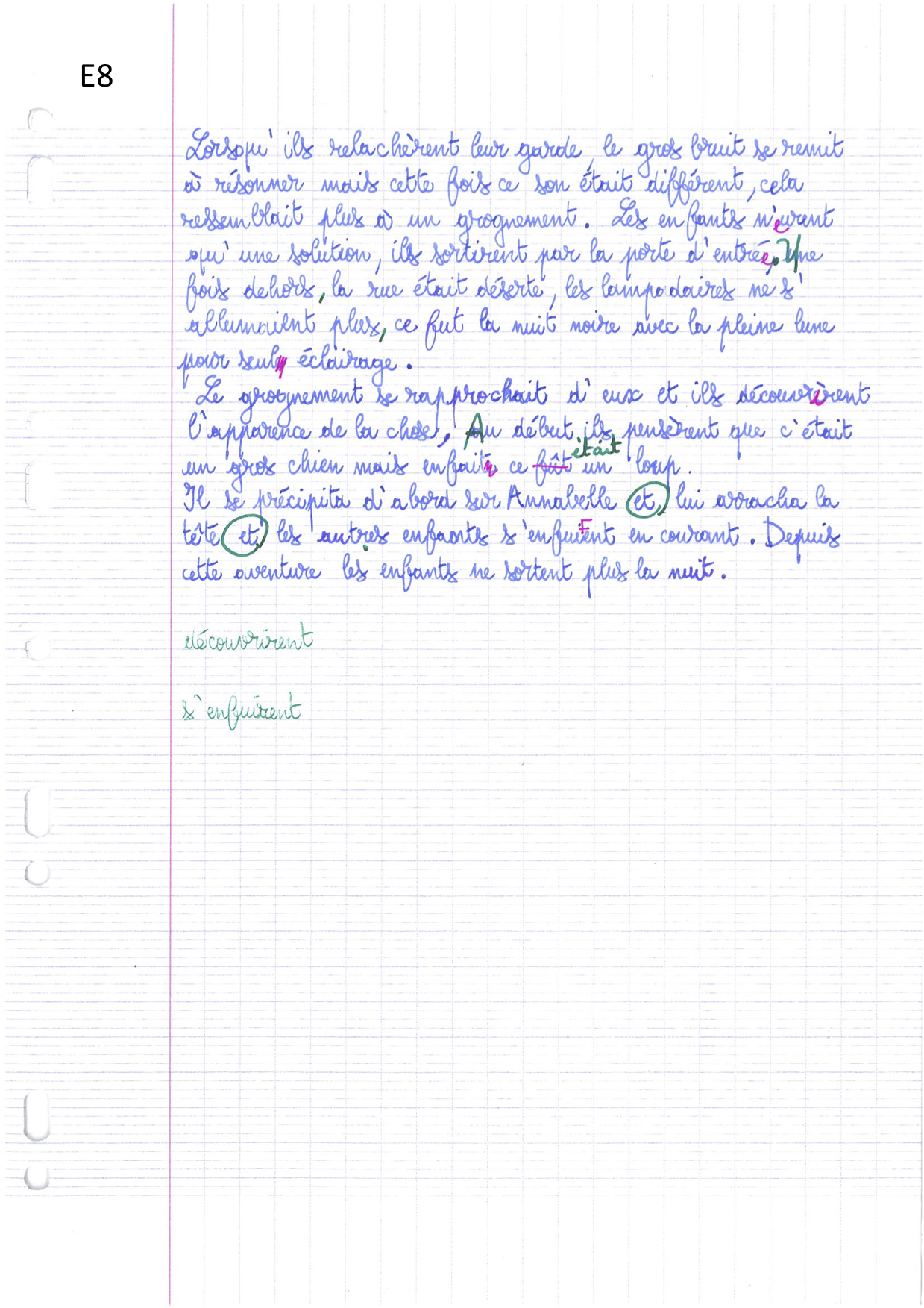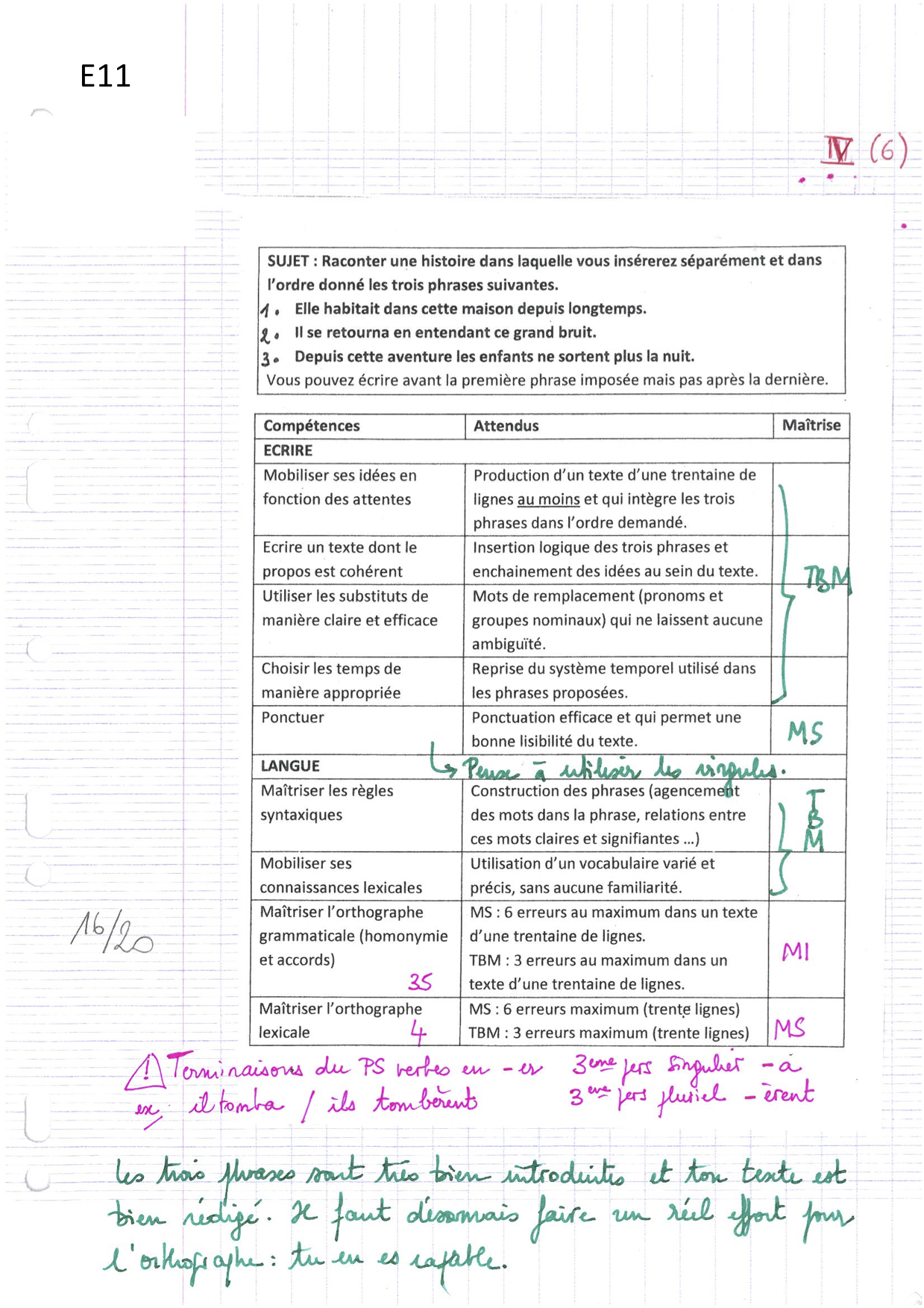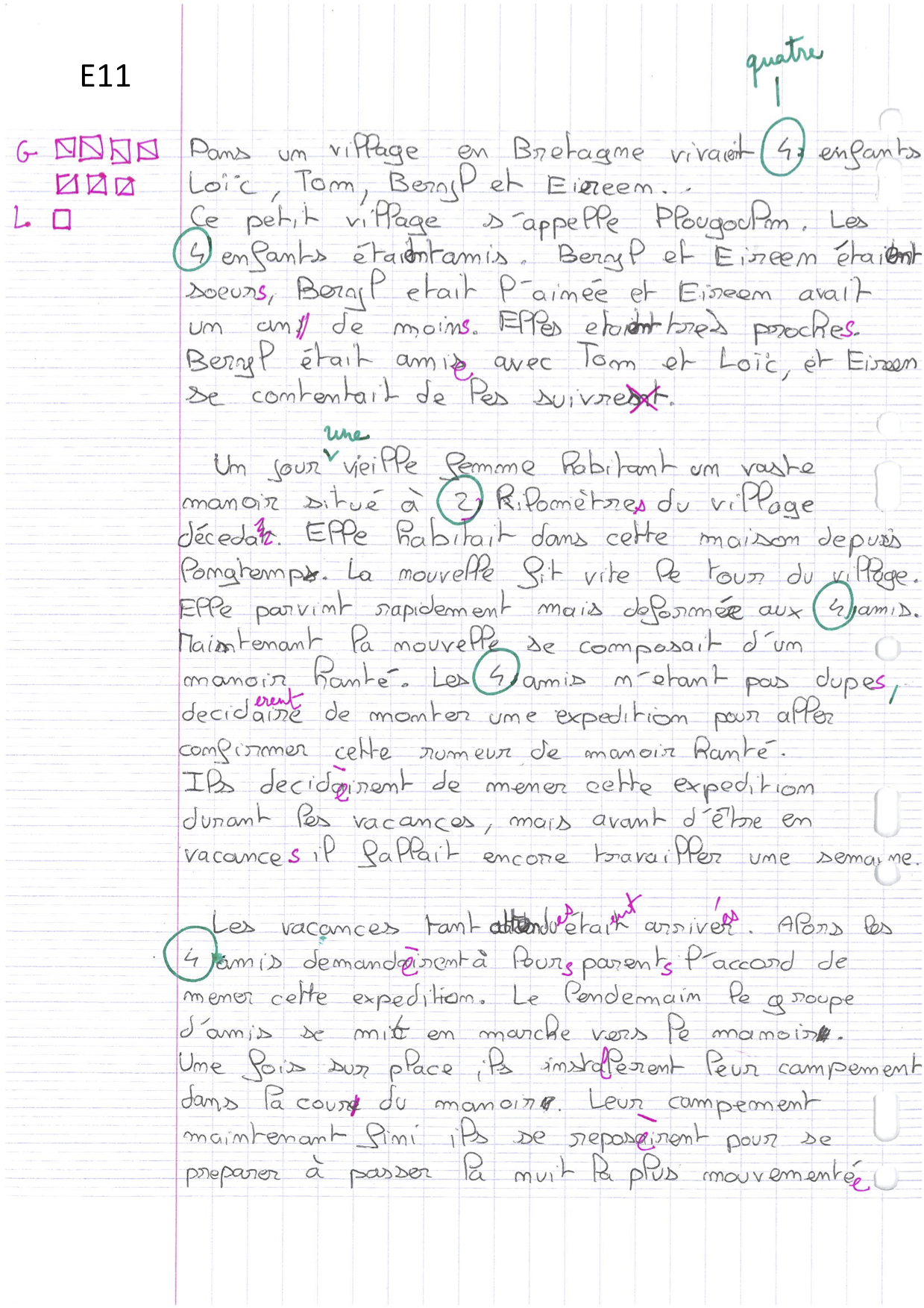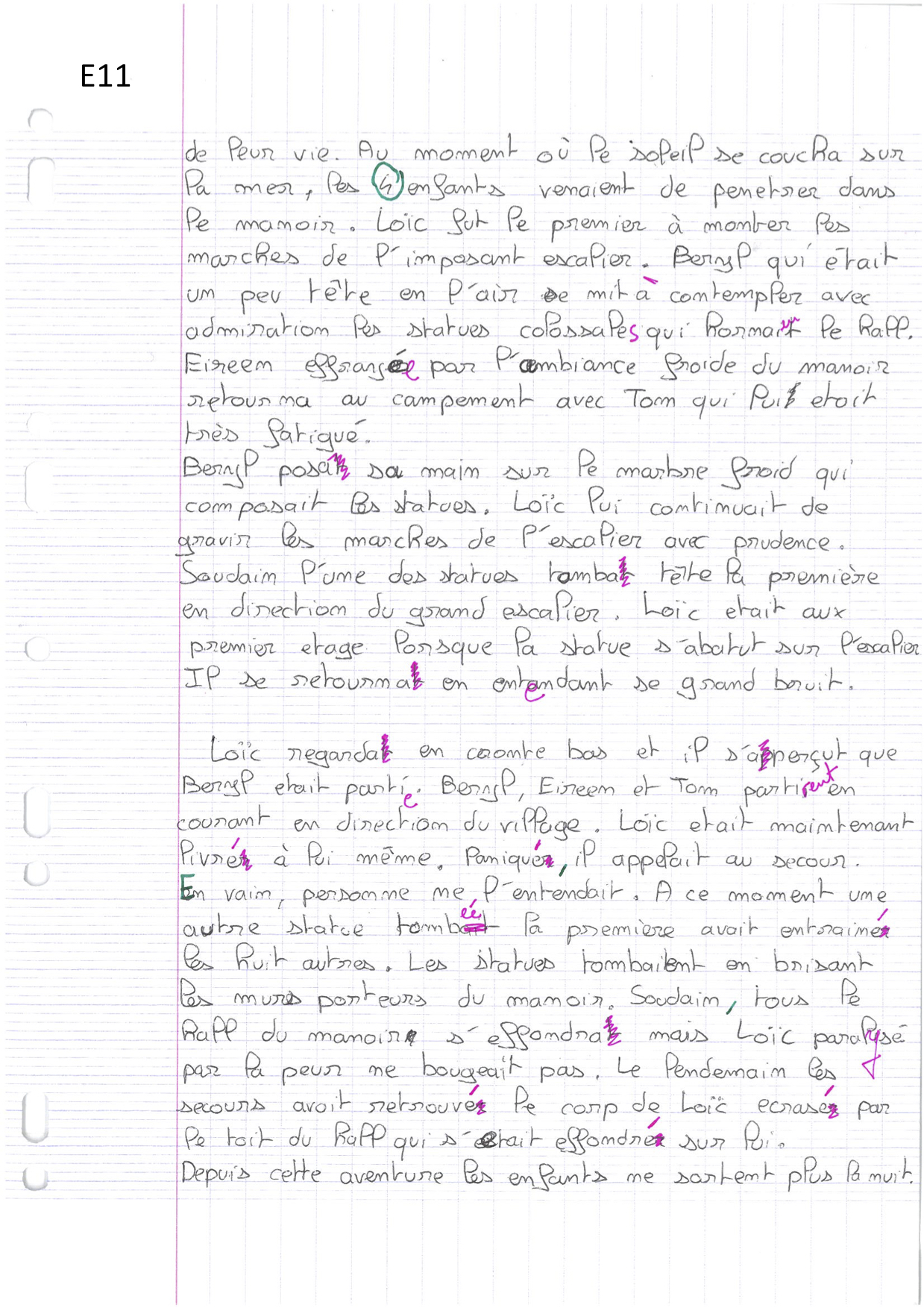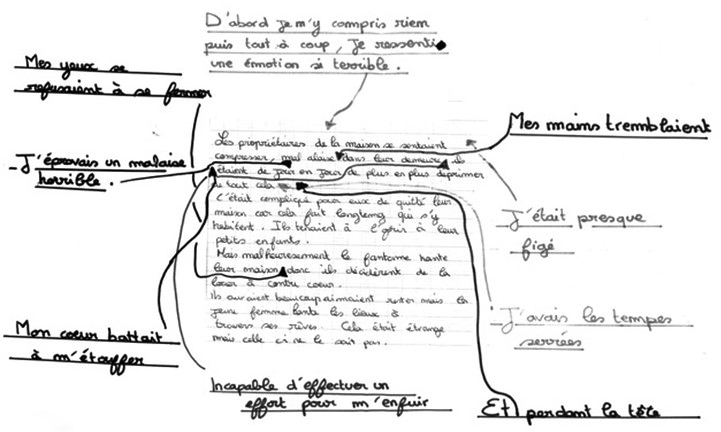Document A
Le personnage principal de ce roman, "le vieux", vit en Amazonie,
parmi les indiens Shuars. C'est un passionné de romans "à l'eau de
rose".
Après avoir mangé les crabes délicieux, le vieux nettoya
méticuleusement son dentier et le rangea dans son mouchoir. Après
quoi il débarrassa la table, jeta les restes par la fenêtre, ouvrit
une bouteille de Frontera et choisit un roman.
La pluie qui l'entourait de toutes parts lui ménageait une intimité
sans pareille.
Le roman commençait bien.
"Paul lui donna un baiser ardent pendant que le gondolier
complice des aventures de son ami faisait semblant de regarder
ailleurs et que la gondole, garnie de coussins moelleux, glissait sur
les canaux vénitiens."
Il lut la phrase à voix haute et plusieurs fois.
Qu'est-ce que ça peut bien être, des gondoles ?
Ça glissait sur des canaux. Il devait s'agir de barques ou de
pirogues. Quant à Paul, il était clair que ce n'était pas un individu
recommandable, puisqu'il donne un "baiser ardent" à la jeune
fille en présence d'un ami, complice de surcroit.
Ce début lui plaisait.
Il était reconnaissant à l'auteur de désigner les méchants dès le
départ. De cette manière, on évitait les malentendus et les
sympathies non méritées.
Restait le baiser – quoi déjà ? – "ardent". Comment est-ce
qu'on pouvait faire ça ?
Il se souvenait des rares fois où il avait donné un baiser à Dolores
Encarnación del Santísimo Sacramento Estupiñán Otavalo. Peut-être,
sans qu'il s'en rende compte, l'un de ces baisers avait-il été
ardent, comme celui de Paul dans le roman.
En tout cas il n'y avait pas eu beaucoup de baisers, parce que sa
femme répondait par des éclats de rire, ou alors elle disait que ça
devait être un péché.
Un baiser ardent. Un baiser. Il avait découvert récemment qu'il n'en
avait guère donné, et seulement à sa femme, car les Shuars ne
connaissent pas le baiser.
Il existe chez eux, entre hommes et femmes, des caresses sur tout le
corps, sans se préoccuper de la présence de tiers. Même quand ils
font l'amour, ils ne se donnent pas de baisers. [...]
Non, chez les Shuars le baiser n'existe pas.
Il se souvenait aussi d'avoir vu, une fois, un chercheur d'or
culbuter une femme jivaro, une pauvresse qui rôdait chez les colons
et les aventuriers en mendiant une gorgée d'aguardiente. Tous les
hommes qui en avaient envie pouvaient l'emmener dans un coin et la
posséder. Abrutie par l'alcool, la malheureuse ne se rendait pas
compte de ce qu'on faisait d'elle. Cette fois-là, un aventurier
l'avait prise sur la plage et avait cherché à coller sa bouche à la
sienne.
La femme avait réagi comme un animal sauvage. Elle avait fait rouler
l'homme couché sur elle, lui avait lancé une poignée de sable dans
les yeux et était allée ostensiblement vomir de dégout.
Si c'était cela un baiser ardent, alors le Paul du roman n'était
qu'un porc.
Quand arriva l'heure de la sieste, il avait lu environ quatre pages
et réfléchi à leur propos, et il était préoccupé de ne pouvoir
imaginer Venise en lui prêtant les caractères qu'il avait attribués à
d'autres villes, également découvertes dans des romans.
À Venise, apparemment, les rues étaient inondées et les gens étaient
obligés de se déplacer en gondoles.
Les gondoles. Le mot "gondole" avait fini par le séduire et
il pensa que ce serait bien d'appeler ainsi sa pirogue. La Gondole du
Nangaritza.
Sepúlveda, L. (1989). Le vieux qui lisait des romans
d'amour. Éditions du Seuil.
Document B
Dans cet essai, Daniel Pennac réfléchit sur l'enseignement de la
lecture dans le monde scolaire. L'essai est rempli de scènes
fictives, comme celle qui suit.
Reste la question du grand, là haut, dans sa chambre.
Lui aussi, il aurait besoin d'être réconcilié avec "les livres" !
Maison vide, parents couchés, télévision éteinte, il se retrouve donc
seul… devant la page 48.
Et cette "fiche de lecture" à rendre demain…
Demain…
Bref calcul mental :
446 – 48 = 398.
Trois cent quatre-vingt-dix-huit pages à s'envoyer dans la nuit !
Il s'y remet bravement. Une page poussant l'autre. Les mots du
"livre" dansent entre les oreillettes de son walkman. Sans joie. Les
mots ont des pieds de plomb. Ils tombent les uns après les autres,
comme ces chevaux qu'on achève. Même le solo de batterie n'arrive pas
à les ressusciter. (Un fameux batteur, pourtant, Kendall !) Il
poursuit sa lecture sans se retourner sur le cadavre des mots. Les
mots ont perdu leur sens, paix à leurs lettres. Cette hécatombe ne
l'effraye pas. Il lit comme on avance. C'est le devoir qui le pousse.
Page 62, page 63.
Il lit.
Que lit-il ?
L'histoire d'Emma Bovary.
L'histoire d'une fille qui a beaucoup lu :
"Elle avait lu Paul et Virginie et elle avait rêvé la maisonnette
de bambous, le nègre Domingo, le chien Fidèle, mais surtout l'amitié
douce de quelque bon petit frère, qui va chercher pour vous des
fruits rouges dans des grands arbres plus hauts que des clochers, ou
qui court pieds nus sur le sable, vous apportant un nid d'oiseau.
"
Le mieux est de téléphoner à Thierry, ou à Stéphanie, pour qu'ils lui
passent leur fiche de lecture, demain matin, qu'il recopiera vite
fait, avant d'entrer en cours, ni vu ni connu, ils lui doivent bien
ça.
"Lorsqu'elle eut treize ans, son père l'amena lui-même à la ville
pour la mettre au couvent. Ils descendirent dans une auberge du
quartier Saint-Gervais où ils eurent à leur souper des assiettes
peintes qui représentaient l'histoire de mademoiselle de La Vallière.
Les explications légendaires, coupées çà et là par l'égratignure des
couteaux, glorifiaient toutes la religion, les délicatesses du cœur
et les pompes de la Cour."
La formule : "Ils eurent à leur souper des assiettes
peintes…" lui arrache un sourire fatigué : "On leur a donné
à bouffer des assiettes vides ? On leur a fait becqueter l'histoire
de cette La Vallière ? " Il fait le malin. Il se croit en marge
de sa lecture. Erreur, son ironie a tapé dans le mille. Car leurs
malheurs symétriques viennent de là : Emma est capable d'envisager
son assiette comme un livre, et lui son livre comme une assiette.
Pennac, D. (1992). Comme un roman. Éditions Gallimard.
Document C
Il avait commencé à lire le roman quelques jours auparavant. Il
l'abandonna à cause d'affaires urgentes et l'ouvrit de nouveau dans
le train, en retournant à sa propriété. Il se laissait lentement
intéresser par l'intrigue et le caractère des personnages. Ce
soir-là, après avoir écrit une lettre à son fondé de pouvoirs et
discuté avec l'intendant une question de métayage, il reprit sa
lecture dans la tranquillité du studio, d'où la vue s'étendait sur le
parc planté de chênes. Installé dans son fauteuil favori, le dos à la
porte pour ne pas être gêné par une irritante possibilité de
dérangements divers, il laissait sa main gauche caresser de temps en
temps le velours vert. Il se mit à lire les derniers chapitres. Sa
mémoire retenait sans effort les noms et l'apparence des héros.
L'illusion romanesque le prit presque aussitôt. Il jouissait du
plaisir presque pervers de s'éloigner petit à petit, ligne après
ligne, de ce qui l'entourait, tout en demeurant conscient que sa tête
reposait commodément sur le velours du dossier élevé, que les
cigarettes restaient à portée de sa main et qu'au-delà des grandes
fenêtres le souffle du crépuscule semblait danser sous les chênes.
Phrase après phrase, absorbé par la sordide alternative où se
débattaient les protagonistes, il se laissait prendre aux images qui
s'organisaient et acquéraient progressivement couleur et vie. Il fut
ainsi témoin de la dernière rencontre dans la cabane parmi la
broussaille. La femme entra la première, méfiante. Puis vint l'homme,
le visage griffé par les épines d'une branche. Admirablement, elle
étanchait de ses baisers le sang des égratignures. Lui, se dérobait
aux caresses. Il n'était pas venu pour répéter le cérémonial d'une
passion clandestine protégée par un monde de feuilles sèches et de
sentiers furtifs. Le poignard devenait tiède au contact de sa
poitrine. Dessous, au rythme du cœur, battait la liberté convoitée.
Un dialogue haletant se déroulait au long des pages comme un fleuve
de reptiles, et l'on sentait que tout était décidé depuis toujours.
Jusqu'à ces caresses qui enveloppaient le corps de l'amant comme pour
le retenir et le dissuader, dessinaient abominablement les contours
de l'autre corps, qu'il était nécessaire d'abattre. Rien n'avait été
oublié : alibis, hasards, erreurs possibles. A partir de cette heure,
chaque instant avait son usage minutieusement calculé. La double et
implacable répétition était à peine interrompue le temps qu'une main
frôle une joue. Il commençait à faire nuit.
Sans se regarder, étroitement liés à la tâche qui les attendait, ils
se séparèrent à la porte de la cabane. Elle devait suivre le sentier
qui allait vers le nord. Sur le sentier opposé, il se retourna un
instant pour la voir courir, les cheveux dénoués. A son tour, il se
mit à courir, se courbant sous les arbres et les haies. A la fin, il
distingua dans la brume mauve du crépuscule l'allée qui conduisait à
la maison. Les chiens ne devaient pas aboyer et ils n'aboyèrent pas.
A cette heure, l'intendant ne devait pas être là et il n'était pas
là. Il monta les trois marches du perron et entra. A travers le sang
qui bourdonnait dans ses oreilles, lui parvenaient encore les paroles
de la femme. D'abord une salle bleue, puis un corridor, puis un
escalier avec un tapis. En haut, deux portes. Personne dans la
première pièce, personne dans la seconde. ... [La fin du texte a
été tronquée.]La porte du salon, et
alors, le poignard en main, les lumières des grandes baies, le
dossier élevé du fauteuil de velours vert et, dépassant le fauteuil,
la tête de l'homme en train de lire un roman.
Cortazar, J. (1959). "Continuité des parcs", Les Armes
secrètes, trad. C. et R. Caillois, éd. Gallimard.
Document D
... thy rope of sands...
George Herbert (1593-1633)
La ligne est composée d'un nombre infini de points ; le plan, d'un
nombre infini de lignes ; le volume, d'un nombre infini de plans ;
l'hypervolume, d'un nombre infini de volumes... Non, décidément, ce
n'est pas là, more geometrico, la meilleure façon de commencer mon
récit. C'est devenu une convention aujourd'hui d'affirmer de tout
conte fantastique qu'il est véridique ; le mien, pourtant, est
véridique.
Je vis seul, au quatrième étage d'un immeuble de la rue Belgrano. II
y a de cela quelques mois, en fin d'après-midi, j'entendis frapper à
ma porte. J'ouvris et un inconnu entra. C'était un homme grand, aux
traits imprécis. Peut-être est-ce ma myopie qui me les fit voir de la
sorte. Tout son aspect reflétait une pauvreté décente. II était vêtu
de gris et il tenait une valise à la main. Je me rendis tout de suite
compte que c'était un étranger. Au premier abord, je le pris pour un
homme âgé ; ensuite je constatai que j'avais été trompé par ses
cheveux clairsemés, blonds, presque blancs, comme chez les Nordiques.
Au cours de notre conversation, qui ne dura pas plus d'une heure,
j'appris qu'il était originaire des Orcades.
Je lui offris une chaise. L'homme laissa passer un moment avant de
parler. II émanait de lui une espèce de mélancolie, comme il doit en
être de moi aujourd'hui.
- Je vends des bibles, me dit-il.
Non sans pédanterie, je lui répondis :
- II y a ici plusieurs bibles anglaises, y compris la première, celle
de Jean Wiclef. J'ai également celle de Cipriano de Valera, celle de
Luther, qui du point de vue littéraire est la plus mauvaise, et un
exemplaire en latin de la Vulgate. Comme vous voyez, ce ne sont pas
précisément les bibles qui me manquent.
Après un silence, il me rétorqua :
- Je ne vends pas que des bibles. Je puis vous montrer un livre sacré
qui peut-être vous intéressera. Je l'ai acheté à la frontière du
Bikanir.
Il ouvrit sa valise et posa l'objet sur la table. C'était un volume
in-octavo, relié en toile. Il avait sans aucun doute passé par bien
des mains. Je l'examinai ; son poids insolite me surprit. En haut du
dos je lus Holy Writ et en bas Bombay.
- Il doit dater du dix-neuvième siècle, observai-je.
- Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais su, me fut-il répondu.
Je l'ouvris au hasard. Les caractères m'étaient inconnus. Les pages,
qui me parurent assez abîmées et d'une pauvre typographie, étaient
imprimées sur deux colonnes à la façon d'une bible. Le texte était
serré et disposé en versets. A l'angle supérieur des pages figuraient
des chiffres arabes. Mon attention fut attirée sur le fait qu'une
page paire portait, par exemple, le numéro 40514 et l'impaire, qui
suivait, le numéro 999. Je tournai cette page; au verso la pagination
comportait huit chiffres. Elle était ornée d'une petite illustration,
comme on en trouve dans les dictionnaires : une ancre dessinée à la
plume, comme par la main malhabile d'un enfant.
L'inconnu me dit alors:
- Regardez-la bien. Vous ne la verrez jamais plus.
Il y avait comme une menace dans cette affirmation, mais pas dans la
voix.
Je repérai sa place exacte dans le livre et fermai le volume. Je le
rouvris aussitôt. Je cherchai en vain le dessin de l'ancre, page par
page. Pour masquer ma surprise, je lui dis :
- Il s'agit d'une version de l'Ecriture Sainte dans une des langues
hindoues, n'est-ce pas ?
- Non, me répondit-il.
Puis, baissant la voix comme pour me confier un secret :
- J'ai acheté ce volume, dit-il, dans un village de la plaine, en
échange de quelques roupies et d'une bible. Son possesseur ne savait
pas lire. Je suppose qu'il a pris le Livre des Livres pour une
amulette. II appartenait à la caste la plus inférieure; on ne
pouvait, sans contamination, marcher sur son ombre. II me dit que son
livre s'appelait le livre de sable, parce que ni ce livre ni le sable
n'ont de commencement ni de fin.
II me demanda de chercher la première page.
Je posai ma main gauche sur la couverture et ouvris le volume de mon
pouce serré contre l'index. Je m'efforçai en vain : il restait
toujours des feuilles entre la couverture et mon pouce. Elles
semblaient sourdre du livre.
- Maintenant cherchez la dernière.
Mes tentatives échouèrent de même; à peine pus-je balbutier d'une
voix qui n'était plus ma voix :
- Cela n'est pas possible.
Toujours à voix basse le vendeur de bibles me dit :
- Cela n'est pas possible et pourtant cela est. Le nombre de pages de
ce livre est exactement infini. Aucune n'est la première, aucune
n'est la dernière. Je ne sais pourquoi elles sont numérotées de cette
façon arbitraire. Peut-être pour laisser entendre que les composants
d'une série infinie peuvent être numérotés de façon absolument
quelconque.
Puis, comme s'il pensait à voix haute, il ajouta :
- Si l'espace est infini, nous sommes dans n'importe quel point de
l'espace. Si le temps est infini, nous sommes dans n'importe quel
point du temps.
Ses considérations m'irritèrent.
- Vous avez une religion, sans doute ? lui demandai-je.
- Oui, je suis presbytérien. Ma conscience est tranquille. Je suis
sûr de ne pas avoir escroqué l'indigène en lui donnant la Parole du
Seigneur en échange de son livre diabolique.
Je l'assurai qu'il n'avait rien à se reprocher et je lui demandai
s'il était de passage seulement sous nos climats. Il me répondit
qu'il pensait retourner prochainement dans sa patrie. C'est alors que
j'appris qu'il était Écossais, des îles Orcades. Je lui dis que
j'aimais personnellement l'Ecosse, ayant une véritable passion pour
Stevenson et pour Hume.
- Et pour Robbie Burns, corrigea-t-il.
Tandis que nous parlions je continuais à feuilleter le livre infini.
- Vous avez l'intention d'offrir ce curieux spécimen au British
Muséum ? lui demandai-je, feignant l'indifférence.
- Non. C'est à vous que je l'offre, me répliqua-t-il, et il énonça un
prix élevé.
Je lui répondis, en toute sincérité, que cette somme n'était pas dans
mes moyens et je me mis à réfléchir. Au bout de quelques minutes,
j'avais ourdi mon plan.
- Je vous propose un échange, lui dis-je. Vous, vous avez obtenu ce
volume contre quelques roupies et un exemplaire de l'Écriture Sainte
; moi, je vous offre le montant de ma retraite, que je viens de
toucher, et la bible de Wiclef en caractères gothiques. Elle me vient
de mes parents.
- A black letter Wiclef ! murmura-t-il.
J'allai dans ma chambre et je lui apportai l'argent et le livre. Il
le feuilleta et examina la page de titre avec une ferveur de
bibliophile.
- Marché conclu, me dit-il.
Je fus surpris qu'il ne marchandât pas. Ce n'est que par la suite que
je compris qu'il était venu chez moi décidé à me vendre le livre.
Sans même les compter, il mit les billets dans sa poche.
Nous parlâmes de l'Inde, des Orcades et des jarls norvégiens qui
gouvernèrent ces îles. Quand l'homme s'en alla, il faisait nuit. Je
ne l'ai jamais revu et j'ignore son nom.
Je comptais ranger le Livre de Sable dans le vide qu'avait laissé la
bible de Wiclef, mais je décidai finalement de le dissimuler derrière
des volumes dépareillés des Mille et Une Nuits.
Je me couchai mais ne dormis point. Vers trois ou quatre heures du
matin, j'allumai. Je repris le livre impossible et me mis à le
feuilleter. Sur l'une des pages, je vis le dessin d'un masque. Le
haut du feuillet portait un chiffre, que j'ai oublié, élevé à la
puissance 9.
Je ne montrai mon trésor à personne. Au bonheur de le posséder
s'ajouta la crainte qu'on ne me le volât, puis le soupçon qu'il ne
fût pas véritablement infini. Ces deux soucis vinrent accroître ma
vieille misanthropie. J'avais encore quelques amis ; je cessai de les
voir. Prisonnier du livre, je ne mettais pratiquement plus les pieds
dehors. J'examinai à la loupe le dos et les plats fatigués et je
repoussai l'éventualité d'un quelconque artifice. Je constatai que
les petites illustrations se trouvaient à deux mille pages les unes
des autres. Je les notai dans un répertoire alphabétique que je ne
tardai pas à remplir. Elles ne réapparurent jamais. La nuit, pendant
les rares intervalles que m'accordait l'insomnie, je rêvais du livre.
L'été déclinait quand je compris que ce livre était monstrueux. Cela
ne me servit à rien de reconnaître que j'étais moi-même également
monstrueux, moi qui le voyais avec mes yeux et le palpais avec mes
dix doigts et mes ongles. Je sentis que c'était un objet de
cauchemar, une chose obscène qui diffamait et corrompait la réalité.
... [La fin du texte a été tronquée.]
Je pensai au feu, mais je craignis que la combustion d'un livre
infini ne soit pareillement infinie et n'asphyxie la planète par sa
fumée.
Je me souvins d'avoir lu quelque part que le meilleur endroit où
cacher une feuille c'est une forêt. Avant d'avoir pris ma retraite,
je travaillais à la Bibliothèque nationale, qui abrite neuf cent
mille livres ; je sais qu'à droite du vestibule, un escalier en
colimaçon descend dans les profondeurs d'un sous-sol où sont gardés
les périodiques et les cartes. Je profitai d'une inattention des
employés pour oublier le livre de sable sur l'un des rayons
humides. J'essayai de ne pas regarder à quelle hauteur ni à quelle
distance de la porte.
Je suis un peu soulagé mais je ne veux pas même passer rue Mexico.
Borges, J. L. (1978). "Le Livre de sable". Le Livre de
Sable.

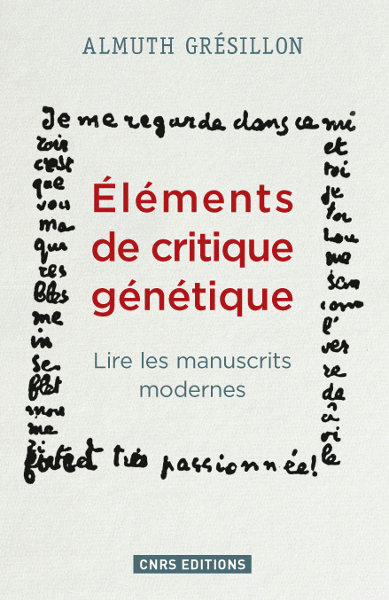
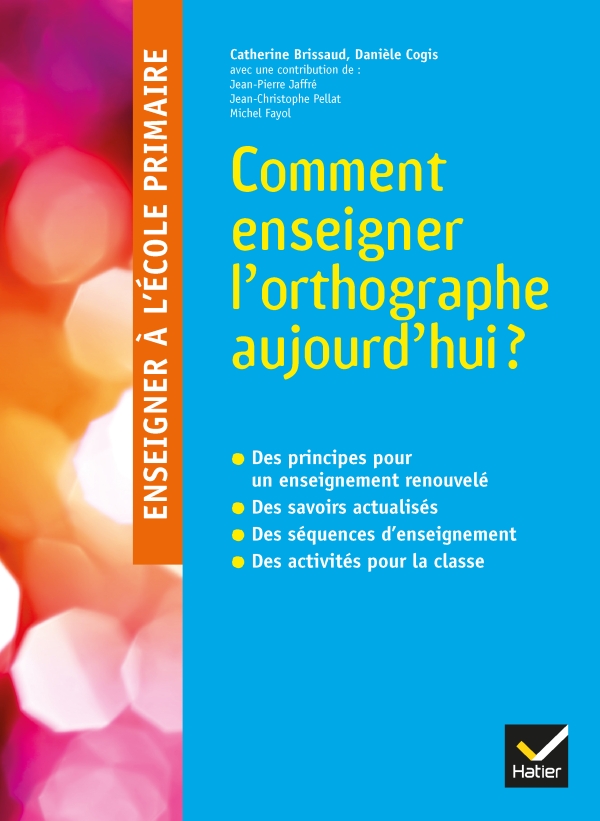



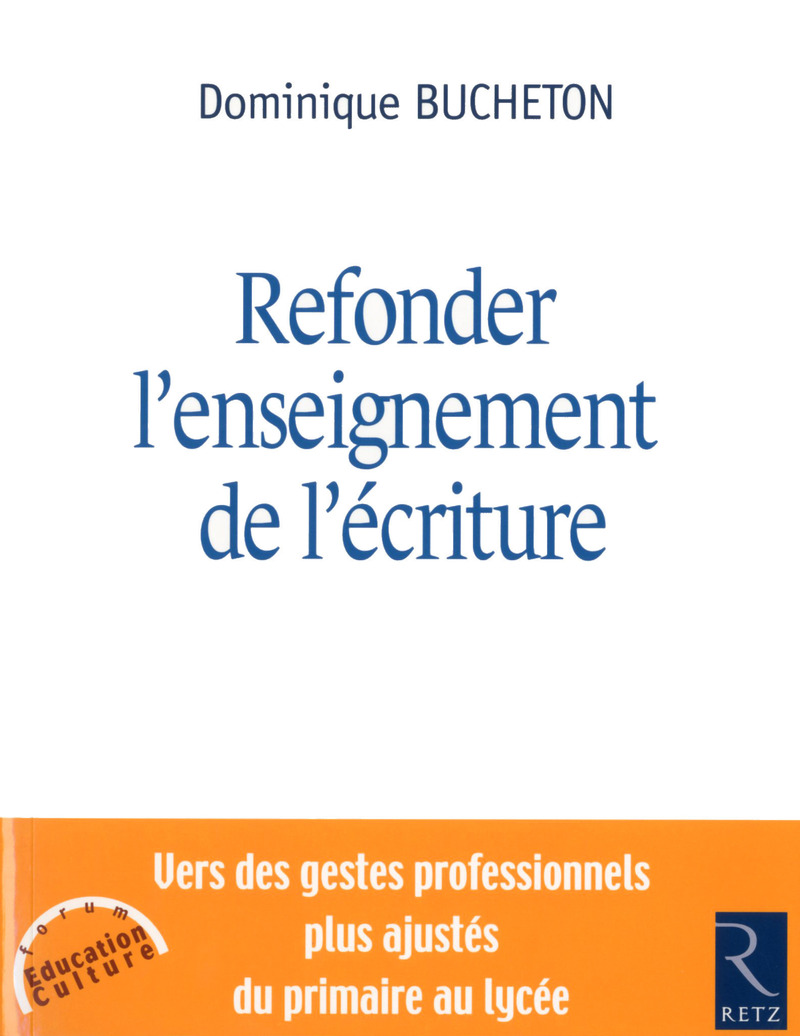


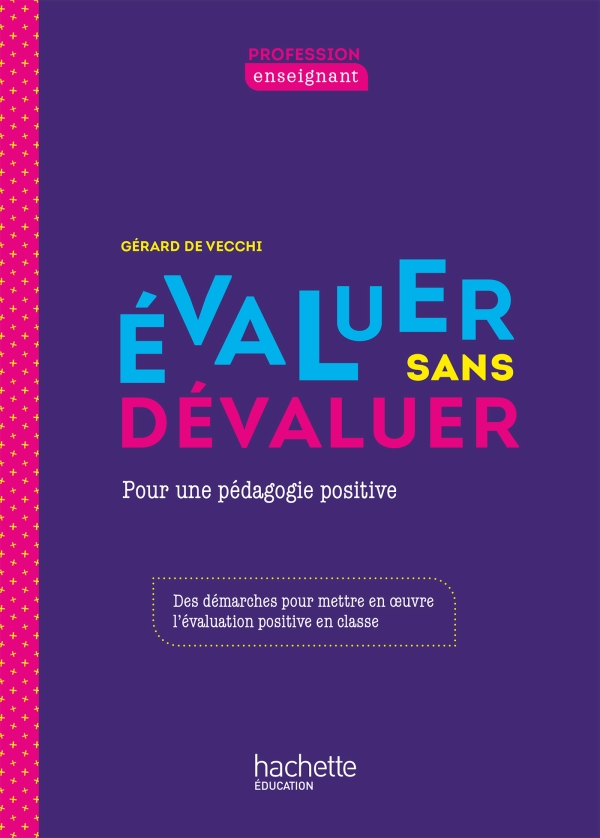
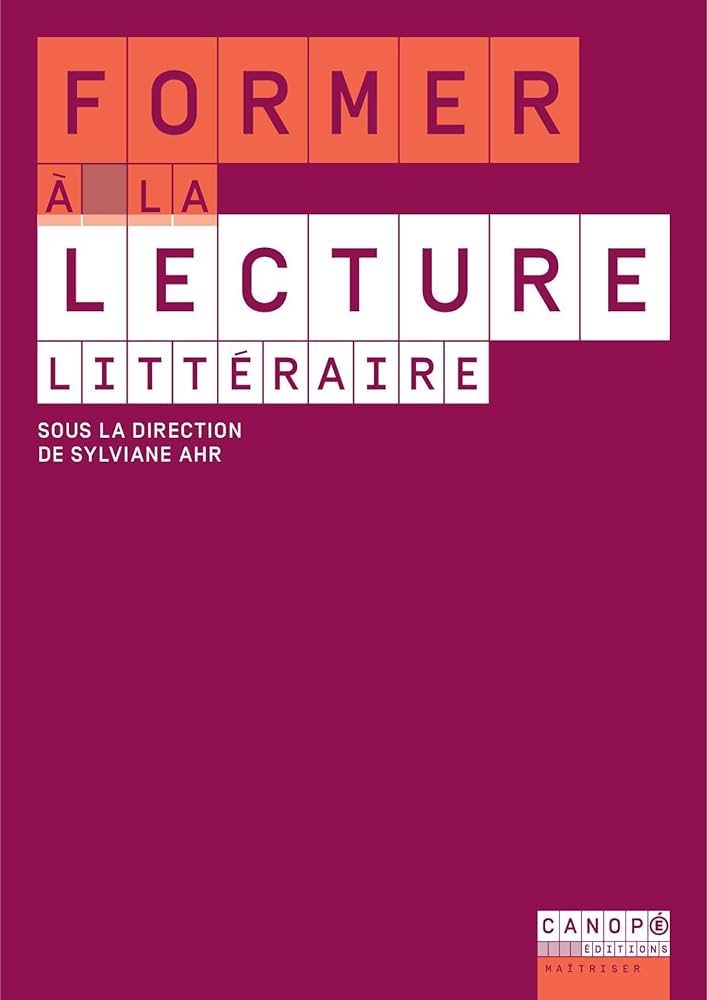
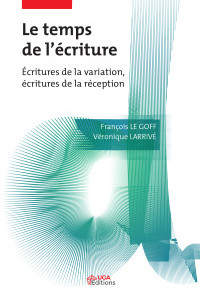
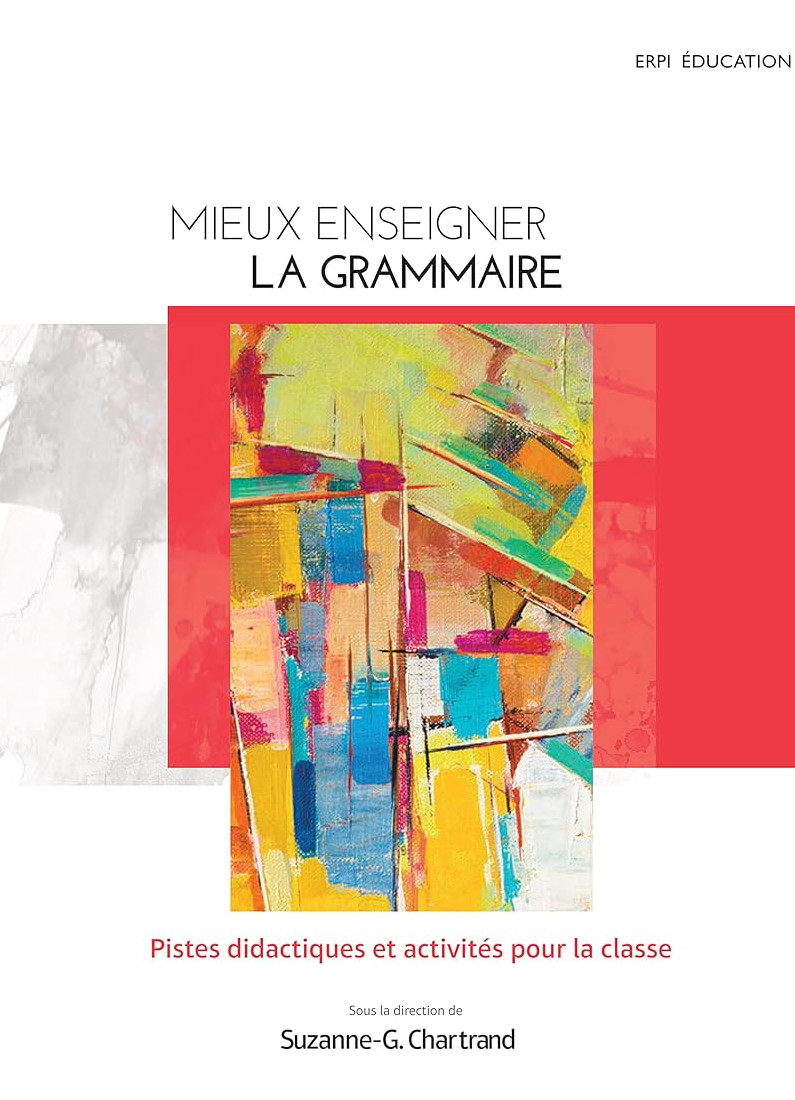
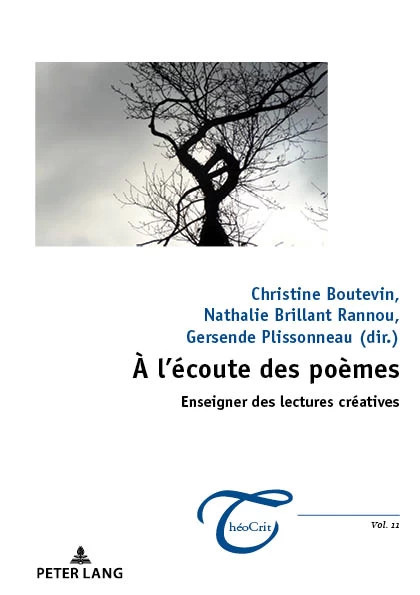
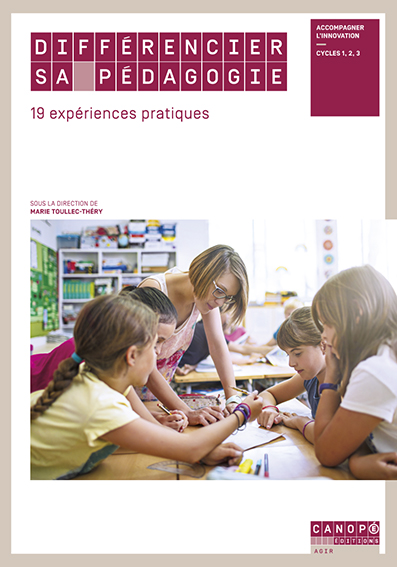
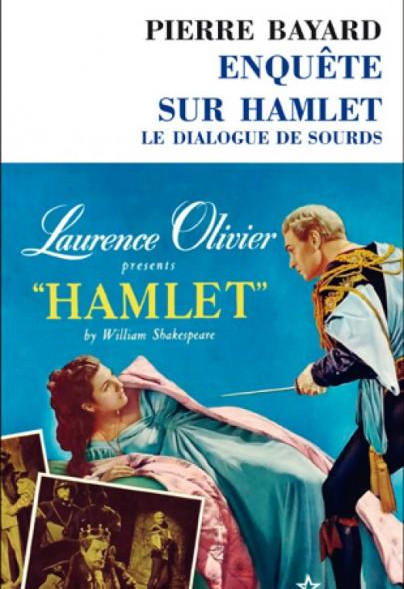
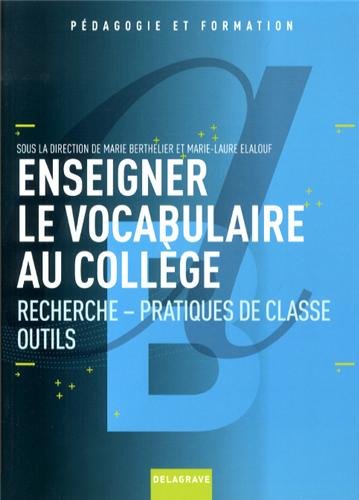







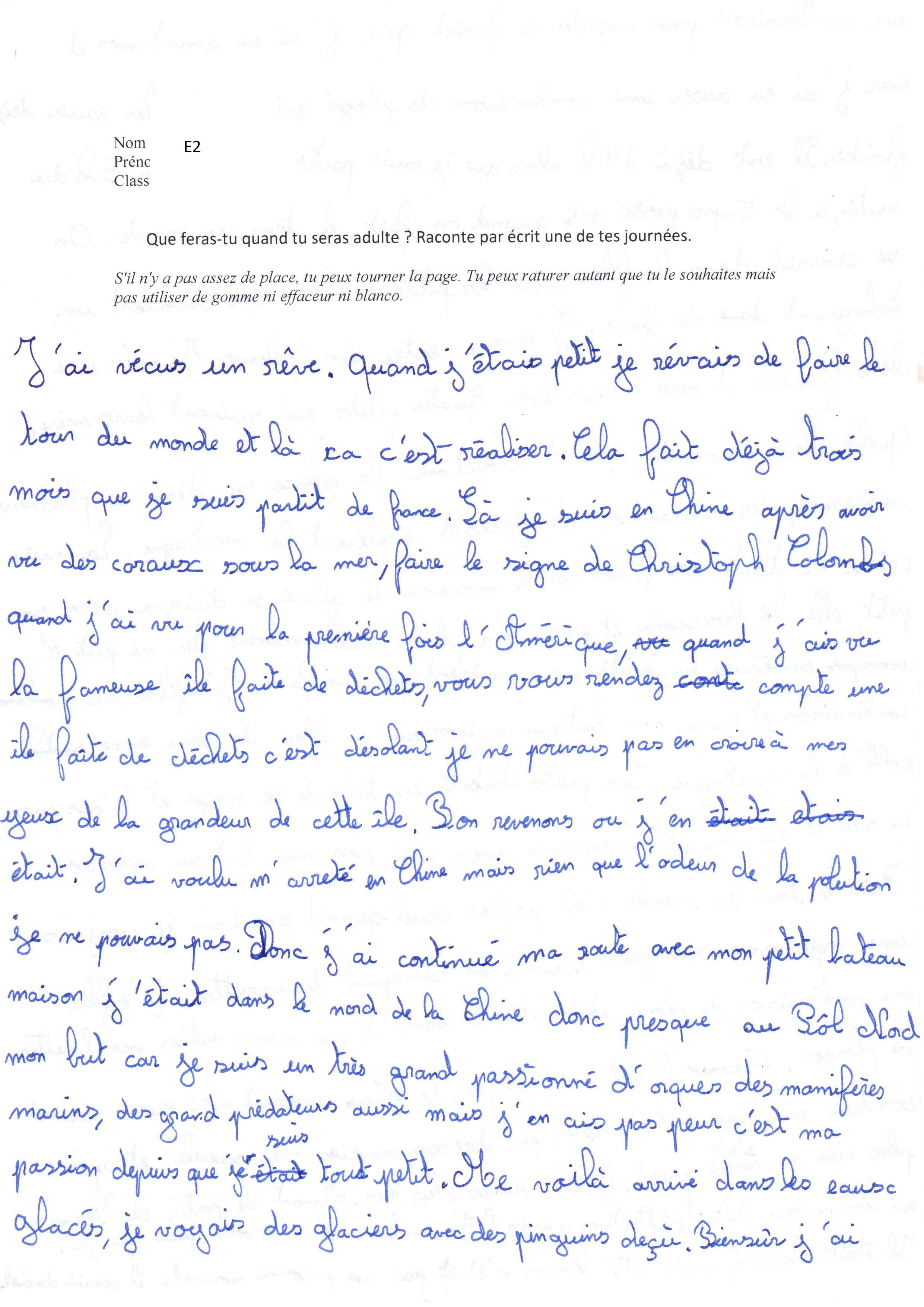
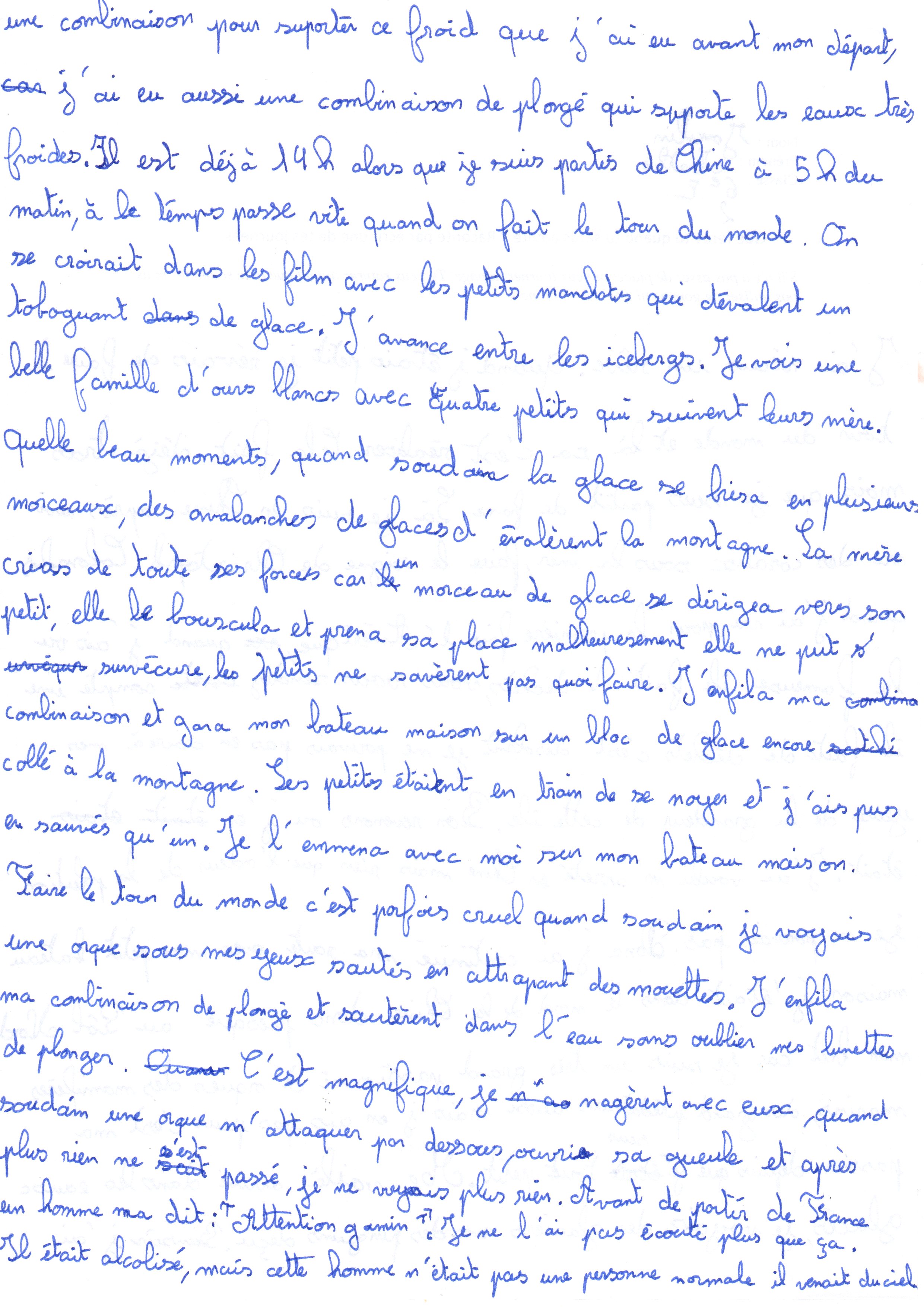

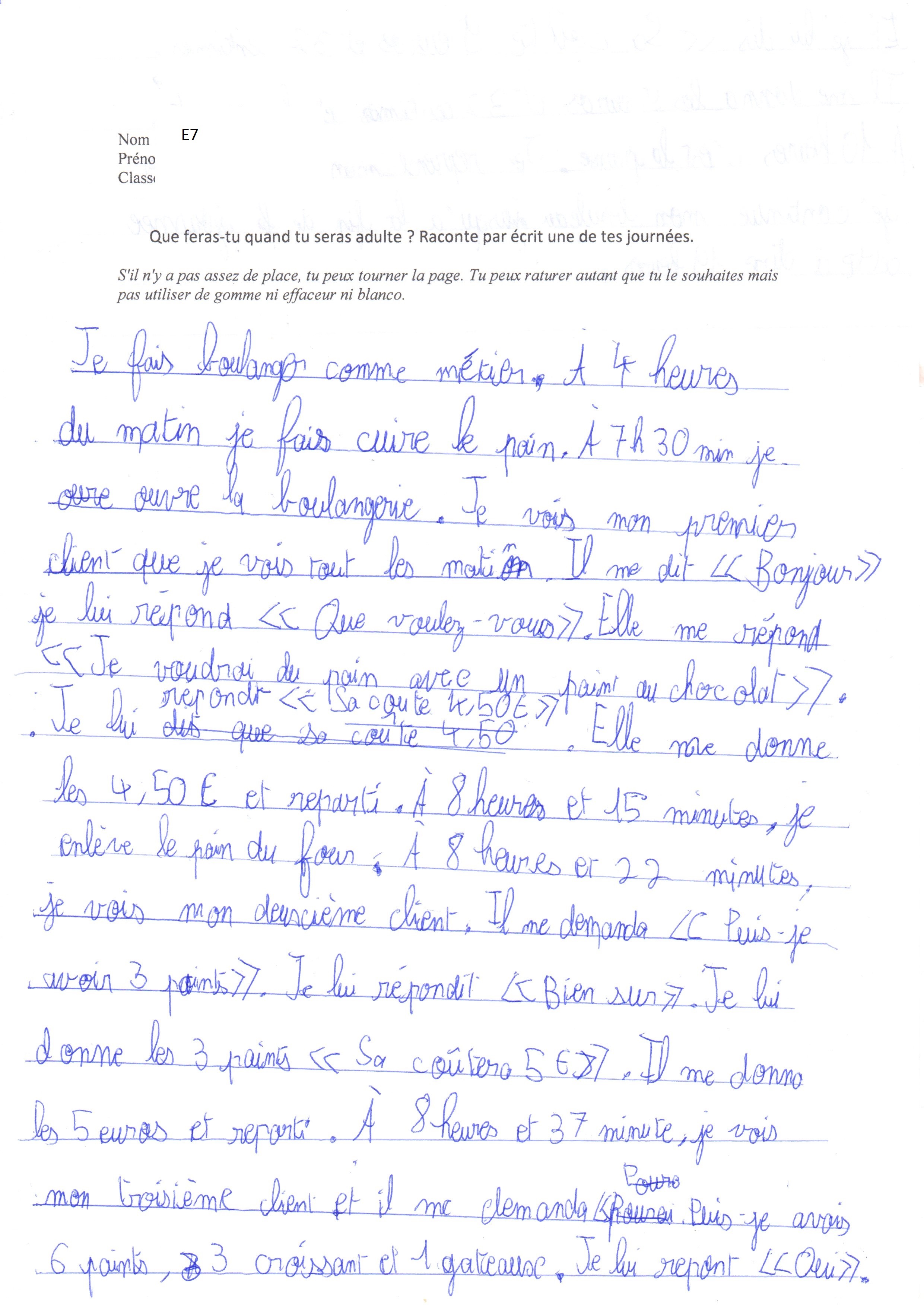
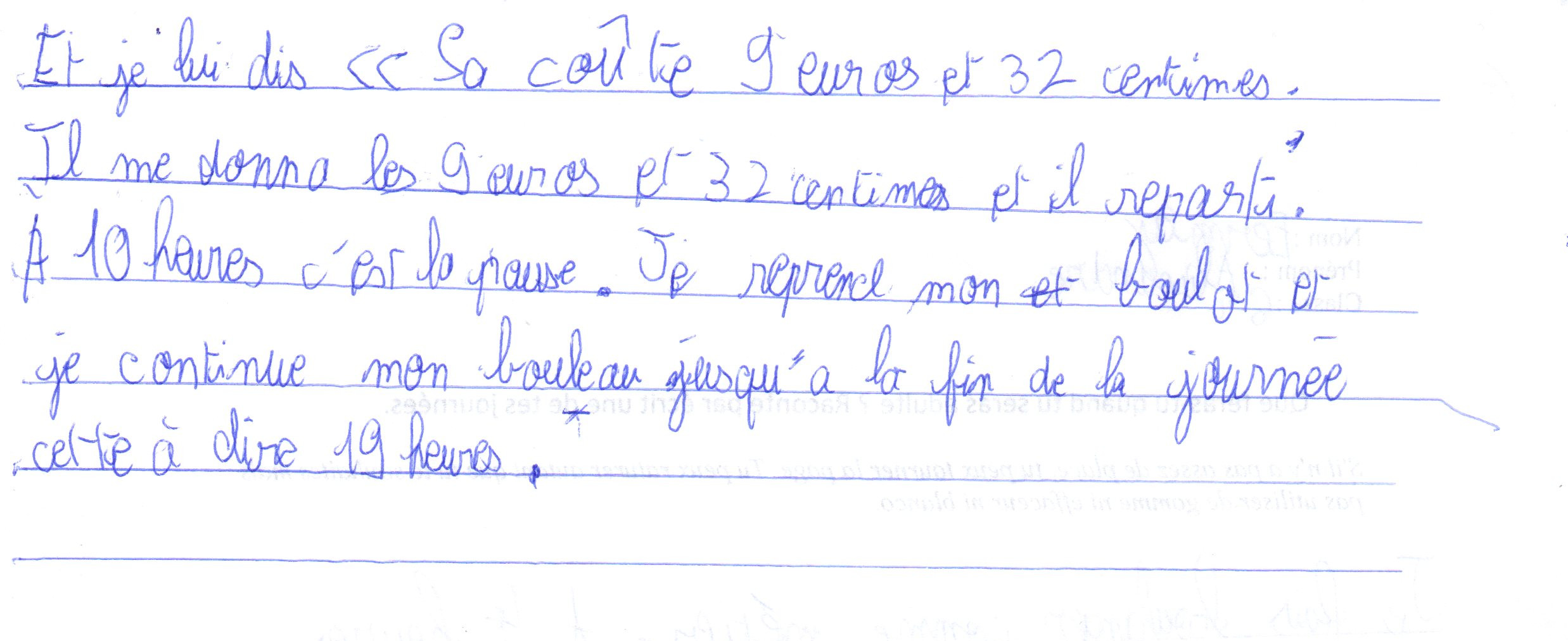
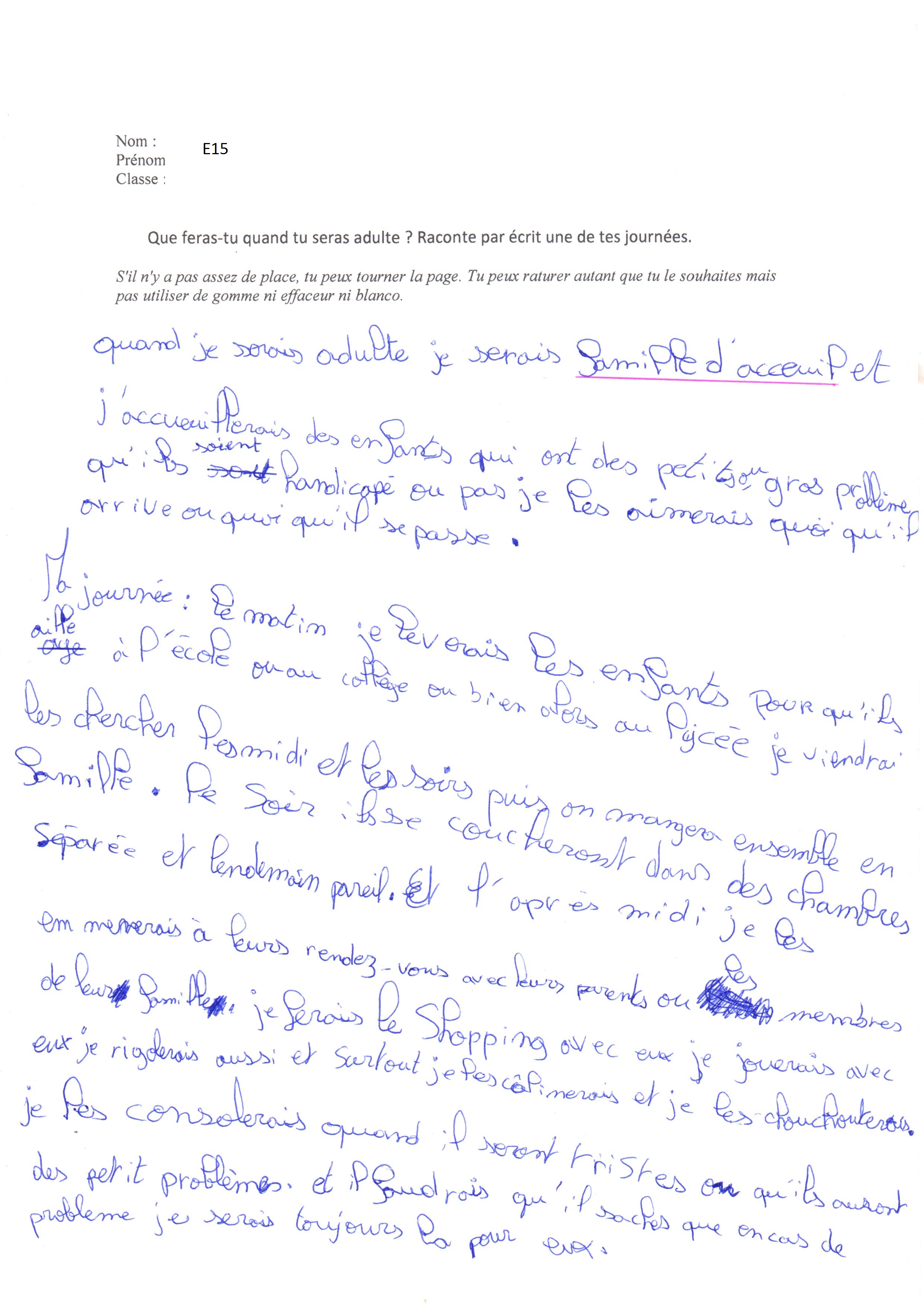
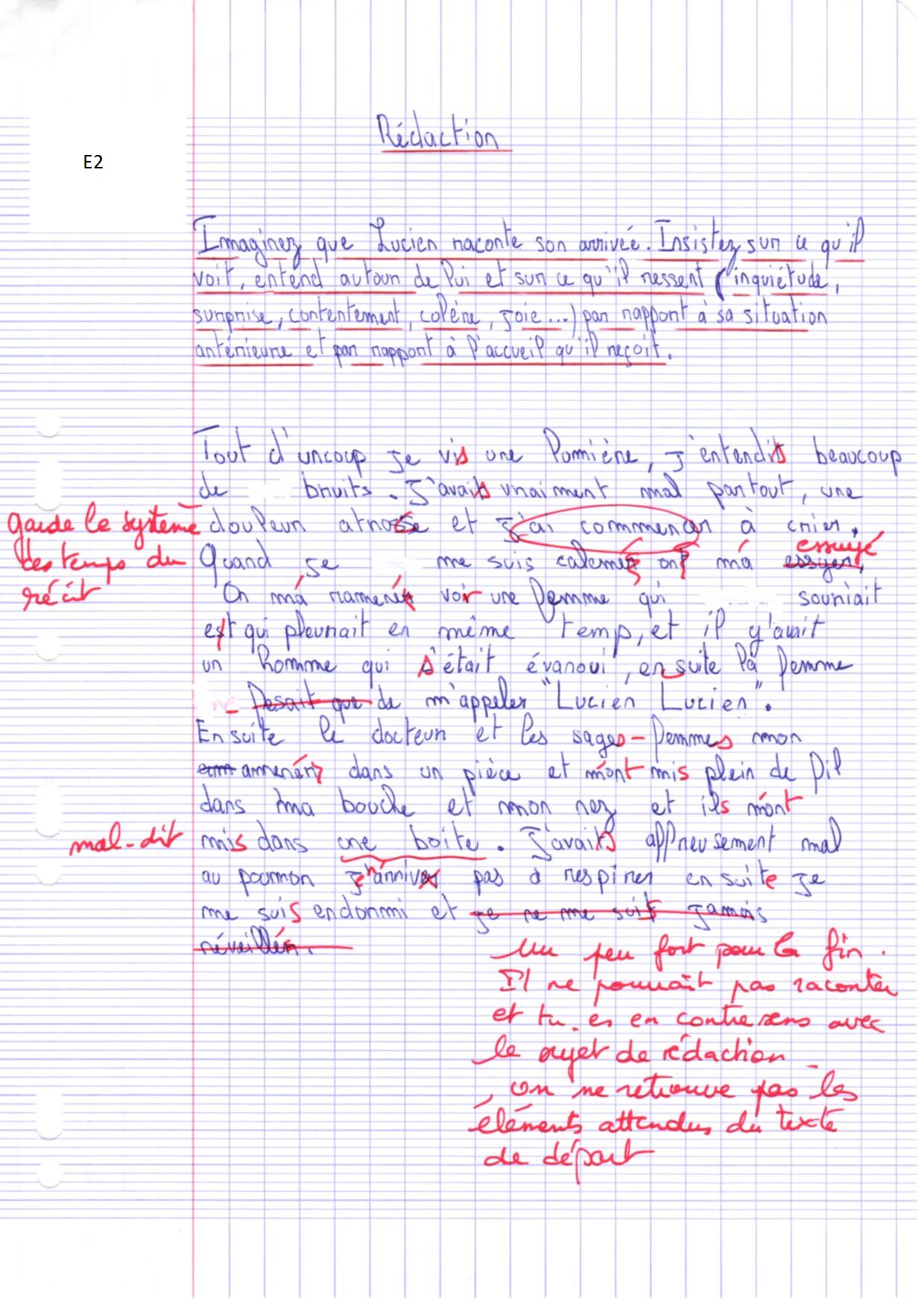
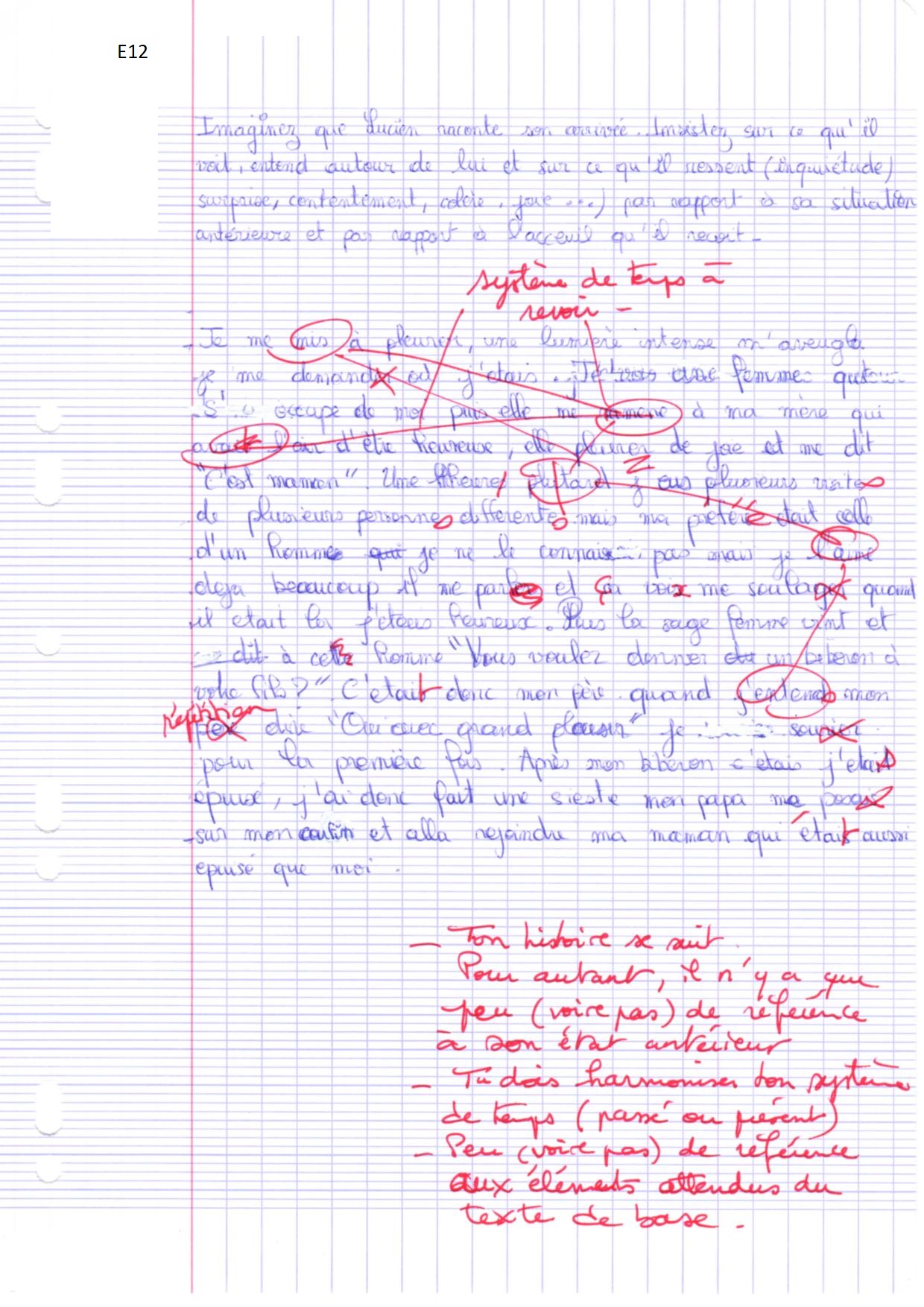
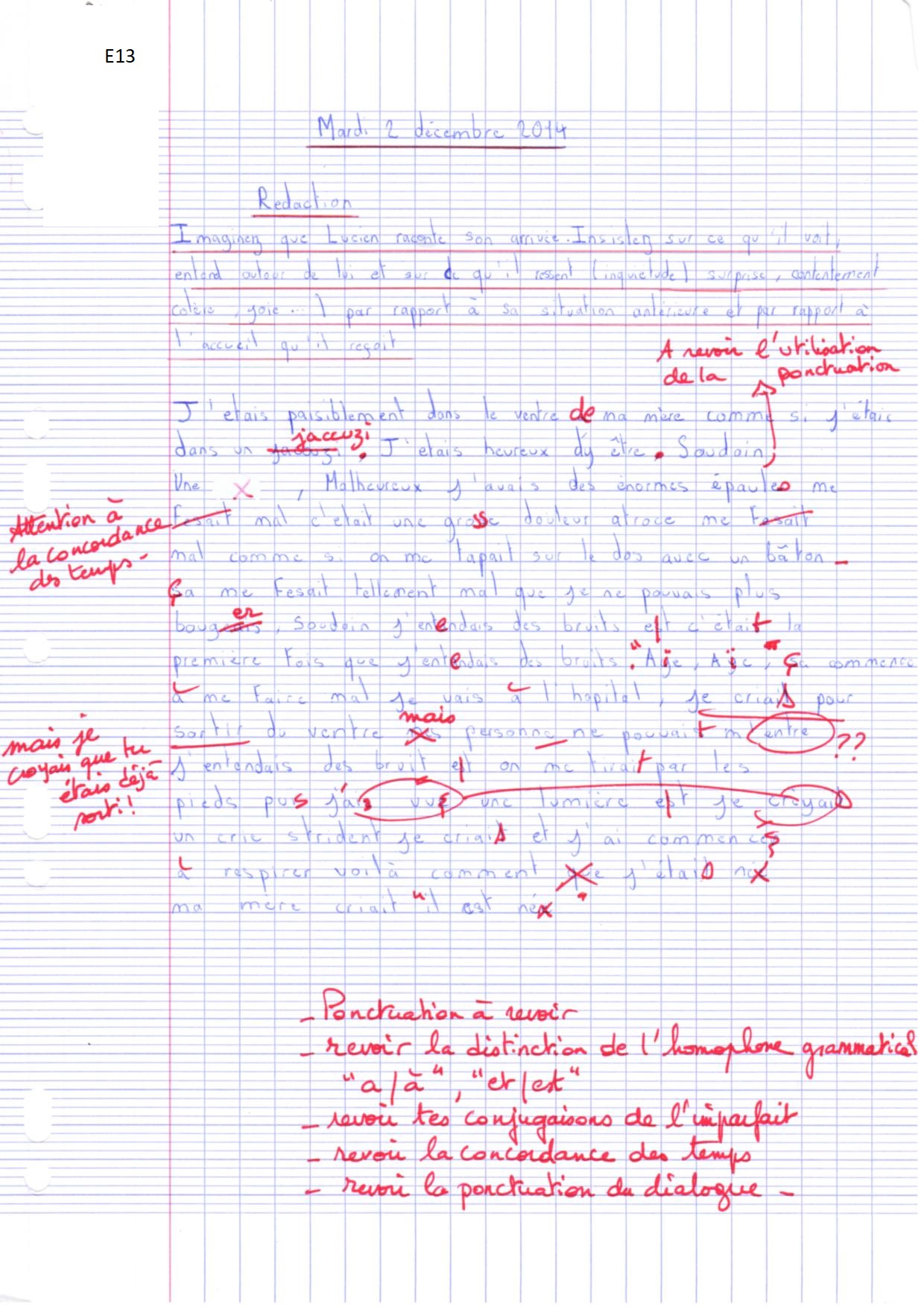
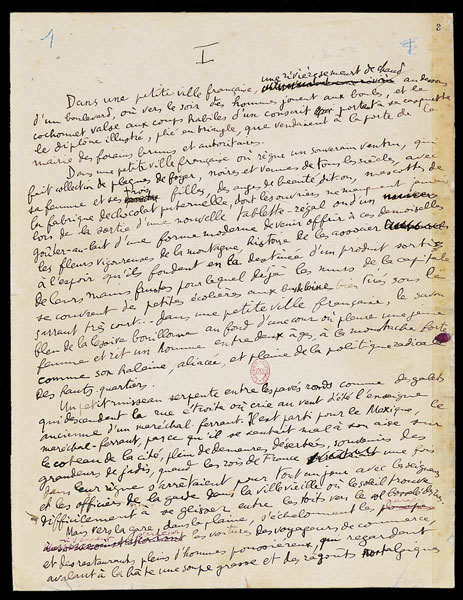

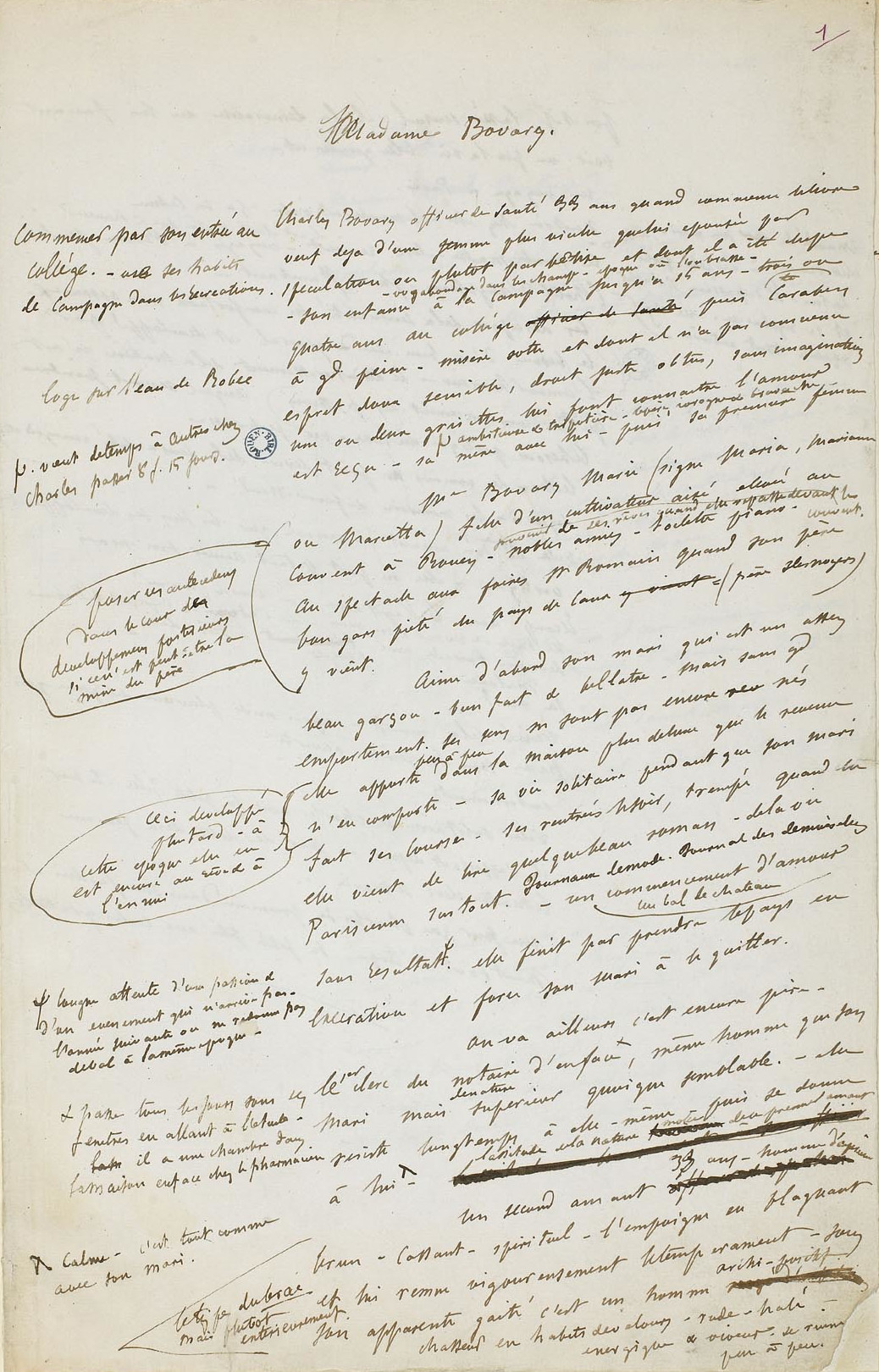
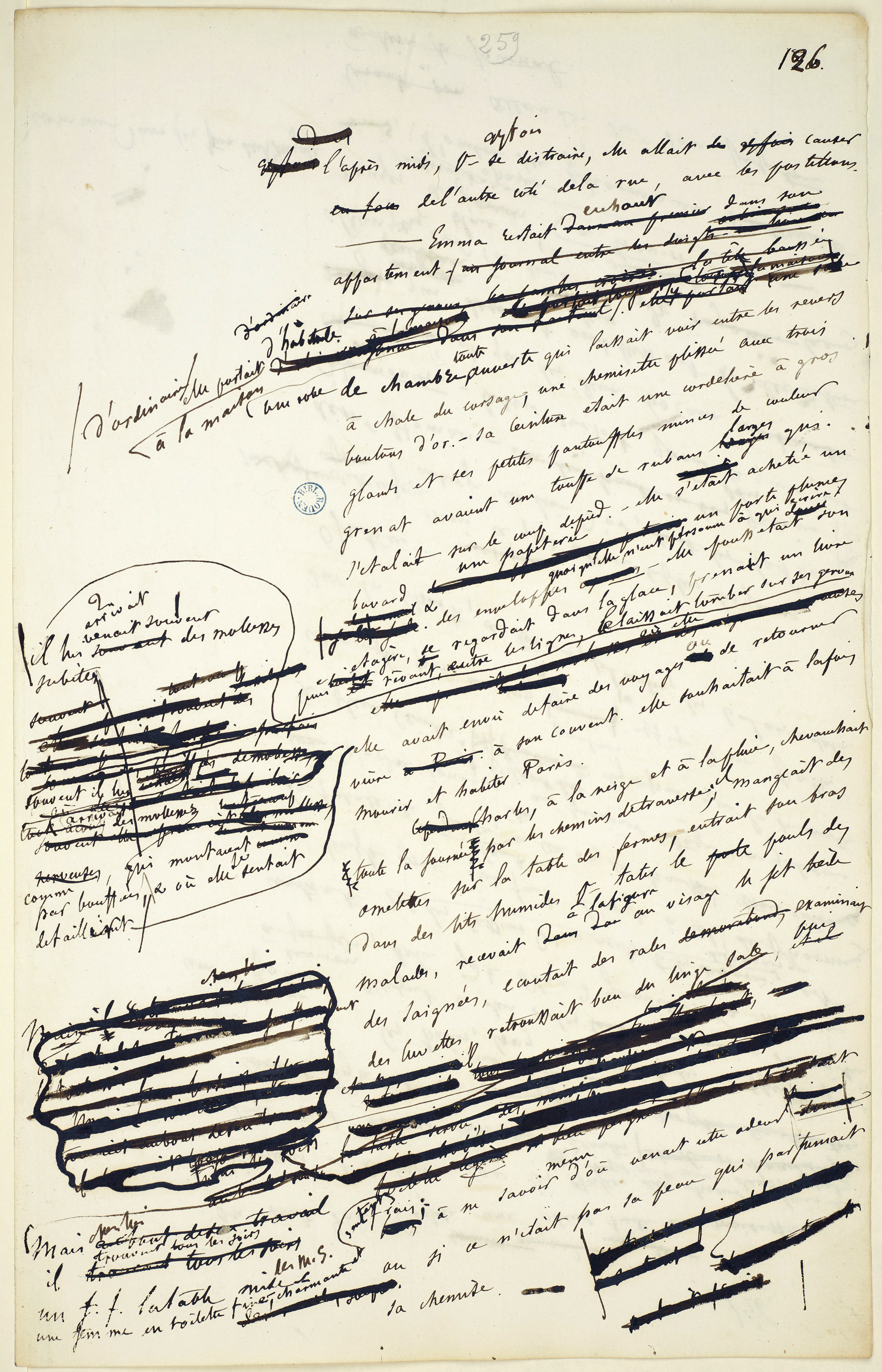


 Tu choisis un personnage,
enfant ou adulte, homme ou femme. Tu décris sa métamorphose en
un oiseau identique à celui présent sur l’image.
Tu choisis un personnage,
enfant ou adulte, homme ou femme. Tu décris sa métamorphose en
un oiseau identique à celui présent sur l’image.